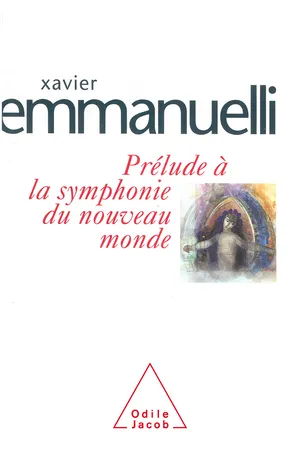
- 180 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Prélude à la symphonie du nouveau monde
À propos de ce livre
A chaque expérience que j'ai faite des confins de l'homme, comme médecin d'urgence, comme médecin des prisonniers, des exclus ou des toxicomanes, chaque fois, à travers souffrances et désastres, j'ai senti un peu plus fort que ces fins de monde sont aussi des préludes à un nouveau monde. Ces moments servent de tremplins. Ce qui était drame devient paix, ce qui était ténèbres devient lumière, la folie devient sagesse, la fureur ou la peur, sérénité, l'inquiétude et le désespoir, amour inconditionnel et solidarité. Une catastrophe est pour ainsi dire initiatique. Xavier Emmanuelli a fondé en 1971 Médecins sans frontière et a été secrétaire d'État à l'Action humanitaire d'urgence. Il a également créé le SAMU social de Paris.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Prélude à la symphonie du nouveau monde par Xavier Emmanuelli en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences sociales et Sociologie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE PREMIER
La médiation ou l’épreuve de l’exil
À Leninakan, tout n’était plus que montagnes de gravats, séparées encore par les larges avenues de ce qui avait été une grande ville, une suite de décombres organisées en perspective. Les cercueils de toutes les couleurs pullulaient dans tous les coins, plus violents que des cadavres. Qui a jamais dû voir des cercueils par milliers, jaunes et verts, gris, blancs, noirs, roux ? De temps en temps, une ambulance passait pour aller d’on ne savait où à on ne savait où, plus loin. Et sur ces immenses chantiers, cahotaient des insectes mécaniques géants. Puis la nuit est tombée et, dans le froid venu avec elle, s’allumèrent d’immenses feux. On croyait voir les humains comme à l’époque de leurs plus obscures origines, avant que le temps ne commence. Et le travail a continué à la lueur de projecteurs donnant à voir l’avenir de l’homme de l’autre côté de sa fin : une fois le futur accompli.
Mais voici le plus improbable peut-être : aux intersections des tas de ruines, au croisement des avenues du néant, on avait disposé, en abondance et à disposition de tous, du pain, de grandes galettes de pain, et du fromage. C’était une décision de simple organisation de la survie. Mais c’était aussi bouleversant de simple présence : la nourriture semblait tombée du ciel, offerte à partager par-delà les barrières de l’argent ou de la convoitise, dans une fraternité supérieure née, tragiquement, du seul triomphe de la ruine et de la mort, et de la volonté de la nier. Le ravitaillement devenait pain de vie — messe de communion.
Le réel volé
Le séisme arménien a été le premier à bénéficier d’un reportage d’actualités télévisées en direct. Pour parvenir, d’ailleurs, jusqu’au lieu de la catastrophe, situé en Arménie soviétique, derrière ce qu’on appelait encore « le rideau de fer », c’est par les camions de MSF que les équipes de reportage télévisuel avaient été convoyées. Ce fut une première médiatique : liaison en temps réel, comme on dit, avec les lieux du drame, par relais hertzien. Qui s’en souvient ? Depuis, toutes les catastrophes sont en direct, toutes celles qu’on veut bien montrer1.
Ce fut aussi une première pour moi. Que s’estil passé lors de cette transmission ? Rien de plus que la routine technique qu’elle exige. Mais justement, rien ne m’a saisi comme ce que j’ai compris en quelques instants ce jour-là, en étant simplement témoin de cette routine.
Le camion-relais vers Paris s’est déployé dans une rue, au beau milieu des débris, de leur silence minéral et du froid. Les techniciens ont pointé une immense antenne en direction du ciel, droit vers le satellite de transmission, invisible, là-haut. Ce processus du relais hertzien, qui reste vague pour ceux qui en bénéficient, en bout de chaîne, devient sur place un phénomène saisissant, une sorte de trait d’union surréel, de télescopage entre les décombres et Paris et ses studios. À l’autre bout du faisceau d’ondes, à Paris, visible en couleurs sur les écrans de contrôle, il y avait Christine Ockrent. Aux deux extrémités, les équipes préparaient la minute de passage à l’antenne : essais de son, d’image, de voix, dans ce qu’il est convenu d’appeler une « bonne ambiance » de travail.
Tout le monde connaît le professionnalisme des techniciens du spectacle, du cameraman au machiniste. On se doit d’allier efficacité et décontraction, rapidité et désinvolture, précision et insouciance. Tout doit être fait comme en se jouant, et comme si tout n’était qu’un jeu, à grand renfort de calembours, de vieilles complicités et de familiarité affectueuse. Ainsi fut-il fait : on prépara la transmission à coups de plaisanteries, de références, d’imitations...
Nous nous trouvions à l’épicentre d’une fin du monde, un endroit et un moment d’une écrasante gravité, qui nous plaçait de force, droits ouverts, muets et retenant notre souffle, béants. Et ce cynisme de « professionnels » venait se plaquer dessus, aussi grotesque que la scène du portier après le meurtre dans Macbeth. À la fin de la transmission, Christine Ockrent a prononcé une parole automatique, toute simple et qui se voulait « sympa » : « Bonne soirée, les gars. » Comment passe-t-on une bonne soirée chez les morts ? « Bonne nuit », ont répondu les gens sur place. Elle et eux étaient ensemble, c’était tout naturel. Où étaient-ils ? À Paris, via l’électronique du relais, comme si le relais hertzien lançait un cordon ombilical suffisant pour les ramener vers l’intérieur des studios, dans un espace professionnel sans dimension. Avec elle, ces gens à mes côtés n’avaient quitté ni Paris, ni leur métier. Ils avaient plutôt mis spontanément entre parenthèses leur corps qui vivait le présent.
Je n’ai aucun goût pour les mines de circonstance, non plus que de penchant morbide pour les circonstances dramatiques elles-mêmes. Le malheur ne m’attire pas, et il ne me procure pas la trouble jouissance de forcer, sous son prétexte, les autres à m’obéir en obéissant au deuil dont je me ferais l’officiant. Ce n’est pas eux qui m’ont frappé de stupeur, mais leur absence à la situation présente, que leur métier et ses rites leur permettait et même leur tendait comme un piège. Ce n’est pas leur façon de mal faire un métier qu’ils auraient pu ou dû faire autrement ou mieux qui m’a sidéré. C’est au contraire leur façon de bien le faire, et ce qu’elle entraînait de conséquences, pour qui n’y était pas plongé comme eux. Je n’ai pas vu là, non plus, un symbole de la volonté hypocrite ou perverse des médias de travestir le réel, de se moquer à part soi d’une émotion qu’on prétend communiquer. J’ai simplement trouvé là une confirmation claire de ce que j’avais jusqu’alors senti confusément : les médiations ne s’occupent pas du réel qu’elles prétendent retransmettre et souvent croient dévoiler, mais de sa mise en image, ce qui est à un monde de distance. Ce processus est purement et simplement la fabrication d’un univers parallèle, qui n’est ni transmission, ni restitution, mais seulement équivalence fabriquée, obligatoirement fabriquée, qu’on le veuille ou non. C’est pour cette raison que ses opérateurs évitent de confondre l’émotion réelle avec l’image qu’ils doivent travailler à produire.
À l’autre bout, sur l’écran du téléspectateur, l’écart serait le même entre l’image « dramatique » et la réalité. Quelque sincère qu’elle se souhaite dans l’idéal (et je ne suis pas assez candide pour ignorer que ce n’est pas toujours le cas...), la télédiffusion du monde fabrique et fabriquera toujours, à l’inverse de ses protestations pieuses, une image substitutive de l’expérience directe. Loin de la communiquer, elle en éloigne. La plupart de ses opérateurs, sous leur folklore, tentent de bonne foi de faire un travail de transmission. Mais leur décontraction professionnelle dit mieux qu’ils ne le savent que toute technique place dans un écart avec le monde qui ouvre la voie au cynisme.
La technique ou l’exil
Les techniques de tous les métiers, l’emploi de tous les outils exigent de leurs usagers rançon qui se paie par une mise à distance d’avec une participation profonde au monde. Le moindre appel téléphonique nous place hors de notre corps. Les circonstances extrêmes d’une catastrophe rendent criant ce qui nous échoit à longueur de journées ordinaires. Nous sommes tous, sitôt que nous manipulons un outil destiné à opérer sur le monde, dans le même risque d’absence à soi et au monde : voués à une forme d’exil. Il faut nous pardonner tous : nous ne savons pas ce que nous faisons.
Tout métier exile. Le mien en tout premier. Tout ancien carabin, par exemple, voit bien ce que peut être pour lui et sa confrérie, l’équivalent de ce que j’évoque pour les techniciens de télévision. Le folklore, d’abord : décontraction, ironie et impavidité de rigueur, nappées de cet humour si célèbre par sa crudité et sa prédilection pour les plaisanteries les plus organiques possible. Il tire évidemment ses caractéristiques de la double volonté — louable en soi — d’être technicien avéré plutôt qu’empiriste, professionnel reconnu plutôt que soupçonné amateur, et maître de soi avant et au lieu d’être impressionnable. Ensuite, la façon de faire son métier. La hiérarchie qui monte du « petit généraliste » au « grand spécialiste », mandarin et grand ponte, semble induire strictement une montée en distance et en recul dans les comportements. À la base, l’humble empathie compréhensive et serviable aux souffrants du généraliste de campagne ; au sommet et à leurs sommités, les façons expéditives, les décisions péremptoires et même pas communiquées au patient, que le spécialiste regarde comme en passant, pour ne voir derrière la personne que le cas clinique. Le tout, en somme, assez comparable aux degrés du clergé, du petit curé de campagne au prélat. Qu’est-ce qui gradue cette montée, sinon l’acquisition d’une façon de faire, le règne du métier sur celui qui le pratique ? L’appropriation d’une technique sans cesse plus aiguisée dégage toujours plus le praticien de sa subjectivité. L’éminent, tout en haut, est celui à qui on reconnaît qu’il maîtrise son sujet, qu’il domine sa spécialité. C’est aussi celui qui voit les choses de plus loin et les gens de plus haut. Il se place, comme sujet vivant, de plus en plus loin de cet autre sujet qu’il examine.
Il y a plus. Quand on intervient, dans une catastrophe, en urgence, ou même dans des circonstances moins extrêmes, sur un patient, on suit un protocole bien précis, et qui d’ailleurs est d’autant plus efficace qu’il est devenu chez le praticien un automatisme, pour raccorder son corps à l’appareillage d’intervention — sondes, perfusions en tout genre, cardioscope, etc. Ce « branchement » est le début de toute intervention. Qui connaît son affaire a même intérêt à en résumer pour lui les procédures en un petit programme mémorisé, aussi automatique que la table de multiplication : « Quatre tuyaux, plus deux drains... » ; les tuyaux : veineux, urinaire, trachéal, gastrique ; les deux drains : thoracique et péritonéal. On se récite la check-list : « Ai-je de quoi intuber, de quoi aspirer, de quoi ventiler et de quoi perfuser... ? » C’est la moindre des choses pour éviter les bavures par oubli, négligence, distraction. Or cette procédure porte un nom dans le jargon professionnel : on appelle cela techniquer le malade. Et ce mot, commode et malsonnant, moderne et évocateur, dépasse encore son éloquence pourtant flagrante : techniquer quelqu’un, c’est non seulement le raccorder aux machines, mais c’est le soumettre à une procédure machinique (dans laquelle il entre, plus que la machine ne vient à son service). C’est le faire soi-même, autant que possible machinalement. C’est enfin, en quelque sorte, réduire tous les côtés aléatoires du vivant, avec ce qu’ils ont d’inquiétant et d’angoissant aussi pour l’opérateur, au cadre formalisé de la technique. Avant d’intervenir, pour intervenir, il faut techniquer. C’est indispensable : les gestes de sécurité ont été listés, transformés en réflexes, à se réciter avant tout. Qui s’en plaindrait ? Mais on ne peut s’empêcher de remarquer que, dans cette excellente intention de mettre automatiquement les premiers dangers à distance, la notion moderne d’efficacité commence par la mise automatique à distance de l’homme à soigner d’avec l’homme soigneur. C’est comme si la pratique allait de pair avec un premier mouvement de recul, d’interposition de toute la technologie disponible entre deux vivants. Vite, avant tout, la machinerie avant l’humain.
La médecine, pour sa part, est mise, par ses techniques, au défi d’un exil par ses médiations, comme la télévision l’est par les siennes. En nous formant, tout métier — c’est sans doute cela la déformation professionnelle — nous place, à sa façon particulière, loin du monde.
L’image ou comment « techniquer » le réel
Communiquer, désormais, est à l’évidence un souci et un enjeu majeur, presque aussi vital que la médecine : c’est un des outils primordiaux du maintien du monde en bonne santé, vis-à-vis des maladies économiques, idéologiques, guerrières, par une bonne circulation du sens, clair, non pollué, les nouvelles fraîches et rapidement acheminées représentant le sang neuf dont la démocratie a besoin en permanence. Au nom de la transparence, de la proximité et de la vérité instantanées, la planète est vouée à la communication planétaire, sans voir qu’elle court un risque énorme, celui de la dissolution de son sens des réalités.
La médiation technologique de l’information donne à croire à la transportabilité de l’expérience vécue. Chacun des médiatisés d’appartement peut penser qu’il sait tout sur tel massacre, parce qu’il en a entendu parler, même d’abondance, même à saturation. Et la télé-participation au monde donne à penser que l’expérience humaine est directement échangeable, déversable, comme des liquides d’une citerne à l’autre : on prend le malheur, on le pompe, on le transporte, on le vide chez vous, etc.
La médiation télévisée ne peut pas montrer le réel, même si elle voulait tout faire pour cela. Toutes mes expériences aux quatre coins de la planète me l’ont confirmé. On ne peut pas montrer les cercueils multicolores de Leninakan sans craindre que cela ne se transforme en une platitude grotesque qui paraîtrait avoir été filmée pour manquer de respect aux morts et aux survivants. Cette réalité vraie ferait une image incongrue, impolie.
Le réel « brut » ne fait pas une image cohérente : il est devant nous quand nous sommes en lui, et avant de le juger ou non cohérent, nous l’admettons. Une image, c’est l’inverse : il nous faut la lire pour l’avaliser. Et pour la lire, il nous faut la recevoir composée.
Ce qui compose une image ne rend pas compte du réel dont elle provient. À la limite, on peut même dire que l’image a très peu à en tenir compte pour parvenir à ses buts : faire, au moyen de ce qui est là, une image filmable, simplement lisible audiovisuellement. Le réel ne la concerne pas pour ce qu’il est, et qui est plus d’une fois, dans ces cas extrêmes, impossible à représenter (il déborde la perception et l’entendement de toutes parts), mais simplement dans la mesure où il va fournir de la matière première à la représentation. Cela, l’expérience vécue me l’a confirmé sur place, et par un autre biais très simple.
Dans les situations de désastres collectifs, les seuls qui savent d’emblée quoi faire, ce sont les opérateurs de prises de vues. Un intervenant de médecine de catastrophe, c’est un fait connu désormais, est d’abord saisi non seulement de stupeur, mais même, techniquement, de perplexité. Vient un moment inévitable de flottement, que l’on observe souvent chez les personnels des organisations non gouvernementales, même les mieux entraînés : ils ne savent pas par où commencer. Et les sauveteurs, en arrivant sur place, s’agrègent les uns aux autres. La situation les désempare. Les opérateurs et les cameramen, jamais. Eux savent tout de suite ce qu’ils viennent chercher, l’émotion-qui-sera-sur l’image, l’image-qui-devra-rendre-compte-de-l’émotion préconçue ou attendue sur le sujet, dont on pourra faire une « image émouvante ». C’est simplement qu’ils arrivent avec ce qu’ils viennent chercher, non afin de se mettre à la disposition de ce qui va s’imposer à eux. Ce n’est pas pervers, c’est fatal. On pourrait croire que leur métier est par définition de s’ouvrir à ce qui fait irruption. Et la plupart des téléspectateurs du monde le croient. On ne les décourage pas dans cette idée, et les réseaux médiatiques, les tout premiers, donnent leurs opérateurs et se donnent comme les témoins permanents de la nouveauté du monde, les servants de cette nouveauté, surtout lorsque la corporation doit se défendre de quelque soupçon. Ils rappellent alors au besoin que la médiation moderne est le défenseur et l’illustrateur du droit de tous à l’image, à l’accès au réel planétaire. Ils vont parfois jusqu’à oublier ce qu’ils savent très bien, que leur métier n’est pas celui-là, et jusqu’à croire de bonne foi que c’est ce qu’ils font : mais, au contraire, leur travail est de techniquer ce qui advient, de le réduire aux dimensions, cadres, timing, codes, au format qu’on attend d’eux qu’ils respectent pour produire le produit attendu. Gros plans, enfants à la tête ouverte (pas trop, ce serait invendable parce que irregardable) : non seulement leur tâche n’est pas d’intervenir, mais encore, en cherchant ce qui fait une image, leur travail consiste à ne tenir le réel que pour la matière première de leur travail de traitement de l’information : cela les tient une deuxième fois à distance. Ils doivent d’une part la conserver entre eux et leur « sujet », d’autre part travailler dessus pour créer une distance : sans cela, il n’y a pas d’image lisible. L’image lisible de quelque chose ou de quelqu’un ne restitue pas cet être ou cette chose : elle ne donne que l’illusion de sa proximité. Ceux qui doivent ag...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Remerciements
- Avant-propos
- Chapitre premier - La médiation ou l’épreuve de l’exil
- Chapitre II - La dépendance ou l’épreuve de la reconquête de soi
- Chapitre III - La perpétuité ou l’épreuve des retrouvailles avec le temps
- Chapitre IV - La compassion ou l’épreuve de soi par les autres
- Chapitre V - La rupture ou l’épreuve de la métamorphose
- Chapitre VI - La conscience ou l’épreuve du sens
- Table