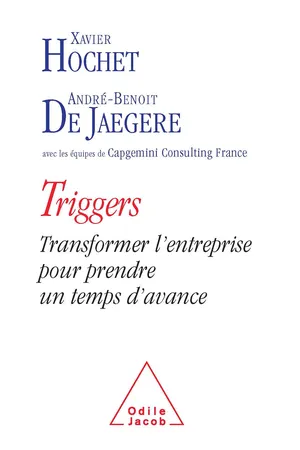
eBook - ePub
Triggers
Transformer l’entreprise pour prendre un temps d’avance
- 352 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Triggers
Transformer l’entreprise pour prendre un temps d’avance
À propos de ce livre
Diriger une entreprise, c'est savoir la transformer pour prendre un temps d'avance. C'est décider de ne pas subir quand le monde bouge en profondeur. Quelles sont alors les mutations décisives ? Comment mieux les comprendre pour donner les nouvelles orientations ? Et comment les intégrer pour déclencher dans la réalité du travail les transformations qui permettront la réussite future ?Cas concrets passés à la loupe et adaptés à tous les types de structures ; éclairages apportés par des dirigeants de tous horizons sur leurs décisions et leur vision de l'avenir ; décryptage des mutations sociétales et économiques en cours : cet ouvrage, élaboré à partir de l'expertise des équipes de Capgemini Consulting, marque de conseil en stratégie et transformation du Groupe Capgemini, ouvre de nouvelles pistes de réflexion et d'action aux décideurs et gestionnaires des secteurs les plus divers, en entreprise ou dans la sphère publique. Xavier Hochet est directeur exécutif de Capgemini Consulting France. Il est aussi responsable des activités de conseil pour l'Europe du Sud et la Chine. André-Benoit De Jaegere est vice-président, directeur de l'innovation de Capgemini Consulting France.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Triggers par Xavier Hochet,André-Benoit De Jaegere en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Commerce et Management. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
SECONDE PARTIE
MUTATIONS
Chapitre 1
La fin des temps modernes
« Avouons-le sans amertume, l’individu a son intérêt distinct, et peut sans forfaiture stipuler pour cet intérêt et le défendre ; le présent a sa quantité excusable d’égoïsme ; la vie momentanée a son droit, et n’est pas tenue de se sacrifier sans cesse à l’avenir. »
Victor HUGO1
« À l’impératif catégorique kantien, impératif moral, actif et rationnel, succède […] un “impératif atmosphérique” que l’on peut comprendre comme une ambiance esthétique où, seule, importe la dimension transindividuelle, collective, voire cosmique. »
Michel MAFFESOLI2
Dans cette époque pressée, on a tôt fait d’ériger en « ruptures décisives » des événements qui, quelques mois, voire quelques semaines plus tard, rejoignent la masse immense des non-événements dont le Web devient le dépositaire indifférent. Le discours de la rupture, particulièrement florissant dans les domaines politique, économique et technique, a ceci de particulier qu’il réduit à une mince ligne ce qui sépare l’avant de l’après, entretenant l’idée que les sociétés humaines peuvent, du jour au lendemain, changer du tout au tout.
Les yeux rivés sur le temps court, l’Occident oublie que, pas plus qu’elles ne se décrètent, les mutations sociétales ne sont réductibles aux événements qui servent a posteriori à les décrire, à les expliquer et à les dater. Ces mutations ne sont ni instant, ni rupture ; elles sont durée. Elles sont ce temps hybride entre l’avant et l’après ; elles sont cet espace des tableaux d’Escher où dans les interstices de l’évidence première l’œil devine, discerne puis voit clairement une nouvelle évidence. C’est à cet exercice de discernement que doit constamment se livrer le dirigeant d’aujourd’hui s’il veut percevoir, comprendre et réduire les dissonances entre ce que propose l’entreprise – façonnée, sinon régie, par les valeurs des temps modernes – et les attentes de ses clients, de ses collaborateurs, de son écosystème, oscillant entre ces mêmes valeurs et celles de la postmodernité.
Ceci devient cela
Les mutations sociétales sont difficiles à appréhender et à caractériser mais on peut, avec Michel Maffesoli, considérer que nous sommes en train d’en vivre une – abandonnant les rivages connus du monde moderne pour aborder ceux, plus incertains, du monde postmoderne. « Quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, dit Michel Maffesoli3, on voit bien que chaque trois siècles, ou quatre, de grands changements de fond s’opèrent : de grandes valeurs sur lesquelles avait reposé la société ne sont plus des valeurs attractives ; elles ne disparaissent pas ; simplement elles perdent leur attractivité. Pour décrire ce phénomène, j’utilise l’idée de saturation. En chimie, un corps se sature quand les diverses molécules, pour des raisons d’usure, ne peuvent plus rester ensemble : le corps se déstructure ; le corps est saturé. Mais, et c’est sur quoi il faut insister, ces mêmes molécules rentrent dans une autre composition pour faire un autre corps. »
Il paraît important de souligner que ces grands changements sociétaux, ou changements de paradigme, s’opèrent d’une manière quasi inéluctable et que les individus « n’en peuvent mais » : ce ne sont pas eux qui font la mutation, ils la subissent, et toujours avec retard. « Il y a d’abord la vie, ajoute Michel Maffesoli, puis il y a la prise de conscience de ce qu’on vit. L’entreprise n’étant pas exterritorialisée par rapport à la société, elle doit obligatoirement être attentive à ce changement de paradigme ; c’est un principe de réalité. » Pour comprendre en quoi consiste le changement de paradigme, il est intéressant de revenir sur les trois grandes valeurs qui ont structuré la modernité – travail, rationalisme, progrès – et qui, depuis les années 1950, se recomposent en un nouvel ensemble où brillent d’autres étoiles : la créativité, la raison sensible, le présent.
Du travail à l’idée de création
La valeur pivot de la modernité, celle autour de quoi s’organise et se structure la vie en société, est la « valeur travail ». Il est rare de pouvoir dater précisément la naissance d’une valeur. Celle-ci, qui culmine au XIXe siècle, s’affirme à partir de la fin du XVIIIe siècle, lorsque Kant la pose comme un impératif catégorique auquel il est par conséquent impossible de déroger : tu dois travailler, cela ne se discute pas. Pourquoi ? Parce que c’est par là qu’il y a réalisation de soi et réalisation du monde. Kant souligne cependant qu’il n’en a pas toujours été ainsi : jusqu’alors, le travail était le fait des gens serviles. L’honnête homme dérogeait s’il travaillait, l’aristocrate (l’homme bon, beau, etc.) ne travaillait pas : homme d’Église ou d’épée, il servait Dieu et son roi – laissant commerce et autres industries aux bourgeois, ou, sous d’autres latitudes, aux vaishyas. La littérature européenne montre bien comment, peu à peu, le travail devient une valeur centrale et la vertu par excellence de l’homme civilisé. Seul sur son île, vingt-huit années durant, que fait le Robinson de Daniel Defoe4 ? Il travaille. Il pourrait jouir de la vie, vivre de ce que lui offre la nature, mais non : il travaille sans relâche, bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour assurer sa subsistance. C’est le travail qui, en organisant son quotidien, l’empêche de retourner à l’état de nature. Les grands romans français du XIXe siècle regorgent de héros qui, par leur labeur et leur persévérance, parviennent à « sortir de leur condition ». Mais que font tous ces héros dès qu’ils le peuvent ? Le paradoxe – mais en est-ce vraiment un ? – veut qu’ils se retirent des affaires, s’installant dans la respectabilité enviée de qui peut vivre de ses rentes, après avoir bien marié ses filles…
Le paradoxe n’est qu’apparent car, « dans tous ces cas de figure, c’est bien la valeur travail qui fonde l’ordre social, mais elle le fait comme “par défaut”. L’idéal, ce à quoi chacun aspire, est d’y échapper – de droit, du fait de sa naissance, par un beau mariage ou, au pire et beaucoup plus rarement, après avoir beaucoup travaillé5… ». Si la littérature romanesque reflète la manière dont la société vit le travail, la littérature économique en décrit la fonction. Pour Adam Smith6, par exemple, le travail est avant tout ce qui crée la richesse. Quantité divisible à l’infini, il est aussi l’unité de mesure qui permet d’établir de manière précise la contribution de chaque individu à la production (le nouvel objectif central de la société) et la rétribution qu’il doit en retirer.
On sait combien cette vision, formulée à la fin du XVIIIe siècle, continue d’imprégner le discours politique et économique, mais force est de constater que, depuis quelques décennies, « la valeur travail » et l’injonction « travaillez, prenez de la peine », qui a fait avancer des générations entières dans l’espérance d’un mieux, se sont mises à sonner étrangement faux. Pour les générations montantes, la preuve est faite que le travail ne conduit pas l’humanité à une vie meilleure – ce qui conforte les plus jeunes dans l’idée qu’il est aussi vain que stupide de perdre sa vie à la gagner. Tandis que pâlit l’étoile du travail institué en uniques fin et moyen de l’existence, l’idée nietzschéenne de « faire de sa vie une œuvre d’art » progresse – poussant, consciemment ou inconsciemment, chacun à faire preuve de créativité dans la création de lui-même. L’esthétique de l’existence prônée par Foucault – « l’idée selon laquelle la principale œuvre d’art dont il faut se soucier, la zone majeure où l’on doit appliquer des valeurs esthétiques, c’est soi-même, sa propre vie, son existence7 » – trouve ainsi de plus en plus d’écho et d’adeptes qui s’ignorent. Cela n’exclut absolument pas la notion de travail, mais cela en change fondamentalement la nature, comme en témoigne l’emploi récurrent de l’expression « travailler sur soi », base de toute démarche de « développement personnel », autre expression symptomatique.
De la raison à la raison sensible
La deuxième grande valeur de la modernité est le rationalisme. S’il naît au XVIIe siècle avec Descartes, ce sont les philosophes des Lumières qui lui donnent toute sa puissance structurante, en faisant de la rationalité humaine – la capacité à établir une relation de cause à effet – le principe organisateur d’un monde désormais perçu comme un système. Dès lors, le rapport à soi, le rapport au monde, aux autres, à la société, sont régis et ne s’expliquent plus que par cette chose universelle : la Raison. Il n’est pas inutile, en ces temps de préoccupations écologiques et d’émergence de l’idée de biens publics mondiaux, de rappeler que, dans la pensée des Temps modernes, la Nature n’est plus le grand vivant éternel des stoïciens ; elle devient la machinerie cosmique dont l’homme doit, dit Descartes, se rendre « maître et possesseur ». C’est d’ailleurs ce que fait Robinson, à la modeste échelle de « son » île – île déserte, comme on le sait, mais qu’il s’emploie néanmoins à arpenter, cartographier, inventorier et civiliser, en y faisant régner l’ordre et la religion.
À partir des Lumières, la Raison cesse donc d’être une question philosophique débattue en chambre par les seuls universitaires. Par capillarité, elle pénètre et se répand partout, dans le corps et individuel et collectif. D’où la « rationalisation généralisée de l’existence » dont parle Max Weber – rationalisation que l’on retrouve, appliquée au management et à l’organisation du travail, dans les écrits de Taylor8. La rationalisation de la vie et de la société marque le triomphe du rationalisme ramenant tout au mesurable, à l’explicable, au maîtrisable. Il va de soi que cette volonté de maîtrise cherche à faire taire et soumettre l’animal qui est en l’homme. La raison impose nécessairement le silence aux réactions primaires, aux émotions et, plus encore, aux sensations. On voit, par exemple, comment Robinson – archétype de l’homme rationnel, civilisé, sachant se contrôler – est choqué par l’animalité de Vendredi, à commencer par sa nudité. Que fait-il après lui avoir sauvé la vie ? Il lui donne des vêtements ; ensuite, il lui signifie qu’il doit, sous peine de mort, renoncer au cannibalisme ; enfin, il fait son éducation, lui enseignant « à faire tout ce qui était propre à le rendre utile » et l’instruisant « dans la connaissance du vrai Dieu9 ».
La raison cependant n’empêche pas les émotions, les passions et les sensations d’être. Elle les contient, elle les empêche de s’exprimer – ce qui est loin d’être la même chose. Ainsi, le roman victorien érige-t-il en idéal féminin un être d’apparence raisonnable, réprimant sa sensualité, tout de retenue, policé et bienséant, bien que souvent en proie à des sentiments d’autant plus exaltés qu’ils sont tus. Cela explique, en outre, la naissance (dans le XIXe siècle finissant) de la psychanalyse, si l’on accepte de voir cette discipline comme la mise en mots de ce qui ne peut/doit pas être exprimé et, partant, comme une (re)création de soi par le verbe.
Mais, depuis quelques décennies, le monde rationalisé craque de toutes parts et le corps – ce corps qu’on s’était appliqué à contenir, à faire taire, à tenir pour quantité négligeable et méprisable par rapport aux choses de l’esprit – reprend ses droits. Le corps n’est plus simplement outil de production et de reproduction, comme au XIXe siècle. On le soigne, on l’écoute, on le montre, on le valorise. On pourrait citer maints exemples, mais le développement des médecines non conventionnelles auquel on assiste en Occident est une bonne illustration de l’émergence de cette « raison sensible », comme l’appelle Michel Maffesoli. Médecines douces, soins énergétiques, chromothérapie, lithotérapie, réflexologie, aromathérapie… toutes ont (au moins) un point commun : visant au bien-être global, à l’harmonie du corps, de l’esprit et de l’âme (laquelle fait d’ailleurs un retour en force), elles mettent l’accent sur l’entièreté de l’être.
Du progrès antérieur au plus-que-présent
La troisième valeur qui structure la modernité est la foi en l’avenir, la confiance dans « les lendemains qui chantent » – sur terre et dans l’au-delà. À partir du XVIIIe siècle, toute l’énergie se focalise sur le futur, avec deux grandes manifestations : la philosophie hégélienne de l’histoire qui veut que, la raison gouvernant le monde, l’humanité soit partie d’un point A de barbarie et qu’elle se dirige inexorablement vers un point B de civilisation absolue ; le mythe du progrès, qui est l’expression même de cette conception de l’histoire. L’idée qu’en avançant, on va forcément vers le mieux et le meilleur a été l’un des plus puissants ressorts du monde moderne et du développement de l’industrie. Stephan Zweig en décrit l’emprise en ces termes : « Le XIXe siècle, avec son idéalisme libéral, était sincèrement convaincu qu’il se trouvait sur la route droite qui mène infailliblement au “meilleur des mondes possibles”. On ne considérait qu’avec dédain les époques révolues, avec leurs guerres, leurs famines et leurs révoltes, on jugeait que l’humanité, faute d’être suffisamment éclairée, n’y avait pas atteint la majorité… cette foi en un “Progrès” fatal et continu avait en ce temps-là toute la force d’une religion10. »
L’idée de progrès nourrit la foi quasi aveugle dans la science et dans la technique qui domine le XIXe, puis le XXe – du moins jusqu’au double choc de 1945 : la découverte des camps de la mort et le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Si à partir de cette date le doute s’insinue, le mythe ne meurt pour autant ! Il résiste. Sans cesse, il renaît de ses cendres, aujourd’hui par exemple chez les trans- et posthumanistes, d’où la conviction de James Hugues et de bien d’autres qu’on aura probablement vaincu le vieillissement en 2020 et qu’on saura télécharger le contenu d’un cerveau humain sur un ordinateur avant la fin du siècle. Conjugué à l’idée de croissance, la « valeur progrès » connaît une énième jeunesse et reste, pour le commun des mortels, largement positive. Dans une quelconque assemblée aujourd’hui, qui oserait dire qu’il n’est pas un homme ou une femme de progrès ? Personne ! « Si l’on n’est pas progressiste, on n’existe pas ; on ne peut être que progressiste : c’est la conséquence de cette foi séculaire dans le futur », dit Michel Maffesoli.
Et pourtant, il y a maints indices que le futur n’est plus, aujourd’hui, la temporalité de référence des s...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Copyright
- Sommaire
- Remerciements
- Préface
- Une invitation
- PREMIÈRE PARTIE. TRANSFORMATIONS
- SECONDE PARTIE. MUTATIONS
- Des mêmes auteurs chez Odile Jacob
- Quatrième de couverture