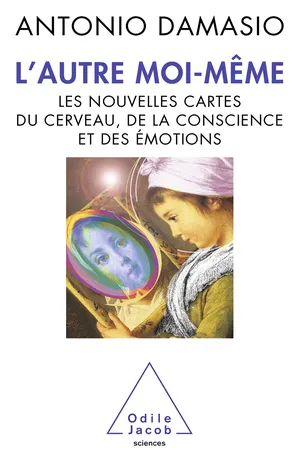
eBook - ePub
L' Autre moi-même
Les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions
- 416 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
L' Autre moi-même
Les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions
À propos de ce livre
« Mon âme est un orchestre caché, écrivait le poète Fernando Pessoa. Je ne me connais que comme symphonie. » D'où vient donc cette musique si particulière qui se joue en nous et nous accompagne à chaque moment ? D'où vient que nous soyons des êtres conscients, éprouvant toujours, dès que nous ouvrons les yeux et quoi que nous fassions, le sentiment inébranlable d'être toujours les mêmes ? Et quels sont, au tréfonds de nos cellules, les mécanismes qui permettent l'émergence de ce qu'il y a de plus humain en nous, nos sentiments, nos pensées, nos créations ?Antonio Damasio, l'un des spécialistes des neurosciences les plus importants et les plus originaux, lève ici le voile sur la fabrique de la conscience. Au sein du cerveau, bien sûr, et qui plus est dans ses parties les plus profondes, si intimement liées au corps et à la régulation de la vie biologique. Non, la conscience et le soi ne sont pas une « chose », une « substance », une « entité » en nous, comme on l'a longtemps postulé. Bien au contraire, ils forment un ensemble dynamique de processus nés petit à petit au fil de l'évolution biologique. Pour autant, les « naturaliser » ainsi, est-ce rabaisser l'homme ? Sûrement pas, pour Antonio Damasio, tant on peut s'émerveiller de la mécanique rendant possible la symphonie dont, à chaque instant de notre vie, nous sommes le chef d'orchestre. Une approche très originale, qui renouvelle en profondeur la science de la conscience. Antonio Damasio est professeur de neurosciences, de neurologie et de psychologie. Il dirige l'Institut du cerveau et de la créativité à l'Université de Californie du Sud et est professeur adjoint au Salk Institute de La Jolla. Ses ouvrages ont été traduits dans une trentaine de langues ; il est notamment l'auteur de L'Erreur de Descartes et de Spinoza avait raison, qui ont connu un immense succès.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à L' Autre moi-même par Antonio R. Damasio en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Psychologie et Neuropsychologie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Troisième partie
Être conscient
Chapitre 7
La conscience observée
Comment définir la conscience ?
Si vous ouvrez un dictionnaire classique en quête d’une définition de la conscience, vous aurez des chances de trouver une variante de ceci : « La conscience (consciousness) est l’état d’être au fait (awareness) de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. » Remplacez « être au fait » (awareness) par « connaissance » et « nous-mêmes » par « notre existence », et vous obtiendrez un énoncé qui résume certains aspects essentiels de la conscience : c’est un état de l’esprit dans lequel intervient une connaissance de notre existence et de celle de ce qui nous entoure. La conscience est un état de l’esprit – donc, s’il n’y a pas d’esprit, il n’y a pas non plus de conscience. C’est un état particulier de l’esprit, enrichi par le sentiment (sense) de l’organisme en particulier dans lequel l’esprit est à l’œuvre. Cet état de l’esprit comprend également une connaissance du fait que ladite existence est située, que des objets et des événements l’entourent. La conscience est un état de l’esprit auquel s’ajoute un processus du soi.
L’état conscient de l’esprit est vécu exclusivement à la première personne pour chacun de nos organismes ; il n’est jamais observable par quelqu’un d’autre. Cette expérience appartient en propre à chacun de nos organismes et non à d’autres. Mais le fait qu’elle soit exclusivement privée n’implique pas que nous ne puissions adopter un point de vue relativement « objectif » sur elle. Par exemple, c’est celui que je prends quand je tente de discerner les bases neurales du soi-objet, du moi matériel. Un moi matériel riche peut aussi procurer des connaissances à l’esprit. En d’autres termes, le soi-objet peut aussi être en position de propriétaire.
Nous pouvons étendre la définition présentée ci-dessus en disant que les états conscients de l’esprit ont toujours un contenu (ils portent sur quelque chose) et que certains d’entre eux tendent à être perçus comme des collections intégrées de parties (ce qui est le cas, par exemple, quand nous voyons et entendons à la fois une personne nous parler et s’approcher de nous) ; en disant que les états conscients de l’esprit ont des propriétés qualitatives distinctes qui sont relatives aux différents contenus qu’on connaît (il est qualitativement différent de voir ou d’écouter, de toucher ou de goûter) ; et en disant que les états conscients de l’esprit contiennent obligatoirement un aspect lié au sentiment : on les sent. Enfin, notre définition provisoire doit préciser que les états conscients de l’esprit ne sont possibles que lorsque nous sommes éveillés, même si une exception partielle à cette définition vaut pour la forme paradoxale de conscience qui apparaît quand nous dormons : à savoir dans le rêve. En conclusion, sous sa forme classique, la conscience est un état de l’esprit qui survient lorsque nous sommes éveillés et dans lequel se manifeste une connaissance privée et personnelle de notre existence, située relativement à ce qui l’entoure et à un moment donné. Nécessairement, les états conscients de l’esprit manipulent des connaissances fondées sur différents matériaux sensoriels – corporels, visuels, auditifs, etc. – et manifestent des propriétés qualitatives diverses pour les différentes voies sensorielles. Les états conscients de l’esprit sont sentis.
Quand je parle de la conscience, je ne me réfère pas seulement à la veille, confusion courante qui vient du fait qu’en son absence, il n’y a plus de conscience (j’aborderai ce point plus loin). La définition précise aussi que le terme conscience ne se réfère pas à un simple processus mental, sans soi. Malheureusement, confondre conscience et simple processus mental est une autre confusion courante. On se réfère souvent à « quelque chose qu’on a sur la conscience » pour dire qu’on a quelque chose « à l’esprit » ou que quelque chose domine les contenus mentaux, par exemple que « la question du réchauffement global a fini par pénétrer la conscience des nations occidentales ». Un nombre significatif de recherches en la matière traite la conscience comme l’esprit. Conscience (consciousness), tel que j’utilise ce terme dans ce livre, ne veut pas dire « conscience de soi » (self-consciousness), comme dans « Jean a pris de plus en plus conscience de lui-même à mesure qu’il réfléchissait sur lui », non plus que « conscience morale » (conscience), en tant que fonction complexe qui exige une conscience mais va bien au-delà et implique la responsabilité morale. Enfin, la définition ne renvoie pas à la conscience au sens ordinaire qu’elle prend dans l’expression de James « courant de conscience ». Cette formule est souvent censée désigner les simples contenus de l’esprit qui défilent dans le temps, comme l’eau dans le lit d’une rivière, plutôt que le fait que ces contenus incorporent des aspects subtils ou non de la subjectivité. Les références à la conscience dans le contexte des monologues de Shakespeare ou de Joyce utilisent souvent cette vision plus simple. Il est évident cependant que les auteurs originaux exploraient ce phénomène dans son sens plein, dans la perspective du soi d’un personnage, au point que Harold Bloom a suggéré que c’était Shakespeare qui avait introduit le phénomène de la conscience en littérature. (Cependant, James Wood a soutenu de façon tout aussi plausible qu’elle a pénétré la littérature par le monologue, mais bien plus tôt, dans la prière, par exemple, et dans la tragédie grecque90.)
La conscience isolée
Conscience et veille ne sont pas la même chose. Pour être conscient, il faut d’abord être éveillé. Qu’on s’endorme naturellement ou bien qu’on y soit forcé sous l’effet d’une anesthésie, la conscience disparaît sous sa forme normale, à la seule exception partielle de l’état conscient particulier qui accompagne les rêves et qui ne contredit nullement cette condition nécessaire de la veille, car la conscience du rêve n’est pas une conscience normale.
Nous avons tendance à voir dans la veille un phénomène binaire : zéro pour le sommeil, un pour l’état de veille. C’est juste dans une certaine mesure, mais cette approche tranchée cache des gradations que nous connaissons tous bien. Le fait d’avoir sommeil et de somnoler réduit certainement la conscience, mais ne l’annule pas abruptement. Le fait d’éteindre la lumière n’est pas une bonne analogie ; baisser très lentement un variateur serait plus proche du compte.
Que nous révèlent les lumières quand on les allume, soudain ou graduellement ? Le plus souvent, elles nous dévoilent quelque chose que nous décrivons couramment comme un « esprit » ou des « contenus mentaux ». Et de quoi cet esprit est-il fait ? De structures cartographiées dans l’idiome de tous les sens possibles – visuel, auditif, tactile, musculaire, viscéral –, selon des merveilles de nuances, de tons, de variations et de combinaisons, qui s’écoulent en ordre ou de façon embrouillée, bref d’images. J’ai présenté plus haut ma vision de l’origine des images (chapitre 3) et il suffit ici de nous rappeler qu’elles sont la monnaie de base de notre esprit et que ce terme se réfère à des structures relevant de toutes les modalités sensorielles, pas seulement visuelles, ainsi qu’à des structures abstraites aussi bien que concrètes.
Le simple acte physiologique d’allumer la lumière – de réveiller quelqu’un de sa sieste – se traduit-il nécessairement par un état de conscience ? Ce n’est pas le cas. Pas besoin d’aller très loin pour en trouver la preuve. Tout le monde s’est déjà réveillé épuisé et décalé, au-delà des mers et dans un pays lointain. Il faut alors deux ou trois secondes, pour comprendre exactement où on se trouve. Pendant ce court intervalle, l’esprit est bien là, mais pas encore organisé avec toutes les propriétés de la conscience. Et cela semble long, même si cela ne dure guère. Quand on perd conscience après avoir reçu un coup à la tête, il s’écoule aussi un délai dieu merci bref, mais tout de même mesurable, avant qu’on ne « revienne à soi ». C’est en fait un raccourci pour dire « revenir à la conscience », retrouver un esprit orienté sur soi. L’expression n’est pas très élégante, mais elle rend justice à la sagesse populaire. Dans le jargon neurologique, reprendre conscience après un traumatisme crânien peut prendre un bon moment, pendant lequel la victime n’est pas pleinement orientée, relativement à l’espace, au temps et à sa personne.
Ce qui se passe dans ces situations nous montre que les fonctions mentales complexes ne sont pas monolithiques et ne peuvent se morceler. Oui, la lumière est allumée et vous êtes réveillé (un point pour la conscience). Oui, l’esprit est là, des images se forment de ce qui se trouve devant vous, et des images revenant du passé s’intercalent entre elles (un demi-point pour la conscience). Mais non, rien ou presque n’indique qui est le propriétaire de cet esprit chancelant ; il n’y a pas de soi pour le revendiquer (pas de point pour la conscience). Au total, la conscience n’a pas gagné. Morale de l’histoire : pour qu’elle l’emporte, il est indispensable 1) d’être éveillé, 2) d’avoir un esprit qui fonctionne et 3) d’avoir dans cet esprit un sentiment automatique, spontané et immédiat de soi, en tant que protagoniste de l’expérience qu’on vit, quelle que soit la subtilité de ce sentiment de soi-même. Étant donné la présence de la veille et de l’esprit – tous deux nécessaires pour être conscient –, on pourrait dire, non sans lyrisme, que le trait distinctif de la conscience, c’est la pensée de soi-même. Sauf que, pour être plus précis, il faudrait dire « la pensée sentie de soi-même ».
Le fait que veille et conscience ne soient pas la même chose est évident lorsqu’on considère une maladie neurologique qu’on appelle état végétatif. Les patients ne montrent aucun signe de conscience. Comme dans la situation plus grave du coma, à laquelle il ressemble, les patients végétatifs ne parviennent à répondre à aucun message de la part de ceux qui les examinent et ne manifestent aucun signe spontané de conscience d’eux-mêmes ni de ce qui les entoure. Pourtant, leur électroencéphalogramme ou EEG (structures d’ondes électriques produites continuellement par un cerveau vivant) révèle une alternance de structures caractéristiques du sommeil ou de la veille. Quand, à l’EEG, ils ont une structure de veille, les patients ont souvent les yeux ouverts, même s’ils regardent dans le vide, sans diriger leur regard vers un objet en particulier. On ne note aucune structure électrique chez ceux qui sont dans le coma, situation dans laquelle tous les phénomènes associés à la conscience (veille, esprit et soi) semblent absents91.
Cette troublante maladie qu’est l’état végétatif fournit aussi des informations de valeur sur un autre aspect des distinctions auxquelles je suis en train de procéder. Dans une étude qui a beaucoup attiré l’attention, à juste titre, Adrian Owen a réussi à déterminer, grâce à l’IRMf, que le cerveau d’une femme en état végétatif avait des structures d’activité congruentes avec les questions que celui qui l’examinait lui posait et avec les requêtes qu’il lui adressait. Inutile de préciser qu’outre le diagnostic formel d’état végétatif, la patiente avait été diagnostiquée inconsciente. Elle ne répondait pas aux questions ou aux directions proposées, et elle ne manifestait pas spontanément de signe d’activité mentale. Et pourtant, l’étude à l’IRMf montrait que les régions auditives de ses cortex cérébraux devenaient actives lorsqu’on lui posait des questions. Leur structure d’activation ressemblait à ce qu’on peut voir chez un sujet conscient normal répondant à une question comparable. Plus impressionnant encore était le fait que, lorsqu’on demandait à la patiente d’imaginer qu’elle visitait sa maison, les cortex cérébraux de la région pariétale droite de son cerveau manifestaient une structure d’activité du type de ce qu’on peut trouver chez des sujets conscients normaux effectuant la même tâche. Si elle n’a pas fait preuve de la même structure, en d’autres occasions, un petit nombre d’autres patients ont été étudiés depuis, et on a observé une structure comparable, quoique pas à tous les coups92. L’un de ces patients, en particulier, était capable de susciter des réponses associées au « oui » ou au « non » après un entraînement répété93.
Cette étude indique que, même en l’absence complète de signes comportementaux de conscience, on en trouve du type d’activité cérébrale couramment corrélée avec les processus mentaux. En d’autres termes, l’observation directe du cerveau fournit des données compatibles avec une certaine préservation de la veille et de l’esprit, alors que les observations comportementales ne révèlent pas que la conscience, au sens décrit plus haut, accompagne de telles observations. Ces importants résultats peuvent s’interpréter avec parcimonie dans le contexte des nombreuses preuves selon lesquelles les processus mentaux opèrent de façon non consciente (comme on le montre au chapitre 11 et dans celui-ci). Ces découvertes sont certainement compatibles avec la présence d’un processus mental et même d’un processus minimal du soi. Quelle que soit leur importance, scientifiquement et en termes de soins médicaux, je ne considère pas toutefois qu’elles prouvent une communication consciente et qu’elles justifient d’abandonner la définition de la conscience présentée plus haut.
Plus de soi, mais toujours un esprit
Les preuves peut-être les plus convaincantes en faveur de la dissociation entre la veille et l’esprit, d’un côté, et le soi, de l’autre, viennent d’une autre affection neurologique, la paralysie épileptique, qui peut faire suite à certaines crises d’épilepsie. Dans ce cas, le comportement du patient est interrompu soudainement pendant un bref laps de temps durant lequel l’action se fige complètement. Vient ensuite une période, en général tout aussi brève, pendant laquelle il reprend un comportement actif, mais ne donne pas de signe d’un état de conscience normal. Il peut se déplacer en silence, mais ses actions, comme de dire au revoir ou de quitter une pièce, semblent dépourvues de but. Elles peuvent cependant recéler un « mini-objectif », comme de prendre un verre d’eau et de le boire, mais il ne paraît pas s’intégrer à un contexte plus vaste. Aucune tentative n’est effectuée pour communiquer avec l’observateur et aucune réponse n’est donnée à celles de ce dernier.
Si vous vous rendez dans le bureau d’un médecin, votre comportement s’inscrit dans un contexte général qui a à voir avec les buts spécifiques de cette visite, le plan global que vous avez pour la journée, le lieu de cette visite, ainsi que les intentions et les plans plus larges que vous nourrissez dans votre vie, à diverses échelles de temps, relativement auxquels votre visite peut avoir ou non une signification. Tout ce que vous faites durant cette « scène » dans le bureau est informé par ces multiples niveaux de connaissance, même s’il n’est pas indispensable que vous ayez en tête tous ces contenus explicites pour vous comporter de façon cohérente. De même pour le médecin, eu égard à son rôle dans la scène. En état de conscience atténuée, tout cet arrière-fond qui vous influence normalement se trouve réduit à presque rien. Le comportement est désormais contrôlé par des signaux immédiats, qui ne sont pas insérés dans le contexte plus large. Par exemple, prendre un verre et le boire a du sens si vous avez soif, mais il n’est pas nécessaire que cette action soit liée au contexte plus général.
Je me rappelle le tout premier patient dans cet état que j’ai pu observer parce que son comportement était nouveau, inattendu et gênant pour moi. Au milieu de notre conversation, il a cessé de parler et a suspendu tout mouvement. Son visage a perdu son expression et ses yeux se sont mis à regarder à travers moi le mur derrière. Il est resté immobile pendant plusieurs secondes. Il n’est pas tombé de sa chaise, ne s’est pas endormi, n’a pas été pris de convulsions ni de tics. Quand j’ai prononcé son nom, il n’a pas répondu. Quand il a recommencé à bouger, un petit peu, ses lèvres se sont décollées. Son regard a glissé pour se concentrer momentanément sur une tasse de café qui se trouvait posée sur la table, entre nous. Elle était vide, mais il l’a tout de même attrapée et a tenté de la boire. Je me suis adressé à lui, encore et encore, mais il n’a pas répondu. Je lui ai demandé ce qui se passait : pas de réponse. Son visage était toujours inexpressif et il ne me regardait pas. Je l’ai appelé par son nom : pas de réponse non plus. Finalement, il s’est dressé sur ses pieds, s’est tourné et s’est mis à lentement marcher vers la porte. Quand je l’ai appelé, il s’est arrêté et m’a regardé, d’un air perplexe. Je l’ai appelé à nouveau et, cette fois, il a dit : « Quoi ? »
Ce patient avait souffert d’une absence (l’un des divers types de crises d’épilepsie), suivie d’une période de paralysie. Il était là et pas là, éveillé et en action, en partie attentif, présent par le corps, mais ce n’était plus une personne. Des années plus tard, j’ai écrit qu’il était « absent mais toujours là », et cette description est toujours valable94.
Cet homme était sans nul doute éveillé au sens plein du terme. Ses yeux étaient ouverts et son tonus musculaire lui permettait de se déplacer. Il pouvait assurément reproduire des actions, mais sans qu’elles possèdent un plan organisé. Il n’y avait pas d’objectif global, pas de prise en compte des conditions propres à la situation, pas de pertinence. Ses actes n’étaient cohérents qu’à un niveau minimal. Sans nul doute aussi son cerveau formait-il des images mentales, quoiqu’on ne parierait pas sur leur abondance ni sur leur cohérence. Afin qu’il atteigne la tasse, la saisisse, la porte à ses lèvres et la replace sur la table, son cerveau a dû former des images, et même beaucoup, du moins visuelles, kinest...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Du même auteur
- Dédicace
- Première partie - Redémarrage
- Deuxième partie - L’esprit dans le cerveau
- Troisième partie - Être conscient
- Quatrième partie - Longtemps après l’apparition de la conscience
- Appendice
- Notes
- Remerciements