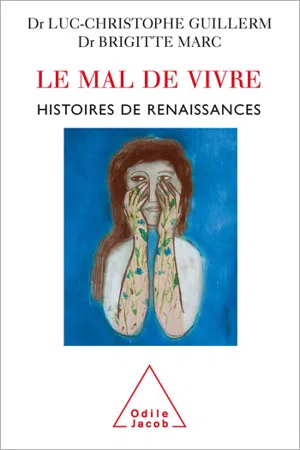
- 288 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
« Je voulais dormir », « je voulais oublier », « je ne voulais plus vivre »… Chaque année en France, les tentatives de suicide par médicaments concernent plus de 150 000 personnes et autant de familles. Tous les suicidants ressentent un réel mal de vivre : dépression, angoisse, découragement, accumulation de problèmes, situations d'impasse ou effondrement de l'estime de soi… Mais mal de vivre ne signifie pas pour autant désir de mourir. La personne qui fait une tentative de suicide avec des médicaments tente aussi de signifier quelque chose par son geste, de trouver un soutien. Comment redonner espoir et goût à la vie ? À travers de nombreux témoignages de personnes suicidaires, deux psychiatres nous donnent leurs conseils pour mieux comprendre, mieux écouter et mieux aider. Parce qu'une réponse adaptée peut contribuer à une véritable renaissance. Luc-Christophe Guillerm est médecin psychiatre à Brest. Il exerce dans une clinique psychiatrique, en particulier dans une unité d'hospitalisation de crise. Brigitte Marc est médecin psychiatre et pédopsychiatre à Brest. Elle a travaillé plusieurs années aux urgences psychiatriques de Nantes.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Le Mal de vivre par Luc-Christophe Guillerm,Brigitte Marc en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Psychologie et Psychopathologie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Deuxième partie
Un geste
difficile à comprendre
difficile à comprendre
Chapitre 5
Une question de pulsions ?
« Je ne sais pas pourquoi, mais dès que j’ai un échec, dès que l’on me dévalorise, j’ai une envie immédiate et non réfléchie d’avaler des médicaments. »
Un jeune homme de 23 ans parle ainsi de ses trois intoxications médicamenteuses volontaires en quatre ans, survenues à chaque fois sur ce qui ressemble communément à un coup de tête. Très lucide sur ces moments intenses, il évoque lui-même une sorte de pulsion qu’il ne parvient pas toujours à refréner et qu’il relie sans discussion à une envie de mourir et à une interprétation négative d’une situation que bien d’autres parviendraient à gérer. Une remarque désobligeante, un échec, une mauvaise note, en fait tout ce qui accentue la vision négative qu’il a de lui-même. La question des pulsions s’articule avec la question de la motivation du geste, en particulier celle de l’évaluation du désir de mort.
Des propos ambivalents
Lors des premiers entretiens suivant le réveil aux urgences, les soignants sont généralement étonnés par le discours ambivalent des patients, et l’évaluation du désir de mort est souvent extrêmement ardue. En effet, le patient manifeste un discours d’après coup qui s’attache principalement à raconter l’événement déclenchant. Les propos s’embrouillent allègrement, mêlés aux instants confus du réveil, et les intentions exactes du geste ne sont guère évaluables. Intentions de mort, désir d’oublier, regrets de s’être manqué, mais aussi souvent regrets d’avoir voulu mourir et incompréhension de son propre geste. Parfois même, le rescapé mélange sans vraiment en prendre conscience toutes ces impressions. Cliniquement, il apparaît une sorte de balance plus ou moins stable entre les désirs de mort et de vie. Comment évaluer alors ce « désir » de mort ? C’est en effet bien souvent la première question que se pose le médecin ou le psychologue dans ce contexte.
Entre le moment du passage à l’acte et les entretiens du réveil, plusieurs remaniements se sont produits, en particulier au niveau de ce que l’on appelle le Moi. À l’évidence, l’individu n’est plus exactement le même à son réveil et ceci peut être un élément perturbateur pour l’évaluation objective du désir de mort. « Au moment du réveil, écrivent ainsi Jean-Claude Rolland et Olivier Quenard21, le Moi qui parle est un Moi de nouveau en vie qui a triomphé de la mort et qui n’a plus rien à voir avec le Moi menacé et débordé par la tendance suicidaire. […] Le sujet va tendre à reconstruire l’événement suicidaire à la lumière de son statut de vainqueur, […] minimisant l’importance de l’ordalie, et surtout l’importance du danger de mort, jusqu’à un point où celle-ci peut être complètement déniée. » ce déni est effectivement fréquemment retrouvé dans le discours du réveil à travers de nombreuses expressions comme : « Je voulais dormir », « Je voulais oublier », « je voulais me calmer. » Ce déni risque de générer, ou peut-être ne fait-il simplement que les révéler, une banalisation et une minimisation de la prise du médicament, surtout s’il n’existe aucune séquelle physique comme c’est le cas habituellement. Il est alors bien fréquent d’aboutir à une conduite d’annulation magique, dans laquelle la seule demande formulée par le patient est celle de sa sortie immédiate. Banalisation et minimisation ne sont pas le fait exclusif des patients ; l’entourage y participe volontiers, se défendant ainsi en quelque sorte d’un sentiment de culpabilité que l’intoxication médicamenteuse volontaire éveille en lui. De la même façon, d’ailleurs, l’institution soignante peut avoir tendance à banaliser ce geste.
Freud et le suicide
Si l’on examine le discours du réveil, on constate aisément que les patients affirment avec ambivalence leur désir de mort, essentiellement car ce discours vient après coup et après les remaniements du Moi dont nous venons de parler. En fait, « le désir de mort n’est jamais univoque, mais est toujours l’un des termes d’une ambivalence réalisée avec plus ou moins de violence, […] ambivalence vie-mort qui renvoie sans doute à l’ambivalence du conflit devenu invivable pour le sujet, et qui envahit tout son champ de perception », écrivent Jacques Vedrinne et Jean-Pierre Soubrier. Le concept de mort est bien plus souvent associé à des idées de paix, de sommeil, de renouveau, voire de renaissance. En fait, « l’aspect définitif de la mort est le plus souvent évacué, et lorsqu’il est envisagé, il n’entraîne pas l’angoisse qui lui est habituellement corrélée22 ». La réalité de la mort, de la destruction corporelle, n’est bien souvent pas représentée par les suicidants au moment où ils décident d’absorber leur traitement.
En fait, nous avons l’impression que le sujet est pris dans un mouvement de va-et-vient, de flux et de reflux. La balance oscillerait du côté « mort » lors du passage à l’acte et reviendrait parfois du côté « vie » lors de la prise de conscience du geste lui-même, le sujet prévenant ainsi, bien souvent, l’entourage. Derrière cette balance vie-mort qui apparaît cliniquement, certains ont voulu, dans la continuité de Sigmund Freud, y associer les concepts de pulsion de vie et pulsion de mort.
Dans un premier temps (1915), lorsque Freud se réfère à une pulsion, il considère la pulsion sexuelle. Il oppose alors les pulsions d’autoconservation, situées du côté du principe de réalité, aux pulsions sexuelles, situées du côté du principe de plaisir. Dans Deuil et Mélancolie (1917), Freud s’interroge sur ce qui peut pousser un sujet jusqu’à l’autodestruction23 : « Nous avons reconnu comme état originaire d’où part la vie pulsionnelle, un amour si considérable du Moi pour lui-même, nous voyons se libérer, dans l’angoisse qui se manifeste quand la vie est menacée, une charge si gigantesque de libido narcissique, que nous ne saisissons pas comment ce Moi peut consentir à son autodestruction. » Puis, après 1920, il introduit un nouveau dualisme, pulsion de mort et pulsion de vie. Cette pulsion de mort « représente la tendance fondamentale de tout être vivant à retourner à l’état anorganique24 », c’est-à-dire tend à la réduction complète des tensions vers un retour à un état antérieur. Cette pulsion de mort est assimilée également à une sorte de « pulsion de paix ».
Les pulsions d’autoconservation
Si la notion de pulsion de mort demeure l’une des théories freudiennes les plus controversées, le concept d’autoconservation se révèle à l’inverse particulièrement pertinent. Pour Jean-Claude Rolland et Olivier Quenard, ces pulsions, que l’on pourrait rapprocher du concept d’instinct de survie, seraient sidérées chez certaines personnes, par exemple lors de circonstances de vie difficiles, favorisant alors le passage à l’acte suicidaire. La distinction avec le concept de pulsion de mort est essentielle : quand nous évoquons un mal de vivre, nous considérons qu’il ne s’agit pas pour autant nécessairement d’un désir de mort. La sidération de ces pulsions d’autoconservation génère un désinvestissement narcissique de « ce Moi qui n’est soudain plus aimé » et « perd, au fond, toute sa substance et du coup, toute capacité de résistance25 ». Le désir de mort n’est pas tant celui d’une mort physique que celui de la mort symbolique d’un personnage qui souffre et vit une situation d’impasse, et souhaiterait, inconsciemment bien évidemment, renaître autrement, parfois simplement voir ses souffrances s’apaiser, souvent retrouver autour de lui un environnement concerné par ses difficultés et prêt à le soutenir. Plus que tout autre moyen de tentative de suicide, l’intoxication médicamenteuse volontaire témoigne d’un désir d’échapper à la réalité traumatique et de se retirer du monde extérieur, avec le risque très mal évalué que ce retrait ne soit définitif. L’ambivalence des propos des suicidants au réveil tient peut-être dans cette distinction vis-à-vis de ce que représente le concept de mort, mort physique ou mort symbolique.
Acting-out et passage à l’acte
Dans la pratique quotidienne, les patients évoquent assez souvent cette notion de pulsion, sans qu’il s’agisse nécessairement des mêmes pulsions que nous venons d’évoquer. En effet, en dehors des pathologies psychiatriques, un grand nombre d’intoxications médicamenteuses volontaires s’effectuent de manière impulsive, brutale, presque non mentalisée ; un simple événement peut suffire à déclencher un geste, tels une dispute, un échec, une contrariété. Il s’agit d’une des caractéristiques fréquentes des intoxications médicamenteuses volontaires. Classiquement, on distingue à ce titre deux concepts sémantiques : celui d’« acting-out » qui est une conduite proche du symptôme et visant à montrer quelque chose à autrui, et celui de « passage à l’acte » qui ne s’adresserait à personne et n’attendrait aucune interprétation ; l’un serait en attente d’un décryptage par autrui (l’acting-out), alors que le second se situerait sur un versant d’irréversibilité. La nuance est fondamentale et essentielle dans la prise en charge et la gravité potentielle des intoxications médicamenteuses volontaires, car la dimension de message crypté positionne différemment l’individu face au désir de mort au moment où s’effectue le geste. Dans l’urgence, la différence entre les deux est difficile, d’où l’intérêt de se donner quelques jours avant d’inscrire le geste dans l’histoire d’un patient. Pourtant, le travail ne sera pas le même dans les deux cas : le passage à l’acte témoigne d’une souffrance psychique non verbalisable et d’une incapacité de symbolisation, et il est souvent difficile de travailler sur le discours ; avec l’acting-out, « nous travaillons à aider le sujet à inscrire son mal-être dans un discours, tout autant que nous approfondissons à qui ce discours peut bien s’adresser26 », et ce travail peut, dans une conception d’intervention de crise, déboucher sur des hypothèses de travail. Dans tous ces cas, il n’est pas nécessaire de parvenir à un état dépressif pour voir un individu absorber une dose toxique de médicaments ; un événement précipitant peut suffire dans un contexte de vulnérabilité.
Deux situations cliniques
Dans un autre registre, certaines situations évoluent de manière linéaire vers le découragement, le désespoir, le pessimisme, fréquemment des états dépressifs ou encore vers un sentiment très fort d’impasse. Dans ces cas, on a l’impression que la balance dont nous parlions précédemment penche vers le désir de mort plus par déficit de ces pulsions de vie, ou encore des pulsions d’autoconservation, que par accentuation des pulsions de mort. La clinique psychiatrique des intoxications médicamenteuses volontaires laisserait assez facilement penser qu’il existe deux phénomènes pulsionnels sous-jacents : d’un côté une pathologie de l’impulsivité, d’un autre une pathologie de l’effondrement progressif des instincts de conservation, ou encore peut-être de ce que l’on appelle l’instinct de survie. Dans les deux cas, le geste s’inscrit, non seulement dans une conception pulsionnelle (le moment du geste), mais également dans un contexte de vulnérabilité. La tendance à l’impulsivité témoigne d’une intolérance aux déceptions, aux frustrations, aux pertes, comme c’est le cas dans les états-limites par exemple ; l’affaiblissement des énergies vitales peut témoigner d’une certaine dépressivité, d’un état d’esprit ressemblant au Taedum Vitae des philosophes, d’une fatigue de la vie, d’un épuisement, d’un manque de capacité projective, ou encore d’un manque d’estime de soi. Joseph Conrad disait à ce sujet : « Il me semble que le suicide est souvent l’aboutissement d’un simple épuisement mental, non pas un geste désespéré, mais le symptôme final d’un effondrement complet. »
Pourquoi certains passent à l’acte tandis que d’autres résistent ?
Cette approche théorique des pulsions est insuffisante à elle seule car elle n’explique pas la résistance de certains et la fragilité d’autres face aux difficultés de la vie, face au mal de vivre. Pourquoi, après tout, deux sujets placés dans les mêmes conditions de vie et d’événements n’auront pas la même réaction face au suicide ? Le concept d’étayage, tel que l’entend Winnicott, est peut-être pertinent ici. De manière triviale, les pulsions constituent une sorte de bouillonnement intérieur et tempétueux qui demande à être canalisé, tel un fleuve qui rencontrerait un barrage plus ou moins solide face à lui. Ce barrage pourrait être assimilé au concept de « défenses psychiques ». Cet étayage fonctionne alors comme le soutien d’une construction, mais il se fonde sur deux niveaux : un niveau ancien, fonction de l’environnement intime du nourrisson et de l’enfant ; un niveau plus actuel, fondé, lui, sur les étayages dont l’adulte peut avoir besoin et qui sont plus du ressort du cadre environnemental. Quand les étayages familiaux ont été présents et efficaces, les événements de vie auront un impact moins destructeur car l’adulte aura appris durant ses premières années ce qu’est la notion de sécurité de base et d’individuation, c’est-à-dire la capacité à vivre et à réagir comme un être autonome qui n’a plus besoin de béquille psychique, un être qui contrôle ses émotions, ses pulsions, ses mouvements intérieurs inconscients, un être qui peut tolérer les absences et les pertes sans vouloir disparaître. L’étayage parental permet de contenir les emballements pulsionnels. La littérature psychiatrique met en évidence la fréquence de facteurs d’instabilité dans le passé des individus suicidants, qu’il s’agisse d’une grande fréquence de pertes précoces (décès, séparation, divorce), d’une instabilité psychologique des parents, de suicide ou tentatives de suicide d’un parent, ou de maltraitances physique ou sexuelle. L’impulsivité de certains passages à l’acte correspond souvent à une manière apprise de réagir aux contrariétés, aux déceptions, aux pertes. Si l’enfant ne trouve pas de rempart solide face à l’émergence de ses pulsions et de ses angoisses, il risque fort de retrouver à l’âge adulte une manière inadéquate de réagir face aux difficultés de la vie.
Néanmoins, l’impact des événements de vie pourra aussi être différemment partagé en fonction des étayages actuels de l’individu, fondés sur plusieurs éléments : l’équilibre familial, les soutiens amicaux, le réseau social, la stabilité de la société, la solidité des cadres environnementaux (travail, valeurs de la société). Nous avons ici la confrontation entre un cadre symbolique et imaginaire, inconscient, et un autre qui s’ancrerait plus dans le réel. Ces deux fondations sont essentielles et complémentaires. Elles expliquent à la fois qu’un défaut d’étayage de l’enfance puisse parfois se compenser par un étayage environnemental (éducateurs, soutiens, amis), mais également qu’un étayage normal de l’enfance puisse être débordé par des événements de vie intenses, par exemple s’ils surviennent dans une période déstructurée du sujet (chômage, solitude, maladie, perte des valeurs de l’environnement…).
Ceci est particulièrement significatif dans ces intoxications médicamenteuses volontaires consécutives à un vécu d’impasse et d’épuisement face à une situation qui perdure et résiste à toute solution. Ces cas sont fréquemment retrouvés d’individus ayant finalement décidé d’absorber des médicaments après avoir lutté plusieurs mois pour régler des situations de vie compliquées, et qui vivent ou ressentent leur situation comme insoluble. Le cas des mésententes conjugales est fréquemment de ce registre, avec plusieurs phases évolutives, mêlées d’espoir, de tentatives de réconciliation, mais aussi de phases de disputes ou d’incompréhension qui peuvent envahir de plus en plus la vie quotidienne. Tout en doutant de leur amour pour l’autre, des sentiments ambivalents peuvent surgir, avec la volonté de lutter, pour les enfants, pour éviter un divorce, mais aussi celle d’abandonner, car toutes les solutions ont été essayées. Avec le temps et la répétition des soucis, le découragement pointe de plus en plus nettement, prenant une teinte vaguement dépressive. Au fur et à mesure que le sujet écluse ses solutions, le sentiment d’impasse devient prévalent, associé au pessimisme, parfois à un sentiment d’absurdité et de vide affectif. Les actes et pensées du sujet semblent ne plus avoir de sens. Si le réseau social et affectif est de surcroît défaillant, l’effondrement peut succéder à cette apparente résistance. Une petite étincelle peut alors suffire chez cette personne de plus en démunie, faisant écran à une situation dégradée depuis longtemps. L’intoxication médicamenteuse volontaire est parfois le dernier recours, sans qu’il s’agisse pour autant d’une envie de mort mais plutôt, très souvent, d’une conduite d’abandon au destin et à la bienveillance d’autrui.
Finalement, ce ne sera pas réellement l’aspect qualitatif de l’événement qui comptera, mais bien plus l’aspect qualitatif de l’environnement qui étaye le sujet, contrôle ses mouvements d’angoisse et donne parfois un sens à la recherche d...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Introduction
- Entre vie et mort
- Un geste difficile à comprendre
- Le temps du dialogue et de la reconstruction
- Notes
- Références bibliographiques
- Remerciements
- Autres livres de Luc-Christophe Guillerm