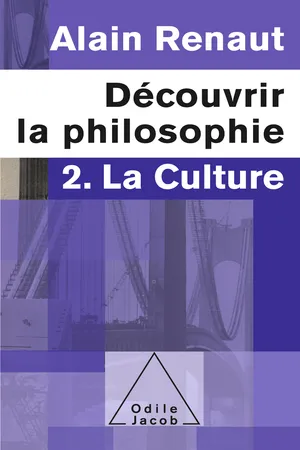
- 320 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Découvrir la philosophie 2 : La Culture
À propos de ce livre
En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie. Constitué d'une série de leçons que l'on peut lire dans l'ordre que l'on voudra, selon ses goûts, ses besoins ou ses choix, chaque volume présente les œuvres des plus grands penseurs, des classiques aux contemporains. Il ne traite pas seulement de l'histoire de la philosophie, mais aborde des questions liées aux grands sujets actuels : biologie, astronomie, éthique, anthropologie, religion, etc. Pour le lecteur curieux de s'initier, pour l'élève et l'étudiant soucieux de compléter sa formation, un panorama des grandes questions philosophiques mêlant histoire de la pensée et problématiques d'aujourd'hui. Alain Renaut est professeur à l'université Paris-VI, titulaire de la chaire de philosophie morale et politique.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Découvrir la philosophie 2 : La Culture par Alain Renaut en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Philosophie et Histoire et théorie de la philosophie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
Le langage
I. Le problème : quelle place pour la philosophie du langage ?
Le langage constitue l’un de ces objets vis-à-vis desquels la philosophie se trouve en situation de concurrence objective avec d’autres disciplines, comme la philologie et, plus récemment, la linguistique, qui ont revendiqué cet objet comme étant, d’une certaine façon, le leur propre. Avant de s’affronter aux questions que soulève le langage, la philosophie se doit donc dans un premier temps de justifier ici sa légitimité face à ses rivales. Non point certes pour leur dénier le droit d’aborder ce champ d’investigation, mais pour manifester qu’elle tient là elle aussi un terrain sur lequel ses compétences et interrogations spécifiques possèdent une forme de pertinence. Ainsi est-il à sa charge, tout en intégrant les apports d’autres disciplines traitant du langage, de spécifier d’abord son questionnement dans ce domaine, en vue d’en faire ressortir ce qui le différencie d’autres types de recherche et continue de nourrir une approche indispensable.
1 – PHILOSOPHIE DU LANGAGE ET PHILOLOGIE
La concurrence éventuelle entre la philosophie du langage et la philologie, si elle est la plus ancienne, n’est pas aujourd’hui celle qui crée le plus de difficultés.
Platon, dans La République (IX, 582 e), rapproche certes déjà le philosophe et le philologue, le philosophos et le philologos : l’ami de la sagesse, explique-t-il, est aussi l’ami du logos, l’ami du raisonnement certes, mais aussi (puisque le terme grec de logos a cette double signification) celui du langage. Si tout homme utilise en effet le langage, il appartient au philosophe de se demander, comme le fait ici Platon, quelle espèce d’hommes « tient le langage le plus véridique » : interrogation qui conduit nécessairement le philosophe, à partir de sa propre enquête sur la vérité (voir : t. 3, « La vérité »), à se poser le problème du « langage vrai ». Plus largement, cela le conduit à se demander ce qui peut faire que le langage énonce aussi bien du vrai que du faux. C’est ce problème que Platon traite, nous y reviendrons, dans le Cratyle, en grande partie pour distinguer l’usage que le philosophe doit faire du langage et celui qu’en faisaient les sophistes, plutôt (du moins selon le reproche que leur a adressé Socrate) pour persuader les esprits et acquérir ainsi du pouvoir qu’en vue d’accéder à la vérité.
Dans cette appréhension du philosophe comme étant aussi philologue, rien ne menace toutefois la philosophie d’entrer en relation de rivalité avec le type d’étude du langage qu’est devenue depuis lors la philologie et que Platon n’envisageait pas encore.
C’est en effet à peu près un siècle plus tard, au IIIe siècle avant notre ère, que la philologie telle que nous l’entendons s’est constituée, à Alexandrie. Elle apparut comme une discipline dont l’objet est d’étudier les textes, surtout littéraires, produits dans une langue devenue, par son ancienneté, malaisément accessible. Il s’agissait alors de pouvoir continuer à comprendre les poèmes homériques, transmis oralement depuis cinq ou six siècles dans un grec fort différent de celui de l’époque. Pour en fixer une transcription écrite, il fallait en étudier avec rigueur les mots, les tournures et les règles syntaxiques.
Une situation analogue s’est produite lors de la Renaissance. La volonté de retrouver les grands enseignements de la culture antique a fourni l’occasion de poursuivre l’élaboration d’une philologie ayant pour vocation l’étude scientifique des textes du passé. Discipline passionnante, en particulier par sa capacité de nourrir une réflexion sur la question des cultures (voir : t. 4, « La société », L, III), qui trouvent dans les langues un lieu de sédimentation. Mais c’est une discipline par rapport à laquelle la philosophie du langage, si elle peut continuer à prendre pour problématique directrice celle du « langage vrai », n’éprouvera aucun mal à se distinguer. Il lui faut simplement pour cela faire valoir un principe de sage division des tâches concernant l’étude du langage.
Dans cette délimitation intervenue aisément entre philosophie du langage et philologie, on voit cependant poindre un motif de conflit et de rivalité qui ne prendra toute son ampleur que dans un autre contexte beaucoup plus contemporain : il s’agira pour la philosophie de confronter son approche du langage et celle de la linguistique. Ce qui émerge en effet déjà avec la philologie, c’est la perspective d’une connaissance scientifique de ce qui touche au langage. Cette perspective s’est trouvée renforcée, au tournant du XIXe au XXe siècle, par la mise en œuvre, sous le nom de linguistique, du projet d’une connaissance objective et systématique de la réalité des faits de langage.
2 – PHILOSOPHIE DU LANGAGE ET LINGUISTIQUE
Le nom de Ferdinand de Saussure reste associé à ce qui se présenta comme une véritable révolution dans les recherches sur le langage. On se demandera plus attentivement, ci-dessous, comment apprécier aujourd’hui la portée de cette révolution. D’un point de vue méthodologique, elle consista en tout cas pour l’essentiel, négativement, à mettre entre parenthèses certaines questions privilégiées par la philosophie. Ainsi procéda-t-on avec la question de l’origine des langues. Au compte du fait qu’il n’en est pas de traitement scientifique possible et qu’elle ouvre sur de pures spéculations métaphysiques, elle se trouva exclue de la nouvelle discipline.
Plutôt que de spéculer sur l’invention du langage ou sur l’« exactitude des noms », Saussure confia à la linguistique une tâche exclusive : décrire le fonctionnement du langage compris comme instrument de communication. Il s’agissait désormais de partir des « faits de langage » pour dégager uniquement les structures qui ont une fonction universelle dans la communication langagière. Plus précisément, chez Saussure, la décision de faire de la linguistique la forme la plus accomplie d’une approche scientifique du langage entraîne au moins trois options méthodologiques constitutives de la scientificité ainsi revendiquée (ces trois options sont exprimées dans l’Introduction du Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1960, p. 13-61, dont sont tirés tous les textes cités dans l’analyse de ces options) :
1. Parmi les diverses manifestations du langage humain comme moyen d’expression, on prendra soin de « se placer de prime abord sur le terrain de la langue et de la prendre pour norme de toutes les autres manifestations du langage ». Dans les faits de langage, on privilégiera donc les « faits de langue ». La langue n’est certes qu’une dimension de la faculté du langage, puisque l’être humain peut s’exprimer avant de maîtriser une langue ou autrement qu’en recourant à une quelconque langue. Néanmoins, « le langage échappant le plus souvent à l’observation », son étude rigoureuse requiert de privilégier la manière dont cette faculté s’incarne dans des faits qui sont susceptibles d’être décrits de façon objective. À savoir les « faits de langue » qui, par leur répétition et par leur inscription dans de vastes ensembles (les sociétés), sont ceux qui se prêtent le mieux à une investigation scientifique.
2. Parmi les faits de langue eux-mêmes, on fera en sorte d’isoler la langue de la parole. S’il s’agit en effet, pour la linguistique comme pour toute science, de dégager les « lois générales auxquelles on peut ramener » tous les phénomènes particuliers mettant en jeu la faculté du langage, il ne faut retenir des faits de langue que « les forces qui sont en jeu d’une manière permanente et universelle dans toutes les langues ». Pour y parvenir, on mettra donc le plus possible entre parenthèses, dans les produits de la faculté du langage, ce qui appartient au « domaine individuel ». Notamment : tout ce qui relève du « sujet parlant » et porte la marque de l’individu (le « locuteur ») qui utilise le code de la langue pour exprimer sa pensée personnelle. En procédant à une telle séparation méthodique de la langue vis-à-vis de la parole, « on sépare du même coup ce qui est social de ce qui est individuel ». On élimine « ce qui est accessoire et plus ou moins accidentel » pour faire surgir « ce qui est essentiel ». Ainsi seulement se trouverait remplie cette condition de la scientificité selon laquelle « il n’y a de science que du général », comme on le sait au moins depuis l’antique formule d’Aristote.
3. Constituée, par sa distinction d’avec la parole, comme « un objet qu’on peut étudier séparément », la langue doit être enfin, pour pouvoir être étudiée scientifiquement, considérée exclusivement comme un système de signes. Dans l’acte individuel qui fait intervenir la parole, il faut en effet au minimum deux individus A et B. Dans le cerveau de l’un des deux (A) doivent surgir des « faits de conscience » qui se trouvent associés alors à des « images acoustiques servant à leur expression ». La combinaison de ce « fait de conscience » (que Saussure nomme aussi « concept ») et de l’image acoustique qui l’exprime constitue un « signe linguistique ». On y reviendra ci-dessous, mais il faut déjà noter que, dans cette définition saussurienne du signe, la relation que privilégie la linguistique est ainsi celle qui s’instaure, au sein du signe, entre le « signifié » (le concept) et le « signifiant » (l’image acoustique). Ce n’est donc pas celle qui unit un nom à la chose qu’il désigne (et qu’on appelle son « référent »). Aussi est-ce le processus de signification, interne à la sphère du langage, que la linguistique choisit d’étudier, au détriment de l’interrogation sur la relation entre le langage et les choses elles-mêmes.
Considéré à partir de ces options de méthode, le « circuit de la parole », qui fait qu’il y a communication, apparaît alors comme combinant deux processus :
- Un premier processus est actif. C’est celui de la phonation. Il conduit du cerveau de A jusqu’à l’oreille de B. Chez A, le cerveau transmet aux organes de la phonation une impulsion qui correspond au concept et qui met le concept (signifié) en image acoustique (signifiant). Cette image acoustique est encore purement psychique : elle est l’empreinte psychique ou la représentation d’un son. Cette image (qu’il nous arrive d’évoquer pour nous-mêmes, sans parler, par exemple quand nous récitons silencieusement un poème) peut se traduire physiquement par un son matériel se propageant sous forme d’ondes de la bouche de A jusqu’à l’oreille de B.
- Le second processus est passif. C’est celui de l’audition. Il conduit de l’oreille de B jusqu’à son cerveau : le son entendu fait surgir en lui l’image acoustique qui est associée dans son cerveau au concept correspondant. Ce concept se trouve ainsi éveillé en lui : la communication a eu lieu.
Dans cette trajectoire complexe, ce que la linguistique choisit d’étudier, c’est à vrai dire ce qui est le plus mystérieux : qui peut faire qu’à la faveur de tels circuits, chez les individus parvenant à communiquer par une même langue, tous associent à peu près les mêmes images aux mêmes concepts et, de ce fait, comprennent en général les signes qu’ils échangent. Pour ce faire, la discipline dont Saussure a thématisé le projet choisit méthodiquement de concentrer son attention sur le processus passif, où l’individu intervient le moins. Dans le processus actif de phonation, ce qu’il y a d’individuel dans la parole prend davantage d’importance (à travers le choix des expressions, la façon de les combiner, la manière de prononcer les sons exprimant les concepts). En revanche, dans l’audition, ce qui prime, c’est bel et bien la partie sociale du langage, extérieure à l’individu. Nous enregistrons en général, passivement, ce que nous transmettent tous les individus, quels qu’ils soient, appartenant à une même communauté linguistique. C’est donc à ce niveau que nous pouvons le mieux cerner « le lien social qui constitue la langue ».
En conséquence, ce qu’il faut étudier, c’est la manière dont la langue, dépôt des images acoustiques emmagasinées chez tous les individus qui la parlent, forme un système de signes permettant de communiquer des idées. Il y a là, indépendamment de la parole elle-même (puisqu’un homme peut conserver sa langue tout en se trouvant privé de l’usage de la parole), un ensemble d’associations qui précède l’usage que les individus peuvent en faire. La preuve en est d’ailleurs que c’est au terme d’un apprentissage que les individus parviennent à en maîtriser le jeu. Si la linguistique entend aborder scientifiquement le langage, c’est donc le fonctionnement de ces associations implicitement ratifiées par le consentement collectif qu’il lui faut étudier. Elle l’aborde au fond comme si un contrat se trouvait passé à cet égard, autour d’un tel système de signes, entre les membres d’une communauté. C’est la raison pour laquelle Saussure voit dans la linguistique une dimension de ce qu’il appelle la « sémiologie », dont il fait une discipline beaucoup plus vaste.
La sémiologie (qu’on appelle aussi sémiotique) est en effet définie par Saussure comme la « science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ». Elle a pour but de dégager en quoi consistent ces signes et quelles lois en régissent le fonctionnement. Comme science des systèmes de signes emmagasinés dans les langues, la linguistique n’est ainsi qu’une partie de la sémiologie : une partie dont l’importance est néanmoins très grande. Elle se mesure en effet au rôle joué par le système des signes linguistiques à l’égard d’autres systèmes de signes. Par exemple, celui des codes de politesse ou celui des rites symboliques de toutes espèces. De tels systèmes de signes ne sont certes pas réductibles à la langue, mais on peut bien penser que leur fonctionnement est largement facilité, voire rendu possible par le lien social que la langue fournit déjà aux individus soucieux d’instaurer d’autres ensembles de signes.
Constitutive de la troisième option méthodologique définissant la science du langage, cette inscription de la linguistique dans la sémiologie n’a pas manqué de retentir sur ce qu’a été par la suite son destin. Si la linguistique est une partie aussi importante de la sémiologie, on peut en effet envisager que les lois qu’elle découvre au sein du produit social qu’est la langue ne soient pas non plus étrangères aux autres systèmes qu’elle rend possibles.
3 – LINGUISTIQUE ET SCIENCES HUMAINES
La volonté, pour rendre scientifique l’approche du langage, de la recentrer sur le fonctionnement de la communication par signes, a eu de multiples conséquences, qui débordent largement le champ originel de la linguistique.
Pour n’évoquer ici qu’un exemple de ces conséquences, on peut mentionner, dans le domaine de l’anthropologie, l’apport du maître de l’anthropologie américaine de l’entre-deux-guerres, Franz Boas, dont Claude Lévi-Strauss ne cessa ensuite de se déclarer le disciple. Explicitant certaines conséquences de la linguistique de Saussure, Boas soutient que les lois du langage fonctionnent à un niveau inconscient, en dehors de tout contrôle par les sujets parlants. En conséquence, les structures linguistiques ne sont que des phénomènes sociaux comme les autres, qu’on peut traiter comme des faits purement objectifs.
Une insistance comparable sur la relation entre langage et faits sociaux marque l’œuvre du linguiste américain, russe d’origine, Roman Jakobson (1896-1982, Essais de linguistique générale, I, 1963 et II, 1973). Il énonça la thèse centrale que Lévi-Strauss allait appliquer à son domaine : quand on étudie un langage, il faut déplacer l’attention des termes aux relations qui existent entre ces termes. Bref, les éléments constitutifs du langage n’ont pas de signification intrinsèque, mais leur signification résulte de leur position au sein du système de signes considéré.
C’était là formuler ce qui constituerait le principe même du structuralisme, tel qu’il a appartenu à Lévi-Strauss, combinant l’apport de Jakobson avec les suggestions de Boas, de le transférer aux phénomènes ethnologiques qu’il étudiait.
Des transpositions comparables intervinrent dans d’autres domaines où le structuralisme, vaste courant intellectuel particulièrement influent en France dans les années 1960, les appliqua à divers champs de réalité. Ces champs furent considérés comme structurés de la même manière que le langage. Ainsi Jacques Lacan put-il, à partir de la conviction que « l’inconscient est structuré comme un langage », reformuler au moins en partie les grands principes de la psychanalyse qu’avait fondée Freud et y intégrer les conséquences de la révolution linguistique.
À travers ces applications aux sciences humaines, deux options méthodologiques principales et constitutives de la linguistique tendirent à être exportées hors de celle-ci pour fournir à d’autres disciplines, à commencer par l’ethnologie et la psychanalyse, ce que Michel Foucault décrit (Les Mots et les Choses, une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966) comme le principe même de leur déchiffrement du réel :
1. Tout langage est un système qui renvoie à une activité inconsciente de l’esprit et dont les termes n’ont de signification qu’à travers leurs relations au sein d’une totalité.
2. Les faits humains, en tant que faits sociaux, ont des structures comparables à celles du langage. En vertu de quoi les sciences humaines, quand elles adoptèrent ce modèle linguistique, tendirent donc à reprendre à leur compte les mêmes options de méthode : elles les conduisirent notamment à mettre entre parenthèses à la fois la question de la chose visée par les signes (le référent) et l’interrogation sur le rôle de l’individu ou du sujet énonçant les signes (le locuteur). Cette dernière option notamment ne pouvait qu’avoir de puissantes conséquences sur des disciplines portées par exemple, dans ces conditions, à faire le plus possible l’économie du rôle joué par les acteurs individuels dans les processus sociaux ou historiques.
On perçoit ainsi quel type de rivalité a pu s’instaurer, pour un temps, entre philosophie du langage et linguistique. Non seulement la linguistique prétendait renvoyer à l’âge préscientifique les questions adressées classiquement par la philosophie au langage. Mais, en outre, une fois élaborée sa propre approche du langage, la linguistique pouvait sembler fournir les instruments d’une démarche s’appliquant à une diversité de champs d’investigation. Par exemple les sociétés, les cultures ou encore l’inconscient, etc. Vis-à-vis de ces champs, l’approche philosophique courait dès lors deux risques :
- Soit, si elle continuait par exemple de développer, selon sa fo...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Découvrir la philosophie
- Copyright
- Sommaire
- Présentation
- Introduction
- Chapitre 1 - Le langage
- Chapitre 2 - L’art
- Chapitre 3 - Le travail et la technique
- Chapitre 4 - La religion
- Chapitre 5 - L’histoire
- Glossaire
- Répertoire des philosophes et autres auteurs