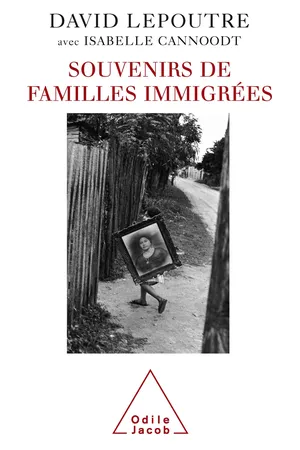
- 384 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Souvenirs de familles immigrées
À propos de ce livre
Des familles populaires immigrées, on ignore souvent tout de leur rapport au passé. Cela n'empêche pas, tout aussi souvent, de croire que les jeunes qui en sont issus sont sans racines et sans repères ; une partie de leurs difficultés et des problèmes qu'ils posent à la société française en résulterait. Que disent donc ces jeunes sur leur famille et leur passé quand on les interroge ? Qu'écrivent-ils sur leur histoire familiale si on le leur demande ? Quelles photographies, quelles images, quelles archives sont-ils en mesure de fournir ? S'appuyant sur les données recueillies pendant quatre années dans un collège de banlieue parisienne, David Lepoutre analyse le rapport au passé familial en fonction des contextes historiques de migration, des appartenances sociales et des origines culturelles. Une contribution exceptionnelle pour comprendre ce qu'est, et surtout ce que n'est pas, la mémoire familiale dans des catégories de population qui échappent habituellement à ce type d'enquête. Maître de conférences en sociologie à l'université d'Amiens, David Lepoutre a enseigné l'histoire-géographie à La Courneuve pendant dix ans. Il est l'auteur de Cœur de banlieue. Professeur agrégée de lettres, Isabelle Cannoodt a enseigné pendant dix ans à La Courneuve, puis à Paris.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Souvenirs de familles immigrées par David Lepoutre,Isabelle Cannoodt en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences sociales et Émigration et immigration. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Deuxième partie
Mémoire en abîme
Chapitre 3
Le passé aux oubliettes
Ce sont les difficultés de l’atelier d’écriture, qui nous ont conduits, rapidement, à nous intéresser aux contraintes qui s’imposaient aux adolescents dans leur mobilisation ou leur recherche de souvenirs familiaux. Produire un récit sur le métier et le lieu d’habitation de ses grands-parents ne va pas forcément de soi, contrairement à ce que nous avions imaginé au départ. Cela pose la question sociologique des conditions matérielles de l’accès au passé résidentiel et à celle des conditions démographiques de la relation aux aïeux et à la parentèle en général.
Les difficultés de l’atelier
Notre projet se nourrissait, au départ, de belles illusions. Dans notre établissement de banlieue populaire, comme dans beaucoup d’autres situés dans des quartiers comparables, les deux classes de 3e intégrées à cette action faisaient figure de véritables classes-monde, eu égard à leur composition démographique et aux origines très variées des familles des élèves (voir encadré et carte). La diversité inouïe des destins familiaux, ainsi que les ascendances paysannes traditionnelles d’une grande partie des parents nous laissaient escompter une moisson de trésors historiques et exotiques. Considérée avec le recul des années, cette entreprise reposait largement sur une vision naïve, bourgeoise, ethnocentriste, empreinte de stéréotypes sur les sociétés rurales du monde non occidental, autrement dit sur le mythe d’un rapport stable et harmonieux au passé, sur le mirage d’une transmission familiale garantie, de générations en générations. Il nous a fallu revenir rapidement sur terre.
Des familles populaires urbaines
Les deux caractéristiques centrales des familles des adolescents, à savoir la catégorie socioprofessionnelle et l’origine géographique ou nationale, sont liées au double contexte de la banlieue où elles résident et de l’établissement scolaire fréquenté par les élèves. La Courneuve est une commune de la couronne ouvrière parisienne, qui a subi de très fortes évolutions démographiques depuis cinquante ans, avec l’arrivée de nombreuses familles issues des différentes immigrations – sans oublier celles venues des provinces rurales métropolitaines, ici représentées par 3 élèves. Concernant le collège, il s’agit d’un établissement public de « Zone d’éducation prioritaire », qui accuse fortement, du fait de la fuite des classes moyennes et des ménages « franco-français », la proportion d’élèves de familles populaires et de familles immigrées.
Les catégories socioprofessionnelles (PCS) des parents d’élèves s’établissent, d’après les informations obtenues auprès des adolescents et parfois auprès de leurs parents, de la manière suivante. Sur 51 pères dont nous connaissons la profession qu’ils ont exercée ou exercent au moment de l’enquête, 31 sont ouvriers, 12 employés, 5 appartiennent aux professions intermédiaires et 3 sont artisans. Sur les 55 mères, 29 sont déclarées femmes au foyer, 21 sont employées, une seule est cadre. Pour les cas où les élèves étaient en mesure de donner des précisions, les professions se situent toujours dans les échelons inférieurs des catégories qui viennent d’être citées. Ainsi, pour les professions intermédiaires, il s’agit pour 4 d’entre eux de contremaîtres. Pour les employés, ce sont presque toujours des professions non qualifiées. Enfin, pour les ouvriers, on ne dispose d’aucune précision, car les élèves ne les connaissent pratiquement jamais. En ce qui concerne le chômage, on ne peut guère se fier aux déclarations spontanées, et c’est un sujet que nous n’avons jamais abordé. Nous n’avons donc pas de chiffre fiable.
En ce qui concerne les origines nationales, presque tous les adolescents sont issus de familles immigrées de pays étrangers ou venues des DOM-TOM. Dans l’ordre décroissant des effectifs, on compte 19 familles du Maghreb (13 algériennes, 6 marocaines) ; 7 familles du Sud-Est asiatique (5 cambodgiennes, 2 vietnamiennes) ; 8 familles du sous-continent indien (7 des ex-comptoirs français, 1 pakistanaise) ; 6 familles des DOM-TOM (5 antillaises, 1 réunionnaise) ; 5 familles d’Afrique noire ou de l’océan Indien (2 maliennes, 1 zaïroise, 1 sénégalaise, 1 comorienne) ; 2 familles de provinces françaises métropolitaines ; 2 familles portugaises ; 2 familles turques kurdes ; 1 famille mixte franco-algérienne ; 1 famille haïtienne.
De la vie de leurs grands-parents, certains élèves semblaient ignorer tout ou presque. Quelques-uns affirmaient ne pas savoir où ceux-ci avaient habité, ni quel métier ils avaient exercé. La question posée en guise de consigne d’écriture en laissa plus d’un sur le carreau. Les premières ébauches rédigées de certains textes sont significatives à ce titre : quelques phrases lapidaires, sans possibilité apparente de développements. Des adolescents disaient ne pouvoir obtenir aucun renseignement supplémentaire, ni auprès de leurs parents, ni auprès de personne.
Pour une partie d’entre eux, les souvenirs concernant les grands-parents semblaient renvoyer à un passé lointain et révolu, inconnu tout simplement parce qu’ils n’avaient pas connu leurs grands-parents et n’en avaient guère entendu parler. Quand nous avons introduit l’activité d’arbre généalogique au sein de l’atelier, certains élèves se sont trouvés particulièrement démunis en la matière, ne pouvant citer qu’un très petit nombre de personnes. Cette méconnaissance allait généralement de pair avec celle des lieux d’origine des familles. Une partie des adolescents, c’est-à-dire ceux dont les familles avaient largement ou même totalement et définitivement coupé avec ces lieux de départ, n’avait qu’une idée assez vague des lieux où habitaient ou avaient habité leurs grands-parents.
Quant aux photos de grands-parents, une partie des adolescents disaient ne pas en avoir. Si nous verrons que les images, et pas seulement photographiques, sont très présentes et occupent une place de choix dans les pratiques mémorielles familiales, au point qu’elles peuvent parfois être considérées comme un patrimoine exclusif (« Une fois, on rigolait avec ma mère sur quand elle serait morte, et elle m’a fait comme ça : “j’aurai pas grand-chose à te donner comme héritage, mais t’auras au moins mes bijoux, mes lettres et mes photos !” »), elles sont généralement récentes, beaucoup plus que dans les familles de milieux plus aisés. Les images d’aïeux, au-delà de la génération des grands-parents, sont rares dans ce contexte.
[Note de terrain] Je me souviens du fou rire (aigu et étouffé, typique des femmes antillaises) que j’ai déclenché en demandant à une mère, lors d’une de mes visites, si elle possédait des images de son propre grand-père, ouvrier agricole dans une plantation, dans les années 1920. Je venais de lire un ouvrage sur l’histoire de la photographie dans lequel l’auteur soulignait la diffusion très rapide de la pratique photographique dans la plupart des pays du monde dès le début du XXe siècle et j’appliquais bêtement mon savoir fraîchement acquis au contenu de mes questions ; celle-là semblait parfaitement incongrue à mon interlocutrice qui réagit par un fou rire : « Oh là là ! [Rires] Excusez-moi… [Rires]. En ce temps-là, ça n’existait pas du tout… [Fou rire]. Rien de tout cela ! Oh non, non, non… »
[Note sur Kouba] Le cas de Kouba paraît assez exemplaire de ces difficultés d’accès à un certain passé familial. Issue de parents immigrés maliens, elle n’avait encore jamais été au Mali quand elle participa à l’atelier d’écriture, à l’âge de 15 ans. (Cependant, elle y fit, deux années plus tard, un long séjour estival avec sa mère et une de ses sœurs.) Elle ne connaissait, à ce moment-là, aucun de ses quatre grands-parents, dont il ne lui restait qu’une seule grand-mère vivante. Elle ne disposait d’aucune photographie de ses aïeux. Elle a d’ailleurs intitulé son texte : « J’aimerais bien la voir avant qu’elle s’en aille. » Si l’on extrait de l’arbre généalogique que nous avons établi ensemble, quelques mois après son voyage, les noms des personnes de sa famille dont elle venait de faire connaissance au pays, on peut déduire qu’elle n’aurait pu citer dans sa parentèle, en classe de 3e, que les membres de sa famille nucléaire, ses quatre grands-parents, un oncle, une tante et trois cousins.
La disparition des traces résidentielles
Les familles de notre enquête entretiennent évidemment une certaine mémoire des lieux qu’elles ont habités dans le passé. Leur position de famille migrante leur donne même en ce domaine une certaine spécificité. J’examinerai, dans la troisième partie, la variation du rapport au pays ou à la région d’origine en fonction des différents contextes migratoires. Mais ce qui apparaît marquant, au premier abord, et qui concerne les familles des adolescents à la fois en tant que familles populaires urbaines et familles migrantes, c’est la fréquence de l’effacement matériel du passé résidentiel. Si les populations aisées des pays industrialisés et urbanisés sont en général habituées à une certaine stabilité ou pérennité du cadre bâti et de l’habitat, il n’en va pas de même pour les classes plus modestes. Qu’il soit rural ou urbain, l’habitat populaire fait beaucoup plus souvent les frais du temps qui passe, de l’Histoire et des politiques de rénovation urbaine. En ce qui concerne précisément les familles immigrées de la génération de notre enquête, l’expérience des destructions d’habitation est particulièrement frappante, au point que les trajectoires résidentielles de certaines d’entre elles semblent s’inscrire dans une sorte d’anéantissement perpétuel.
Le cas des Algériens, immigrés en France dans les années 1960, est emblématique de ce passé matériellement aboli, rayé de la carte. Il ne serait sans doute pas impossible de trouver des cas de familles, dont tous les logements qu’elles ont occupés au cours de leur vie ont été détruits – et qui ont, de plus, été forcées de quitter ces logements pour qu’ils puissent être détruits. Pendant la guerre d’Algérie, 8 000 villages des « zones interdites » furent entièrement vidés de leur population et systématiquement démolis ou incendiés par l’armée française. Leurs habitants furent déplacés et cantonnés dans des « centres de regroupements » qui, pour une partie d’entre eux, furent par la suite également rasés. Ces déplacements contraints de population ont porté sur plus de deux millions de personnes (Bourdieu, Sayad, 1964 ; Rocard, 2003). En France métropolitaine, les quartiers de bidonvilles des périphéries urbaines, où se logèrent de nombreuses familles ouvrières immigrées dans les années 1960, furent détruits au début de la décennie suivante, dans le cadre de la « résorption de l’habitat insalubre ». Les cités de transit, où une partie des familles fut relogée après la résorption, étaient provisoires et elles ont également été effacées du paysage urbain (Lallaoui, 1993 ; Pétonnet, 1982). Enfin, depuis une quinzaine d’années, les programmes de rénovation urbaine se traduisent par des destructions massives de barres et de tours des grands ensembles HLM.
À La Courneuve, nous connaissons plusieurs familles d’élèves du collège qui ont résidé dans la barre de la rue Claude-Debussy (détruite en 1986), puis qui ont été relogées dans la barre de la rue Auguste-Renoir (détruite en 1999). Plus précisément, dans le groupe des élèves ayant participé à notre projet, trois familles ont résidé successivement dans un bidonville, démoli, puis dans une cité de transit, démolie, puis dans une barre du grand ensemble, démolie, avant d’accéder finalement à la propriété pavillonnaire.
La photo qu’a fournie Vanessa (p. 231) offre une illustration stupéfiante de cette succession historique de destructions d’habitat populaire, et met en lumière, en rapprochant les époques, certaines contradictions politiques de notre société contemporaine en matière de logement. Il s’agit d’un Polaroïd de ses grands-parents posant devant le quartier de baraquements (bidonvilles) du Franc-Moisin où ils résidaient, à la fin des années 1960. Ce quartier se trouvait à proximité des immeubles neufs de la cité des Quatre Mille, construite quelques années auparavant. Le bidonville fut rasé au début des années 1970 et remplacé par un deuxième grand ensemble qui porte encore aujourd’hui le nom de Cité du Franc-Moisin. Or, sur la photo des grands-parents, l’arrière-fond, derrière les baraques, est occupé par la grande barre Auguste-Renoir, celle qui a été implosée en 1999. Sur le même cliché voisinent ainsi deux symboles honnis et aujourd’hui tous les deux détruits de l’habitat populaire, bien que l’un des deux fût, en son temps, construit en quelque sorte comme une solution de remplacement de l’autre.
La contrainte imposée de l’extérieur ne concerne pas ici seulement la disparition des traces matérielles du passé résidentiel, mais également l’effacement symbolique. Les destructions de ces différents types de logements vont en effet de pair avec leur disqualification aux yeux de la collectivité qui décide de ces opérations. Dans l’histoire urbaine du pays, il ne fait aucun doute qu’ils figurent dans les pages les moins visibles.
Au chapitre des conditions de la mémoire des lieux habités, nous pouvons également ajouter la forte mobilité résidentielle, tous facteurs confondus, des familles représentées dans notre échantillon. Si cette mobilité correspond à une tendance de fond des sociétés contemporaines et en particulier de la société française, touchant de manière variable toutes les classes sociales, il ne fait pas de doute que les familles populaires urbaines figurent parmi les plus fortement concernées par ce phénomène. Dans le groupe des 53 familles, 21 d’entre elles, soit près de la moitié, ont changé de résidence entre 1997 et 2002, ce qui les situe nettement au-dessus de la moyenne nationale des changements de résidence sur une durée comparable (27 % des personnes situées dans la tranche d’âge 35-50 ans ont déménagé, en France, entre 1992 et 1996).
Notons que sur les 21 familles qui ont déménagé, 11 d’entre elles l’ont fait dans le cadre de l’opération de « rénovation » de la cité des Quatre Mille. On peut ici relever un élément significatif de la façon dont sont produites les statistiques du recensement national sur ce sujet. Dans la liste des « raisons de déménager » répertoriées par l’Insee, il n’existe que des raisons qu’on peut désigner comme « internes » aux familles : changement professionnel, divorce, désir d’un logement plus grand, accès à la propriété, passage du logement collectif au logement individuel, désir de changer d’environnement résidentiel. Les contraintes « externes », du type de celles évoquées dans ce chapitre, n’apparaissent jamais. Pourtant, cette mobilité contrainte, liée à des opérations de destruction d’immeuble, n’est pas un phénomène marginal, puisqu’elle concerne 15 000 ménages par an depuis le début des années 1990. Et cela est loin d’être fini : les programmes de destruction prévoient 300 000 logements démolis dans la décennie à venir. À La Courneuve, les opérations sont toujours en cours. Deux barres supplémentaires (Ravel et Présov) ont été implosées en 2004. En somme, c’est un peu comme si l’on sous-entendait que, d’une façon générale, la mobilité résidentielle ne peut relever que du pur choix des familles, c’est-à-dire de la simple liberté individuelle.
Cette mobilité résidentielle, combinée au facteur de la migration, se traduit par un autre fait marquant, qui est l’absence quasi totale de familles d’origine locale ou même régionale dans le groupe d’adolescents. Sur l’ensemble des élèves des quatre années d’atelier (les deux classes du livre auxquelles s’ajoutent les deux classes suivantes, ayant seulement participé aux expositions), soit un total de 120 adolescents, nous n’en avons rencontré que deux dont les parents étaient nés en Île-de-France. Tous les autres parents d’élèves sont venus de pays étrangers, des DO...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Liste des auteurs adolescents
- Introduction
- Première partie - Mémoire sur commande
- Deuxième partie - Mémoire en abîme
- Troisième partie - Mémoire en héritage
- Quatrième partie - Mémoire en action
- Conclusion
- Annexe
- Références bibliographiques
- Remerciements
- Textes écrits par les adolescents