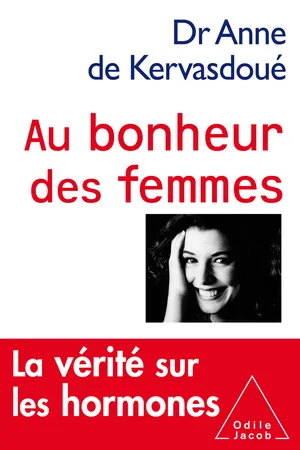
- 304 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
« En tant que femme et gynécologue médicale, je voudrais apporter, dans ce livre, un témoignage clair et objectif, personnel, pour ne pas dire "engagé", sur l'histoire tourmentée du traitement hormonal de la ménopause et de ses polémiques dévastatrices sans fin auxquelles j'ai assisté depuis trente ans. Il existe de véritables avantages du THS que l'on a eu tendance à gommer au profit des risques encourus largement amplifiés. » A. de K. Autour de la cinquantaine, arrivées à une étape clef de la vie, beaucoup de femmes s'interrogent : faut-il oui ou non suivre un traitement hormonal substitutif ? Quels sont ses bienfaits et ses risques éventuels ? A-t-il des effets sur le cerveau, les os, les artères, la sexualité, l'humeur et la peau ?À toutes ces questions, et à bien d'autres, le docteur Anne de Kervasdoué répond, point par point, avec des arguments clairs et scientifiques reposant sur son expérience clinique et sur toutes les études récentes réalisées sur les produits prescrits en Europe.Le Dr Anne de Kervasdoué est gynécologue et auteur de nombreux livres sur la santé des femmes, dont notamment Questions de femmes qui a rencontré un large succès auprès du public.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Au bonheur des femmes par Anne de Kervasdoué en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Médecine et Endocrinologie et métabolisme. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Première partie
Une controverse
aux effets dévastateurs
aux effets dévastateurs
Chapitre premier
Scénario de la polémique
J’ai reçu un jour dans mon cabinet une femme de 84 ans, dotée d’une grande vitalité et d’une forte personnalité. Son gynécologue avait refusé de prolonger le traitement hormonal qu’elle prenait depuis sa ménopause et qui lui convenait très bien, sous prétexte qu’elle allait inévitablement avoir un cancer. Ébranlée, elle avait obtempéré. Mais très vite, les symptômes désagréables étaient revenus. Elle était retournée voir son médecin, qui avait à nouveau refusé de prescrire des hormones sauf si elle acceptait de signer une décharge. Furieuse, elle était venue me consulter dans l’espoir que je renouvellerais son traitement. Elle me dit : « Vous comprenez, docteur, c’est la première fois de ma vie que je me sens vieille ! »
Quelques semaines plus tard, une de mes patientes sous THS depuis trois ans m’a raconté l’entretien qu’elle avait eu avec son médecin de famille. Apprenant qu’elle suivait un traitement hormonal, et sachant l’amour qu’elle portait à ses petits-enfants, ce médecin lui avait dit : « Si vous continuez à prendre ce traitement, vous ne les verrez plus grandir ! » Très angoissée, cette femme m’a expliqué : « Vous comprenez ma frayeur et celle de mon mari, docteur ! Alors, j’ai arrêté. Mais depuis, je ne suis plus la même. » Cette femme avait eu si peur qu’elle n’a plus jamais osé reprendre son traitement hormonal, malgré ses malaises.
Nous sommes alors en 2004 peu après la publication de l’étude américaine et de l’étude anglaise (qui ont enflammé les médias, effrayé l’opinion publique et perturbé une partie du corps médical.) Comme ces patientes, des milliers de femmes renoncent chaque jour au mieux-être que pourrait leur apporter un traitement hormonal, à cause d’une peur fantasmatique car, aujourd’hui encore, une forte pression les empêche d’y avoir recours.
Pourquoi des médecins persistent-ils à les priver d’une solution qui pourrait les aider ? D’où vient cette suspicion tenace vis-à-vis du traitement hormonal de la ménopause ?
Pour le comprendre, il faut retracer les principales étapes de la polémique qui a débuté après la publication des premiers résultats de l’étude WHI en 2002. Mais l’histoire avait commencé bien avant…
Prologue
Soixante années d’espoir pour les femmes
Soixante années d’espoir pour les femmes
Il faut remonter aux années 1930 pour trouver les premières traces de ce traitement. Sa première version a été mise sur le marché aux États-Unis en 1942. À partir de 1950, les prescriptions se sont intensifiées. Pendant les décennies suivantes, il s’est peu à peu répandu, prenant un véritable essor au début des années 1970 en même temps que les femmes revendiquaient leur autonomie. Rappelons que le traitement consistait alors à prendre des doses massives d’œstrogènes d’origine équine (au sens propre des œstrogènes provenant d’urines de jument), souvent seules et parfois associées à des progestatifs de synthèse.
Au début des années 1990, la cause semblait entendue. Quelques études confirmaient les bénéfices de ce traitement et des millions de femmes à travers le monde se félicitaient de ne plus être obligées de subir le sort de leurs mères et de leurs grands-mères, perturbées par la fatigue, les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil et de l’humeur, la fragilité osseuse et les maladies cardio-vasculaires. Le risque de cancer du sein était évoqué, mais encore timidement : aucune étude ne l’avait clairement mis en évidence.
Le THS s’est peu à peu imposé en France. Pourtant, l’école gynécologique française s’est vite démarquée du courant anglo-saxon.
Tout d’abord, la « gynécologie médicale » est une spécialité française. Dans les autres pays occidentaux, tous les gynécologues sont obstétriciens. Ils focalisent l’essentiel de leur activité sur la grossesse et la naissance, pratiquent des interventions chirurgicales gynécologiques et des césariennes, mais s’intéressent assez peu aux questions hormonales en général et à la ménopause en particulier. À l’inverse, les gynécologues médicaux se concentrent sur les aléas de la vie génitale et hormonale des femmes depuis leur adolescence et s’efforcent de préserver leur bien-être au fil des années, y compris après la ménopause.
Durant les premières décennies, le THS a été prescrit en France par les obstétriciens et les gynécologues médicaux, et même parfois par les médecins généralistes. Mais lorsque la polémique s’est enflammée, les obstétriciens et les généralistes ont été plus nombreux à cesser leurs prescriptions.
C’est en France que le premier service hospitalier entièrement consacré à la gynécologie médicale fut créé à l’hôpital Necker en 1963 sous la direction du Dr Albert Netter. Il a tout d’abord suivi le modèle américain en préconisant des doses importantes et uniformisées. Il tentait ainsi, en association avec les laboratoires pharmaceutiques, de valider le bien-fondé du traitement hormonal de la ménopause en s’appuyant sur des prescriptions standardisées.
En 1974, le Dr Netter fut remplacé par un endocrinologue et chercheur le Pr Mauvais-Jarvis, qui mit au point avec le laboratoire Besins Iscovesco le premier œstrogène par voie cutanée, l’Œstrogel sorti en 1975 qui fit directement concurrence au Premarin américain. Il offrait, outre l’avantage d’éviter le passage de la barrière du foie, la possibilité d’adapter sa posologie au cas par cas afin d’en limiter au besoin les inconvénients. C’est ainsi qu’au fil des ans, une partie de la communauté gynécologique a modifié ses habitudes et prescrit des œstrogènes par voie transdermique (gel) associés à de la progestérone naturelle micronisée par voie orale. Les deux écoles, l’une exclusivement « voie cutanée-progestérone naturelle » présentée ultérieurement comme l’« exception française », l’autre plus proche des habitudes de prescription américaines mais défendant le principe de multiples voies d’administration, se sont opposées pendant très longtemps.
Malgré leurs différences, le traitement hormonal de la ménopause continuait à améliorer la vie quotidienne des femmes des deux côtés de l’Atlantique. En 1990, on estime que 28 % des Américaines ménopausées en bénéficiaient contre seulement 8 % des Françaises. Cet écart s’est réduit au cours de la décennie suivante jusqu’à se stabiliser.
Entre 1995 et 1999, les prescriptions de traitement hormonal avaient presque doublé.
L’évolution semblait inexorable.
Acte 1
Les premières suspicions…
Les premières suspicions…
En 1993, une grande étude est lancée aux États-Unis. Financée par le National Institute of Health1 (qui y investit plus de 620 millions de dollars) et soutenue par les mouvements féministes, la Women’s Health Initiative (WHI2) rassemblait 16 608 femmes âgées de 50 à 79 ans.
Le principe était de donner à certaines d’entre elles un traitement hormonal et d’observer l’évolution de leur état de santé et de le comparer aux femmes qui n’en prenaient pas. Ces femmes devaient être suivies pendant une très longue période afin que les résultats de l’étude aient une vraie valeur scientifique. Les initiateurs entendaient démontrer, une fois pour toutes, les bénéfices du THS.
En 1997, la revue médicale britannique The Lancet publie les résultats d’une méta-analyse baptisée HERST. Les auteurs de ce travail avaient rassemblé 90 % des études disponibles à l’époque sur les relations entre le traitement hormonal et le cancer du sein3.
Les résultats montraient une légère augmentation du risque de cancer du sein chez les femmes traitées, principalement chez les femmes très minces. Mais ce risque régressait rapidement à l’arrêt du traitement pour disparaître au bout d’un an. Ces cancers étaient d’un bien meilleur pronostic que ceux développés par les femmes n’ayant jamais suivi de traitement hormonal, et le taux de mortalité global n’était pas affecté.
Parallèlement, cette étude montrait que le traitement hormonal n’était pas forcément protecteur sur le plan cardio-vasculaire. Il pouvait même augmenter le risque de thrombose veineuse lorsqu’il était administré à distance de la ménopause (plus de cinq ans après l’arrêt des règles).
Les médias ne se sont pas beaucoup intéressés à ces résultats et n’en ont parlé que beaucoup plus tard. Les médecins en ont pris acte, tout en faisant remarquer que les femmes observées, les Américaines, ne suivaient pas le même type de traitement que les Françaises. L’exception française faisait déjà parler d’elle.
Cela n’empêchait pas les femmes médecins ménopausées de prendre, elles-mêmes, un traitement hormonal. Les enquêtes confirment les résultats de différentes études sur ce sujet témoignant toutes du plus grand usage du traitement hormonal substitutif dans la population médicale que dans la population générale. Dans une étude suédoise4, les auteurs rapportent que si 35 % des Suédoises de 55 ans utilisent un THS, ce pourcentage monte à 68 % chez les femmes conjointes de médecins généralistes, 72 % chez les femmes médecins généralistes, 86 % chez les conjointes de gynécologues et même 88 % chez les femmes gynécologues. Une enquête britannique5 révèle que les femmes médecins britanniques qui se traitent suivent le traitement plus longtemps : 71 % plus de cinq ans, et 58 % plus de dix ans.
Ces enquêtes publiées avant 2003 montrent que l’adhésion au THS des femmes médecins ou exerçant une activité paramédicale est beaucoup plus forte traduisant une bonne information et un accès facilité aux soins. En 2004, après la publication des deux études anglo-saxonnes, une enquête réalisée par l’AFEM6 auprès de femmes gynécologues confirme l’enthousiasme pour le THS, avec seulement 9 % d’abandon.
Acte 2
Une étude américaine crée la panique
Une étude américaine crée la panique
Le 10 juillet 2002, dans la torpeur du début des vacances d’été, une annonce brutale déclenche un séisme : les chercheurs qui avaient lancé l’étude WHI annoncèrent qu’ils y mettaient fin au vu des risques que faisaient courir les hormones aux femmes qui suivaient le traitement.
Pourtant, remarquons-le, ce n’est pas le cancer du sein qui était incriminé mais les risques cardio-vasculaires. L’effet protecteur supposé n’existait pas ; en revanche apparaissait chez des femmes traitées un risque supplémentaire de développer des pathologies circulatoires et cardiaques.
« C’est la bombe la plus énorme qui ait jamais explosé au cours de mes trente années de carrière », a déclaré le Dr Utian, directeur de la société nord-américaine de la ménopause.
Les médias se sont immédiatement emparés de l’affaire, publiant à la une des titres accrocheurs suivis d’articles très alarmistes. En Europe, les quotidiens britanniques furent les premiers à réagir en titrant « le THS augmente les risques de cancer et d’attaques cérébrales7 » ou « Des millions de femmes menacées par le THS8 ». La peur chassait les espoirs féminins et la confiance.
D’autres titres encore, toujours au Royaume-Uni : « Alerte au cancer : des essais dangereux mis au rebut9 » ou « Gigantesque augmentation des risques de maladies meurtrières10 ». Pour le Daily Star, « la moitié des femmes sous THS (sont) deux fois plus susceptibles d’avoir un cancer du sein ».
En Allemagne, Bruno Müller-Oerlinghausen, président de la Commission nationale de sécurité des médicaments affirmait par voie de presse que le traitement hormonal était une « tragédie nationale et internationale, similaire à celle du Distilbène11 », et que « l’usage naïf de ces médicaments perçus comme naturels et optimaux ont provoqué beaucoup de décès non justifiés parmi les femmes ».
La France n’était pas en reste : dans un article intitulé « Le THS n’en finit pas de dévoiler ses faiblesses », un journaliste du Figaro12 évoquait « l’arrêt en catastrophe de l’étude WHI » parce que le traitement hormonal « accroît les risques d’infarctus au lieu de les amoindrir ». On a même pu lire dans un journal de santé alternative : « Ménopause : les traitements substitutifs tuent13 ! » Les auteurs de l’étude concluent qu’« au cours des dix dernières années, l’usage du traitement hormonal de la ménopause par les Anglaises a pu être à l’origine de 20 000 cancers du sein ».
Le laboratoire pharmaceutique Wyeth, principal diffuseur du traitement, était pris à partie dans un article intitulé « Le triomphe du marketing sur la science ». On pouvait y lire : « Manufacturez un besoin chez le consommateur ; inventez un produit de consommation pour satisfaire un nouveau besoin créé de toutes pièces ; vendez le produit. Voilà, en clair, l’histoire du capitalisme. Mais c’est une chose quand le nouveau produit de consommation est une pierre fétiche ou un soda bleu. C’est tout à fait autre chose quand le produit est pharmaceutique, quand il met en jeu la vie et la mort. »
Un peu plus loin, dans le même article citant Cynthia Pearson alors directrice du National Women’s Health Network, l’auteur poursuit : « Les compagnies pharmaceutiques ont usé de miroirs et d’écrans de fumée pour promouvoir des bienfaits infondés, minimiser les risques et désinformer les médecins pour les enrôler dans le marketing d’un traitement néfaste aux femmes en ...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Introduction
- Première partie - Une controverse aux effets dévastateurs
- Deuxième partie - Le traitement hormonal substitutif
- Troisième partie - Comment prendre la bonne décision
- Vivre longtemps en restant jeune est un art qui se cultive
- Conclusion
- Remerciements
- Du même auteur