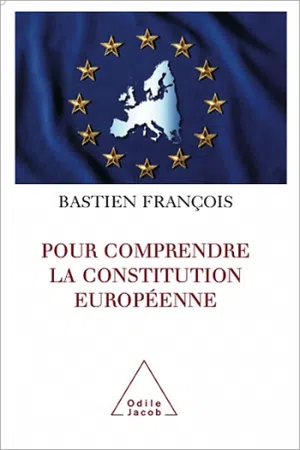
- 196 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Pour comprendre la Constitution européenne
À propos de ce livre
Sous la forme d'un dialogue qui passe en revue les principales interrogations que soulève la Constitution européenne, dans un langage accessible à tous, voici l'instrument indispensable qui permettra à chacun de se forger une opinion informée et de comprendre enfin la Constitution européenne. Bastien François est professeur de science politique à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Pour comprendre la Constitution européenne par Bastien François en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politique et relations internationales et Constitutions. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
UNE CONSTITUTION ?
Pourquoi établir une constitution européenne aujourd’hui ? À quelle nécessité correspond-elle ?
L’idée d’une organisation politique européenne transcendant les États-nations est très ancienne. C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que les pays européens sont en ruine et que débute le grand affrontement Est-Ouest (la « guerre froide »), que s’impose l’idée que seule une Europe unie pourra garantir une paix durable et permettre la « reconstruction » des économies. Cette Europe va se construire selon la méthode des « petits pas » ou encore ce qui va être appelé la « méthode Monnet-Schuman », du nom de deux Français, le commissaire au Plan Jean Monnet et le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman. De quoi s’agit-il ? De construire l’Europe par l’économie. De mettre en place, petit à petit, une gestion commune de certains secteurs stratégiques afin de créer une solidarité effective entre les pays européens. En favorisant l’intégration des différentes économies, il s’agit de rendre impossible une nouvelle guerre sur le sol européen, mais aussi, au moins comme horizon lointain, de poser les fondements d’une Europe fédérale, sur le modèle des États-Unis d’Amérique. Par quoi commencer ? Jean Monnet et Robert Schuman ont sur ce point une idée bien arrêtée : par le charbon et l’acier qui jouent alors un rôle central dans les économies et dans l’industrie… d’armement. La première réalisation concrète de cette ambition est donc le traité de Paris, en 1951, qui crée la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Ce traité réunit six pays : la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. C’est l’Europe des Six. Il pose également les bases institutionnelles de la construction européenne. À la tête de la CECA, on trouve une instance décisionnelle supranationale qui prend le nom de « Haute Autorité ». Cette dernière, indépendante des différents gouvernements des États européens, est chargée de réguler la production et la gestion du charbon et de l’acier dans les pays signataires du traité. Elle est assistée d’un Conseil des ministres (où chaque État est représenté), d’une assemblée parlementaire (qui n’est pas élue au suffrage universel direct et dont le rôle est purement consultatif), le tout sous le contrôle d’une Cour de justice.
Après l’échec de la construction d’une Communauté européenne de défense (CED) en 1954, deux traités sont signés à Rome en 1957. Le premier institue la Communauté économique européenne (CEE) qui vise à mettre en place un « marché commun » entre les pays de l’Europe des Six ; le second instaure une Communauté européenne de l’énergie atomique, dite Euratom, dont la vocation est de contribuer à la formation et au développement d’une industrie nucléaire européenne. Sur le plan institutionnel, est mise en place une Commission européenne, un organe indépendant des différents États qui a le monopole du pouvoir de proposition en matière de politiques européennes. Elle prépare toutes les décisions qui seront ensuite arrêtées par le Conseil des ministres, où est représenté chacun des États. C’est à elle que revient, ensuite, la charge de mettre en œuvre les décisions du Conseil des ministres. À ses côtés figure un Parlement européen, dont les pouvoirs sont à l’origine très restreints, essentiellement consultatifs, et une Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) chargée de vérifier la bonne application des traités. Avec la création de la CEE, une dynamique s’enclenche, conduisant à la libéralisation croissante des échanges économiques (les droits de douane sont par exemple totalement supprimés en 1968), à la multiplication des politiques communes (la plus connue, dans l’Europe encore très rurale des années 1960, est la politique agricole commune) et à la naissance d’un « droit communautaire » spécifique.
Mais cette Europe-là, celle de Jean Monnet et de Robert Schuman, est-elle encore d’actualité ? Le charbon et l’acier ne sont plus des matières premières aussi essentielles qu’auparavant, l’Europe ne se réduit plus à un « marché commun », il y a aujourd’hui des élections européennes…
Effectivement, cette Europe des origines, celle des « communautés européennes », a connu des changements considérables. Et c’est par rapport à ces changements que la question constitutionnelle a fini par se poser. Pour bien le comprendre, il faut prendre la mesure de ces évolutions.
La première concerne le « périmètre » de l’Europe. L’Europe des Six est devenue celle des Neuf (avec l’adhésion du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande en 1973), puis celle des Dix (entrée de la Grèce en 1981), celle des Douze (arrivée de l’Espagne et du Portugal en 1986), celle des Quinze (adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède en 1995), et enfin celle des Vingt-Cinq quand, en 2004, dix nouveaux pays rejoignent l’Union européenne : Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Désormais, l’Union européenne regroupe un peu plus de quatre cent cinquante millions d’habitants. Et, on le sait, cet élargissement devrait se poursuivre dans les années à venir… On peut se réjouir ou critiquer le fait que l’Europe politique se soit construite sans que soient jamais définies ses frontières géographiques. D’où les discussions actuelles sur l’éventuelle adhésion de la Turquie… Reste le problème, évidemment crucial, de l’organisation de la décision politique à l’échelle européenne. On ne décide pas de la même manière, on ne règle pas de façon identique le conflit permanent des intérêts nationaux selon que l’on est six ou vingt-cinq. Ce n’est donc pas un hasard si la question constitutionnelle a véritablement pris son essor face à la perspective de l’élargissement de 2004.
Au fil des traités successifs, ou d’accords entre certains États européens, le « contenu » de l’Europe a également changé. Les accords de Schengen prévoyant la suppression effective des frontières et la libre circulation des personnes sont signés en 1985 mais ne seront appliqués que dix ans plus tard. Entre-temps, la construction européenne est relancée par la signature, en 1986, de l’Acte unique européen qui lève les derniers obstacles à la liberté de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, ce que l’on appellera le « marché unique ». Désormais, les économies européennes sont de plus en plus intégrées. Les échanges intra-communautaires représentent par exemple plus des deux tiers du commerce extérieur français aujourd’hui. L’Acte unique consacre également une institution coutumière, le Conseil européen, chargé de donner les grandes impulsions politiques à la construction européenne. Il s’agit en fait de la réunion des chefs d’État et de gouvernement, dont la présidence alterne tous les six mois entre tous les États membres. Surtout, l’Union européenne est créée par le traité de Maastricht en 1992. D’une structure très complexe, elle repose sur trois « piliers » : le pilier communautaire (la CECA, Euratom et la CEE rebaptisée Communauté européenne à cette occasion), le pilier de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et le pilier de la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures (JAI). Le traité de Maastricht approfondit aussi l’Union économique et monétaire (qui conduira notamment, le 1er janvier 1999, à la naissance d’une « zone euro » dotée d’une nouvelle monnaie commune), pose le principe d’une citoyenneté européenne et renforce les pouvoirs du Parlement européen. Avec le traité d’Amsterdam signé en 1997, la Communauté européenne acquiert de nouveaux domaines de compétence (par exemple en matière de droit d’asile et d’immigration), tandis que les mécanismes de coopération interétatiques sont fortifiés (notamment sur les questions judiciaires et policières). Le Parlement européen a désormais un rôle de décision renforcé sur la majeure partie de la législation européenne ; la Commission ne peut être formée sans son accord. Le traité de Nice, signé en 2001, apporte son lot de modifications institutionnelles (la désignation du président de la Commission par le Conseil européen à la majorité qualifiée et non plus à l’unanimité), étend plus encore les compétences de l’Union (qui doit intervenir désormais, par exemple, en matière de « modernisation » de la sécurité sociale) et renforce les procédures supranationales (s’agissant en particulier des négociations commerciales internationales concernant les services et la propriété intellectuelle). Surtout, dans la perspective de l’élargissement de l’Union aux pays d’Europe centrale et orientale, et au prix de marchandages diplomatiques pas toujours très glorieux, le traité redéfinit le poids de chaque État au sein des institutions européennes (le nombre de députés de chaque nationalité au Parlement européen, le nombre de commissaires européens, la pondération des voix par pays au sein du Conseil des ministres).
À cette succession de traités ou d’accords européens modifiant les compétences et le périmètre d’action européens, il faut ajouter des transformations, parfois considérables, des politiques européennes. C’est ainsi que la politique agricole commune, conçue dans une logique productiviste pour une Europe encore très rurale et souffrant de pénurie alimentaire, dans un monde aux échanges agroalimentaires limités, et qui a pu représenter jusqu’à 90 % du budget européen, a connu des mutations très importantes pour s’adapter aux nouvelles logiques de production agricole, aux transformations des marchés agroalimentaires, ainsi qu’aux nouvelles contraintes de sécurité alimentaire et de sauvegarde de l’environnement. Elle ne représente plus aujourd’hui que environ 45 % du budget de l’Union européenne.
Depuis les années 1950, la construction européenne s’est donc assurément approfondie. Elle a également pris une configuration un peu baroque sur le plan de l’organisation institutionnelle (les trois « piliers » du traité de Maastricht renvoient en fait à des modes de décision différents), s’est faite à plusieurs « vitesses » (les accords de Schengen comme la monnaie unique ne concernent pas tous les pays de l’Union européenne), dans un empilement de politiques publiques de plus en plus importantes et touchant des domaines de plus en plus variés (environnement, santé, recherche, social, justice, etc.) dont on ne voit plus très bien la cohérence d’ensemble. D’autant que la construction européenne ne « fonctionne » pas de la même façon selon les secteurs d’intervention : certaines des compétences de l’Union sont partagées avec les États (en matière de recherche, de justice ou de transports), d’autres lui sont exclusives (comme les questions douanières ou la définition des règles de concurrence au sein du marché intérieur), d’autres encore ne s’exercent qu’à travers un mécanisme de coopération interétatique (la politique extérieure en est le meilleur exemple). D’où une confusion entre ce qui relève de l’intergouvernemental et ce qui relève du « communautaire », certains secteurs de politique publique pouvant emprunter aux deux modèles au fil des ans.
C’est devenu très compliqué…
Oui. Mais ce n’est pas tout. C’est un ensemble de facteurs qu’il faut considérer. Ainsi, le système institutionnel européen a lui aussi évolué, de façon pas toujours très perceptible ou spectaculaire. La Commission européenne s’est affirmée progressivement. Elle s’est imposée comme un véritable gouvernement européen dans certains domaines, capable d’engager des politiques structurelles de long terme, capable de tenir tête aux autres puissances étrangères ou aux grands groupes économiques internationaux (par exemple en contrôlant les ententes et les fusions entre entreprises européennes ou extra-européennes), capable de peser sur des négociations internationales (comme celles qui sont liées à l’Organisation mondiale du commerce). Le Parlement européen, élu au suffrage universel depuis 1979, a vu sa place valorisée à plusieurs reprises. En dépit de son côté « tour de Babel » mal structuré politiquement (faute d’un système partisan véritablement européen), il a pris conscience de son rôle et s’est donné notamment les moyens de contrôler bien mieux qu’auparavant le travail de la Commission européenne. Il a même obtenu la démission de la Commission dirigée par Jacques Santer en 1999 et chacun a pu voir, très récemment, comment il a obligé le nouveau président de la Commission, José Manuel Barroso, à changer un certain nombre de ses ministres (commissaires). Il a également su utiliser à plein le rôle de colégislateur (à côté du Conseil des ministres) qui lui a été reconnu, petit à petit, par les traités. La Cour de justice est à l’origine des transformations les plus importantes. « Gardienne des traités », elle a réalisé, dès les années 1960, une véritable révolution juridique. Contre la volonté des États européens, soucieux de préserver leur souveraineté sur leur propre législation nationale, elle a en effet décidé que le droit européen s’imposait directement dans chaque État membre et que ce droit avait une valeur supérieure aux droits nationaux. À l’« Europe par l’économie », elle a donc ajouté l’« Europe par le droit », construisant au rythme de sa jurisprudence un véritable ordre juridique supranational, avec un impact d’autant plus important que son interprétation des traités a privilégié la protection des droits fondamentaux des citoyens européens.
Toutefois, en dépit de ces transformations plutôt « positives », pour des citoyens européens habitués à raisonner au plan national dans les catégories du parlementarisme (un gouvernement responsable devant un Parlement) et de la « démocratie constitutionnelle » (qui s’est imposée partout depuis cinquante ans avec le rôle croissant des juges constitutionnels), le système institutionnel de l’Union européenne est resté quasiment incompréhensible. Où est le pouvoir ? Qui gouverne l’Europe ? Les Conseils européens regroupant les chefs d’État et de gouvernement – dont les communiqués pontifiants de fin de « sommet » masquent mal les chamailleries et dont le président change tous les six mois ? La Commission « de Bruxelles », lointaine, affublée d’une image de technocratie toute-puissante, composée d’illustres inconnus du grand public, dont les verdicts – « Bruxelles a décidé… » – semblent surgir de nulle part ? Le Parlement européen, dont peu comprennent le rôle et les clivages ? La Cour de justice, un « gouvernement des juges » ?
Parallèlement, les modes de gouvernement, au plan national, ont également connu un profond aggiornamento. Aujourd’hui, dans les ministères de chaque pays de l’Union, la dimension européenne est l’élément central de toute décision. L’agenda de chaque chef de gouvernement est, au quotidien et pour l’essentiel, un agenda européen. La politique européenne, qui était une « politique étrangère », est devenue l’ossature de la « politique intérieure » de chaque État. Le droit qui s’applique dans chacun des États est de plus en plus un droit européen, qu’il s’agisse de l’application directe de la législation européenne ou de projets de lois votés par les parlements de chaque pays qui doivent prendre en compte la nécessaire dimension européenne des politiques publiques nationales. En France, plus de la moitié de la législation est d’origine européenne, avec des variations fortes selon les secteurs (le droit de l’environnement, par exemple, est à 80 % européen). Mais qui le sait vraiment ? Les gouvernements sont-ils jugés sur leur capacité à mener une politique européenne ? La réponse est assurément négative. Plus étonnant encore, pour la clarté démocratique de la construction européenne, force est de constater que les constitutions des différents États membres de l’Union sont très largement silencieuses sur le fait européen. Par exemple, en France, rien n’est dit dans la Constitution de l’existence d’un droit européen spécifique – qui est pourtant d’applicabilité immédiate sur le territoire français et qui est supérieur à la norme française de même nature –, rien n’est dit du rôle des pouvoirs publics de la République tant dans son élaboration (pouvoir exécutif et législatif) que dans son application (pouvoir exécutif, législatif et judiciaire) et, surtout, de la possibilité pour les citoyens français (et européens) de se prévaloir de ce droit européen devant les juridictions nationales.
On ne le remarque pas suffisamment, mais les citoyens des différents États européens ont aussi beaucoup changé : ils sont de plus en plus éduqués, parlent mieux les langues étrangères que jadis, voyagent plus, étudient de plus en plus dans d’autres pays européens (le programme Erasmus d’échange d’étudiants a connu un succès considérable) ; habitués à un niveau de consommation et de bien-être que leurs grands-parents auraient eu du mal à imaginer, dans une économie totalement bouleversée (il y a moins de paysans en France que d’étudiants, le secteur des services produit bien plus de richesses que l’industrie « lourde »), habitués aussi à un monde en paix où les anciens conflits sur le sol européen n’ont plus de sens, ils se sentent sans doute de plus en plus européens. De plus en plus européens, mais dans quelle Europe ? Pour faire quelle Europe ? Comment investir cet espace aux contours si flous, aux règles si opaques ?
À cela on doit ajouter, bien sûr, que le monde a connu une profonde évolution. La chute du mur de Berlin et, à sa suite, du bloc soviétique, la réunification allemande, l’aspiration de nombreux pays d’Europe centrale et orientale à rejoindre les standards économiques et démocratiques de l’Europe « de l’Ouest », ont modifié l’équilibre des « blocs » issus de la guerre froide, et donc la place de l’Europe entre Est et Ouest. L’interpénétration des économies européennes, dans un monde lui-même de plus en plus « mondialisé », a transformé le regard que l’on pouvait avoir sur les échanges économiques internationaux, en particulier Nord-Sud, a placé l’Europe au cœur du maelström mondial de distribution des richesses, lui conférant une responsabilité particulière dans les nouveaux équilibres (économiques, financiers, environnementaux, scientifiques, militaires, culturels, etc.) de la planète. Des crises écologiques (par exemple la catastrophe de Tchernobyl en 1986) comme des problèmes de sécurité sanitaire (la « vache folle ») ont montré l’inanité des frontières nationales face aux grands défis de la modernité. Et, là encore, la question se pose : que faire de cette nouvelle puissance européenne dans ce nouveau monde ?
Ce qui peut alors sembler paradoxal, c’est que l’Union européenne, ses vin...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Copyright
- Table
- Dédicace
- UNE CONSTITUTION ?
- UNE CONSTITUTION FÉDÉRALE ?
- UNE DÉMOCRATIE EUROPÉENNE ?
- ET DEMAIN ?
- POUR ALLER PLUS LOIN
- INDEX
- Du même auteur
- Quatrième de couverture