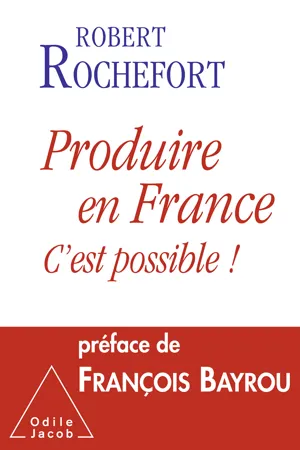
- 224 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Produire en France, c’est possible !
À propos de ce livre
« Produire en France » est devenu, à l'initiative de François Bayrou, l'un des thèmes majeurs de l'élection présidentielle. Non pas pour renouer avec le protectionnisme – ce serait une impasse –, mais tout simplement pour refuser l'effondrement de notre industrie et la progression effrénée du chômage. Si chaque consommateur acceptait de modifier seulement un de ses achats sur dix, en optant pour un produit « fabriqué en France », au lieu d'acquérir comme aujourd'hui un produit anonyme venant de l'autre bout du monde, le déficit de notre commerce extérieur serait réduit de moitié. L'activité pourrait repartir et plusieurs centaines de milliers d'emplois seraient créés sans que cela coûte un euro en dépenses publiques. Consommer mieux et non pas toujours plus, voilà qui va de pair avec la relance de la production sur le territoire national. Les Français se disent prêts. Et c'est possible ! À condition de le vouloir vraiment, d'en faire une priorité politique, de prendre les bonnes décisions et de mobiliser les énergies de tous. Robert Rochefort est député européen, vice-président du MoDem et proche conseiller de François Bayrou. Économiste et sociologue, il est spécialiste de l'analyse des attentes de la société. Il a dirigé le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) jusqu'en 2009. Plusieurs de ses livres portent sur les comportements des consommateurs (La Société des consommateurs, Le Consommateur entrepreneur, Le Bon Consommateur et le Mauvais Citoyen).
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Produire en France, c’est possible ! par Robert Rochefort en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politique et relations internationales et Politique. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Seconde partie
Produire à nouveau en France
pour consommer mieux
pour consommer mieux
Chapitre 4
L’inverse d’une démarche
protectionniste ou nationaliste
protectionniste ou nationaliste
La démarche visant à promouvoir à nouveau la fabrication française n’est pas de nature protectionniste. Il ne s’agit pas de recréer la moindre barrière douanière à nos importations. Ce serait tout simplement suicidaire. Heureusement, la France exporte encore et beaucoup de produits industriels (ils représentent 80 % des exportations). On a connu dans le passé certaines mesures de représailles qui mettaient en difficulté nos productions nationales, en particulier dans l’alimentation. Il ne faut pas s’exposer à ce que cela se reproduise. Nous voulons continuer à vendre à l’ensemble des pays de la planète tant dans les filières bien connues du luxe que dans tous les autres domaines où notre présence est réelle. Il faut pour cela remplacer la rentabilité et la compétitivité de notre économie et donc de ses entreprises. À cet égard, être performant vis-à-vis des consommateurs français renforce ses performances potentielles sur les marchés d’exportation.
Ce n’est pas davantage un appel à caractère nationaliste. Il faut soutenir le « fabriqué en France » et pas l’« acheter français ». La nationalité des marques n’a aucune importance. Il est même préférable d’acheter une marque étrangère qui a implanté ses usines en France qu’une marque d’origine française qui a délocalisé l’essentiel de sa production. D’où l’importance d’un label « fabriqué en France ». Nous y reviendrons.
Il ne s’agit en aucune manière d’un intégrisme qui chercherait à nous priver de la diversité des produits qui viennent d’autres cultures. J’adore les cuisines italienne et marocaine, les shortbreads britanniques et les gaufres bruxelloises, et je n’ai pas l’intention de m’en priver. En revanche, je suis moins attiré par les produits anonymes, n’ayant plus aucune personnalité, répandus uniformément dans tout l’univers occidental et même au-delà. Le made in Monde est le véritable fléau pour reprendre le titre du livre à succès de l’Américaine Suzanne Berger1. Il s’agit seulement de prendre conscience qu’un pays ne peut pas arrêter de produire et le nôtre est sur la mauvaise pente.
Prendre l’habitude de presque tout acheter en provenance de pays étrangers, c’est peu à peu perdre toute confiance dans ce que nous pouvons réaliser. Et c’est par conséquent perdre très vite les savoir-faire dans de nombreux domaines car, sans un nombre suffisant de clients, les entreprises abandonnent la production et elles ferment. L’absence de confiance s’autoentretient, elle fournit des prophéties « autoréalisatrices » comme dans de bien nombreux autres domaines.
C’est cette dérive suicidaire qu’il faut endiguer et ce cours des choses qui doit s’inverser. C’est le refus de la fatalité d’un déficit structurel qui oblige à la dépendance et qui aboutit au déclin.
Changer un achat sur dix !
Chaque mois, les Français dépensent environ 36 milliards d’euros en biens usinés pour leur consommation. Cela fait plus de 400 milliards sur une année. Envisageons que la croisade qu’il faut mener aboutisse à modifier 10 % de nos achats, seulement 10 %, mais réellement 10 %.
Pour le dixième de nos achats, faisons le choix raisonné d’être attentif au lieu de production et d’opter pour un produit fabriqué en France plutôt que pour un objet importé. Le choix doit être rationnel, c’est-à-dire qu’il doit se faire sans y perdre en rapport qualité/prix. C’est possible, cela doit être l’objectif. Pour être bref, le différentiel de prix doit pouvoir se retrouver dans un effort de qualité, de fiabilité et de durabilité.
Si donc nous modifions ainsi 10 % de nos achats, ce sont 40 milliards que l’on peut transférer des importations vers la production en France, c’est-à-dire plus de la moitié de notre déficit budgétaire. Et cela ne coûte pas un euro en niche fiscale, en exonération de droits, en subvention particulière. En pratique viendront se soustraire à ces 40 milliards les frais de commerce de demi-gros et de détail puisqu’ils sont approximativement les mêmes pour des produits importés ou de fabrication domestique. En revanche viendront s’additionner les ressources supplémentaires générées par la relance de la production, en activités induites (maintenance, entretien des locaux, etc.) et par les salaires forcément plus élevés que les allocations chômage ou les prestations d’assistance qu’ils remplacent.
Cet effort, il peut être accompli de la même façon dans les consommations intermédiaires des entreprises, dans les achats d’équipements, dans les fournitures. Cela peut sembler plus difficile. Car la pratique courante consiste à rassembler en une fonction achat centralisée au sein de chaque grande entreprise tous les approvisionnements dont elle a besoin. Cette obsession, car c’en est une, consiste à pressurer les fournisseurs sans état d’âme et à passer de l’un à l’autre, parfois pour ne gagner que quelques centimes sur chaque pièce acquise. Elle force à acquérir la même référence, afin de faire nombre là où par le passé dans l’entreprise chacun pouvait personnaliser ses acquisitions en fonction de ses besoins spécifiques.
Les « acheteurs » de ces services spécialisés sont des purs comptables, ils n’ont pas d’états d’âme et l’on croit que c’est un atout qu’ils ne connaissent pas grand-chose aux commandes qu’ils passent, afin de n’avoir aucune complaisance. En pratique, ils ne sont pas armés pour juger de la qualité et les centimes gagnés sont vite reperdus par l’usage insatisfaisant auquel on aboutit. Évidemment, l’origine du produit est alors de peu d’importance. Mais cela changera car les consommations intermédiaires des entreprises entrent dans le calcul de la proportion de la valeur ajoutée fabriquée en France. Et ceux qui voudront obtenir le label « fabriqué en France » afin d’accroître leurs ventes seront bien obligés d’en tirer les conséquences.
Mieux utiliser les marchés publics
Les administrations doivent être mises à contribution, au moins pour faire face à leurs responsabilités. Certaines commandes publiques récentes sont choquantes. La Poste vient de créer la surprise en passant commande d’une flotte de plusieurs milliers de scooters à une marque taïwanaise. Est-ce un si bon calcul ? Qui réparera le scooter taïwanais attribué à un bureau rural lorsqu’il sera en panne ? Il y a fort à parier qu’il attendra plusieurs semaines avant d’atteindre le garage capable de le prendre en charge.
La ville de Reims s’est procuré des pavés chinois pour refaire une chaussée. Elle n’est pas la seule à le faire, près des trois quarts des « nouveaux » pavés sont importés. La municipalité de Toulouse vient de refaire une rue de la ville rose à partir de dalles de marbre, là aussi venues de l’Empire du Milieu. Alors qu’il existe des carrières susceptibles de fournir des matériaux identiques à quelques dizaines de kilomètres seulement ! Elles n’étaient pas en mesure de fournir les quantités désirées dans le laps de temps imparti, paraît-il. Stupide ! Qu’à cela ne tienne, n’aurait-il pas été préférable de reporter le chantier de quelques mois pour permettre de s’approvisionner régionalement ? C’est une rentabilité truquée car les porte-conteneurs qui transportent ces minéraux à travers les mers utilisent du carburant totalement détaxé et font travailler des salariés au droit social minimal sur des bateaux sous pavillon de complaisance.
L’exemple le plus choquant sur le plan des symboles est certainement celui qui vient de la Sécurité sociale. Les cartes Vitale seraient désormais fabriquées en Inde alors qu’elles provenaient jusqu’ici d’une usine située en Dordogne. Comment une telle aberration est-elle possible ? Je ne doute pas que le prix soit désormais moins cher. Mais l’assurance-maladie a-t-elle conscience que les économies ainsi réalisées généreront aussitôt des pertes sur ses propres comptes par le montant des cotisations sociales qui ne seront plus encaissées des salaires perdus par ceux qui, à cause de cette décision, iront peut-être pointer au chômage ? Et si l’on ajoute à cela les indemnités que ces nouveaux chômeurs percevront à Pôle Emploi, le calcul global pour la collectivité est vite fait. L’ensemble des caisses sociales paiera très cher ce choix destiné théoriquement à leur faire faire des économies2 ! Je suis convaincu que le niveau auquel cette décision est préparée n’a pas pleinement perçu les conséquences de ce choix et je pense même qu’il sera assez vite inversé. Le prochain marché, lorsqu’il faudra le renouveler, sera passé avec une entreprise fabriquant en France tant l’image de cette erreur est dévastatrice.
C’est dans ce même département de la Dordogne que, début 2011, la société Marbot-Bata a été liquidée après avoir perdu le marché de la fabrication des rangers militaires pour l’armée française, faisant perdre leur emploi aux 73 salariés de l’entreprise.
Une dictature néfaste règne sur les marchés publics. Afin de moraliser la vie publique, puis pour faire baisser les coûts, les procédures se sont figées et n’ont plus de souplesse. La plupart du temps, c’est le moins-disant qui est retenu. Pourtant, ce n’est ni obligatoire ni même ce qui est recommandé. En théorie, l’adjudication doit se faire au mieux-disant, façon là aussi de faire jouer le rapport qualité/prix, seul véritable étalon de la gestion optimale des ressources. Cela renvoie évidemment à la notion de qualité. Comment la définir objectivement ? Il y a la durabilité, la fiabilité de ce que l’on achète, ce sont là des critères objectifs. D’autres critères peuvent également jouer. Certains peuvent apparaître subjectifs comme le design, le coloris, le toucher.
Enfin, il y a ceux que les nouveaux défis environnementaux et sociaux imposent. À partir de quelles normes sociales minimales un produit peut-il être acceptable ? Quels sont les critères de développement durable qu’il faut retenir et quel est le bilan carbone de transports sur plus de dix mille kilomètres de matériaux particulièrement pondéreux ? Il manque à cet égard des normes, des guides reconnus par tous et dont puissent s’inspirer les opérateurs publics. Car beaucoup sont aujourd’hui inquiets de la judiciarisation à tout-va qui engendre facilement des contentieux dès que des entreprises éconduites et fâchées attaquent l’attribution d’un marché à l’un de leurs concurrents. C’est pour éviter ce genre de procédure et donc un peu avec lâcheté que le moins-disant est préféré au mieux-disant.
La pression concurrentielle est – paraît-il – une bonne façon de préserver les intérêts des contribuables, de garantir qu’elle assure la productivité maximale à l’euro près. Elle aboutit cependant, lorsqu’elle devient une règle absolue, à des exclusions regrettables de nombreuses PME. Dans la Révision générale des politiques publiques (RGPP), figure le regroupement des commandes sur tout le territoire, en provenance d’administrations distinctes, pour atteindre des ordres de telle ampleur qu’ils doivent permettre d’obtenir le prix le plus bas. Dans certains cas, cela mène tout droit à la catastrophe. Des PME régionales qui fournissaient depuis longtemps certaines administrations de leur voisinage sont brutalement exclues des marchés. Non pas que leur performance soit mauvaise, mais elles n’ont pas la taille suffisante pour candidater au niveau national. Arrêtons de penser que « Big is beautiful ».
L’attribution à une très grosse entreprise d’un très gros marché aboutit forcément à des standardisations en partie contre-productives. Les entrepreneurs de taille intermédiaire, qui connaissent leurs clients publics depuis longtemps, peuvent les comprendre et les satisfaire pleinement. Et s’il faut renforcer les contrôles a posteriori pour vérifier qu’il n’y a pas de surtarification, que tout est payé à son juste prix, eh bien faisons-le ! Allons plus loin encore, autorisons le regroupement de plusieurs PME, a priori concurrentes mais susceptibles de devenir alliées pour vendre localement à un hôpital ou à une mairie… Il est possible de favoriser tout cela tout en garantissant une mise en concurrence minimale avec d’autres fournisseurs ou bien en possédant des références, sur des marchés passés ailleurs, de prix qu’il n’est pas acceptable de dépasser.
De même, les entreprises de l’économie sociale et solidaire doivent être soutenues dans la possibilité d’obtenir des marchés publics. N’est-ce pas d’abord à l’intérêt général qu’elles contribuent ? Là aussi, c’est un encouragement à produire en France, car, dans ce secteur, il n’y a guère de pratiques de délocalisation, ce n’est pas dans sa culture et c’est opposé à ses finalités.
Responsabiliser les caisses d’assurance-maladie
Le secteur de la santé mérite une attention particulière. La majorité des dépenses est remboursée par la Sécurité sociale et par les mutuelles. Or, peu à peu, les approvisionnements se font en désertant la production française. Cela est d’autant moins acceptable que la baisse des coûts n’est pas la justification réelle de cette dérive. C’est souvent à l’accroissement des marges que cela sert. Accordons une attention particulière aux médicaments, aux lunettes et aux prothèses dentaires.
La diffusion des médicaments génériques est une bonne chose. Elle supprime la rente qui revient à l’inventeur lorsque le brevet tombe dans le domaine public. Les habitudes de prescription et la rigidité à la baisse des tarifs réglementés font que le remboursement par l’assurance-maladie assure la plupart du temps de confortables bénéfices aux laboratoires qui possèdent quelques bons produits blockbusters. Nous avons encore des marges de progression puisque le taux de génériques est en Allemagne deux fois plus élevé qu’en France.
En revanche, le passage au générique entraîne une progression massive des importations, surtout en provenance d’Inde. Ce pays continent s’est en effet spécialisé depuis longtemps dans cette industrie. Étonnamment, alors que le secteur du médicament fournit le troisième excédent commercial de notre pays pour 7 milliards d’euros ! L’explication de ce paradoxe est simple et purement réglementaire. Il est absolument interdit de produire des médicaments génériques dans notre pays avant que le brevet du produit princeps tombe dans le domaine public. Les génériques sont donc préparés et fabriqués ailleurs pour pouvoir inonder le marché le jour J. Une fois cette délocalisation effectuée dès le départ, elle perdure car il n’y a guère de raison à relocaliser.
C’est absurde, rien ne justifie sur le fond que l’on fabrique moins de médicaments en France et en Europe. D’autant plus qu’il s’agit d’une activité extrêmement mécanisée dans laquelle le coût de la main-d’œuvre n’est pas l’essentiel. Quant au marché de l’Union européenne, ses 500 millions de ressortissants lui donnent une taille suffisante pour amortir l’investissement pour des grosses productions en série.
En tant que financeurs des dépenses de santé, les assureurs collectifs européens à caractère social (l’assurance-maladie et les mutuelles pour la France) se doivent d’entreprendre des négociations avec les laboratoires et la Commission européenne pour que l’on assure le maintien et même le développement de l’outil industriel du médicament tant en France qu’en Europe, y compris pour les génériques. Et la France modifier ses réglementations en conséquence.
Comment ne pas voir que leur intérêt bien compris est de jouer la carte de l’emploi et des rentrées de cotisations sociales ? Plus de chômage, c’est immédiatement moins de recettes pour l’assurance-maladie.
L’optique est un secteur qui doit susciter aussi une attention particulière. Environ 70 % des montures distribuées par les grandes chaînes d’opticiens proviennent d’Asie. Or cela ne les rend pas vraiment moins chères pour les consommateurs français qui ignorent d’ailleurs la provenance de leur paire de lunettes. Le réseau Atol et certains opticiens indépendants se battent avec succès pour défendre une production nationale. Ils sont minoritaires. Là encore l’assurance-maladie et les mutuelles se doivent de réagir. Pourquoi ne pas porter enfin à un niveau décent le remboursement des lunettes par les caisses en contrepartie d’un engagement collectif à favoriser l’outil industriel hexagonal ?
Il faut aussi s’intéresser aux prothèses dentaires. Les chirurgiens dentistes réalisent les deux tiers de leur activité en soins dentaires et un tiers en pose de prothèses. Or leur chiffre d’affaires est inversé : ils tirent les deux tiers de leur revenu de la pose de prothèses. Là encore, le financement par les caisses est très faible. Au point qu’il est devenu fréquent que des praticiens soignent différemment en fonction de la solvabilité de leurs patients liée à la mutuelle dont ils disposent.
Ces derniers savent-ils que les prothèses qu’ils portent en bouche sont de plus en plus souvent fabriquées en Chine ? Leurs dentistes se gardent bien de les prévenir car cela n’entraîne pas forcément une baisse des devis.
Qu’il s’agisse de médicaments, de lunettes ou de couronnes dentaires, les économies de coût résultant de la fabrication asiatique servent les bénéfices des importateurs, des intermédiaires et de ceux qui les facturent. Tout comme pour le textile lors de la fin des quotas d’importations chinoises, les tarifs sont rigides à la baisse du fait de l’habitude ancrée dans l’esprit des clients, même lorsque ces tarifs sont élevés. Évidemment le remboursement collectif amplifie cette inertie.
Le moment est venu pour tous les assureurs sociaux d’assumer leurs responsabilités et de retirer leurs œillères. Ils ne doivent pas rester prisonniers d’une gestion qui cherche des économies immédiates – dont les caisses ne récupèrent qu’une partie – au détriment de l’emploi, et ce d’autant plus que leurs recettes en dépendent directement.
Encourager la qualité, allonger la durée des garanties
Il ne s’agit pas de contraind...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Du même auteur
- Copyright
- Préface
- Introduction
- Première partie - L’impasse d’une société de consommation sans usines
- Seconde partie - Produire à nouveau en France pour consommer mieux
- Conclusion
- Postface
- Remerciements et dédicace