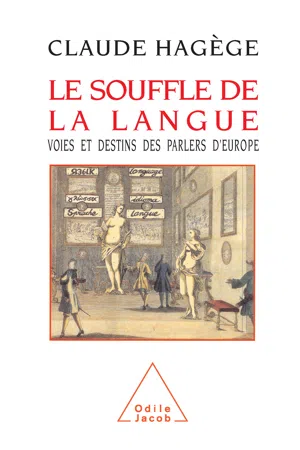CHAPITRE 1
De la langue commune
Langues nationales et langues communes
Par un étonnant retour de l’histoire, il vient d’apparaître en Europe un nombre de langues d’États plus élevé encore qu’à cette époque des lendemains de la Première Guerre mondiale, où la réponse différée aux clameurs de 1848 aboutit à la création de nouveaux pays sur les décombres des empires centraux. La situation présente résulte, comme on sait, de l’éclatement de l’Union Soviétique et de la Yougoslavie. Or beaucoup d’esprits, en Europe, sont habités par la nostalgie d’une langue commune. Il s’agirait d’une langue européenne capable de satisfaire, en dépit des obstacles que dresse la multiplicité, le désir d’échange propre à notre nature : une langue, donc, dont l’usage transcenderait les cloisonnements nationaux, car elle serait commune à tous les Européens.
En effet, si c’est aux dimensions d’un seul État plurilingue qu’est réduit l’établissement d’une langue commune, on aboutit à une situation ambiguë. Certes, dans le meilleur cas, cet État vise à garantir les moyens d’une large communication entre membres de nationalités différentes, et à leur permettre de s’intégrer tous à la vie sociale qui fonde leur identité. Mais par là, ceux pour qui la langue commune est étrangère se trouvent contraints de l’apprendre, afin de ne pas compromettre les conditions de leur vie civique. Or, parmi ces derniers, les plus modestes, ou ceux qui vivent dans les régions les plus reculées, peuvent, grâce aux traductions faites en langues nationales, avoir accès à une certaine culture. Cette forme de démocratisation rend moins nécessaire l’usage d’une langue commune, qui, paradoxalement, peut être elle-même, par certains de ses effets, une mesure démocratique. Par conséquent, c’est plutôt aux dimensions du continent entier que la notion de langue commune présente une utilité. La multiplication des États indépendants, qu’ils soient unilingues ou, à plus forte raison, plurilingues, doit, certes, être considérée comme féconde et bénéfique. C’est elle qui fonde la richesse culturelle de l’Europe. Mais en même temps, elle a pour conséquence d’accroître le nombre des ouvrages de même contenu, notamment dans le domaine des sciences et des techniques. Une telle situation peut faire naître le désir d’une langue commune, qui paraît répondre au souci d’économie. Or il se trouve que la partie occidentale de l’Europe a longtemps possédé une langue de ce type, qui avait, de surcroît, l’avantage de n’être langue nationale dans aucun pays, s’il est vrai qu’elle était langue officielle dans un grand nombre. Cette langue, c’est le latin.
Le latin, pilier de l’Europe occidentale
La diffusion du latin dans les territoires coloniaux soumis à l’impérium romain est un fait presque unique dans l’histoire des langues. En quelques siècles, ou même, pour certains cas, en moins d’un siècle, à ce tournant décisif des millénaires qui précède et suit le début de l’ère chrétienne, la romanisation des peuples soumis fait l’effet d’un ouragan. Le latin se substitua aux idiomes vernaculaires non seulement dans la communication publique, mais bientôt même dans les foyers. Ainsi s’engouffrèrent dans les brumes de l’oubli l’ombrien, le messapien, l’osque, le ligure, l’étrusque, le gaulois, l’ibère, l’illyrien, le dace. Il y eut, néanmoins, une exception remarquable : le latin ne parvint pas à chasser le grec de Grèce, d’Asie Mineure et d’Égypte, partageant avec lui le statut de langue administrative, mais non celui de langue de communication ni celui de langue de culture, domaines où le grec régnait seul ; et de surcroît, à Rome même, le grec fut adopté comme langue d’éducation par les milieux cultivés.
Lorsque plus tard, au milieu du Ve siècle, les langues régionales, dans les pays de la Romania, commencèrent à s’individualiser, devenant de plus en plus dissemblables, le latin ne cessa pas de s’écrire pour autant. Bien au contraire, après une éclipse en Gaule à l’époque mérovingienne, il profita de l’impulsion des études classiques sous les Carolingiens, ce qui lui assura durant tout le Moyen Âge le rang de langue de l’Église et de langue savante. Il sera au XIIe siècle le moyen d’enseignement courant dans les universités, et cela non seulement en pays de langues romanes, c’est-à-dire néo-latines, mais aussi en Angleterre, Irlande, Allemagne, Pologne, Suède, tous pays dont les professeurs et savants communiquent entre eux, à travers l’Europe médiévale, en langue latine. À partir du XVIe siècle, cependant, les querelles religieuses serviront, au détriment du latin, les langues vernaculaires, par le biais desquelles on peut mieux atteindre le plus grand nombre. Car ce n’était pas parmi les masses que le latin était répandu. À mesure que les langues nationales étendaient leurs domaines d’usage, celui du latin se réduisait. Mais du même coup, réservé aux emplois savants, il devenait une sorte de langue commune de la pensée : celle dont la connaissance donnait accès aux œuvres des philosophes et rendait possibles débats et controverses, quels que fussent les pays d’origine ; celle, aussi, qui permettait de conserver les doctrines. Ainsi, ce ne furent pas des facteurs économiques, contrairement à ce qui est le cas pour les langues communes d’aujourd’hui, qui assurèrent le long règne du latin, mais seulement son rôle dans les choses de l’esprit.
Cependant, la forme que les humanistes de la Renaissance avaient fixée était celle du latin classique. Il est possible que ce choix ait contribué au déclin du latin. Car dès lors qu’il se figeait dans une pureté antique, il devenait moins apte à rendre les idées modernes et la fluidité d’une pensée scientifique sans cesse modifiée au contact des faits. L’interrogation permanente des phénomènes naturels produit chez les physiciens, chez les chimistes, chez les naturalistes, le besoin de termes nouveaux et de tournures souples, plus adaptées à une recherche ouverte que les formules apprises. La forme de latin qu’on imposa, dominée par le souci de correction, rendait la langue improductive, et la cantonna bientôt dans l’enseignement philosophique, l’expression des vérités révélées de la religion, et les exposés de science traditionnelle, ainsi que les mathématiques, où l’on opère avec des notions abstraites et où le latin s’est maintenu jusqu’au XIXe siècle (cf. Meillet 1928, p. 37). Il eût mieux valu laisser libre cours au latin, au lieu d’aggraver les inconvénients qui s’attachent à l’emploi d’une langue morte comme moyen d’expression dans les sciences. Il s’est trouvé que le recours aux langues modernes, en Europe, dans le monde savant a pris de plus en plus figure de signe : celui d’un désaveu du propos traditionnel sur le monde, et par là même du latin, qui était le vecteur de ce propos. 1637 est une date importante dans l’histoire de la langue française littéraire : car c’est alors que Descartes publie, en français, et non en latin, son Discours de la méthode.
À partir du milieu du XVIIIe siècle, le latin cesse progressivement d’être la langue de correspondance des savants. Même dans le doctorat ès lettres, la thèse latine, maintenue en France au XIXe siècle, n’est plus, alors, qu’un pensum de pure forme. Au XXe siècle, le latin a perdu son statut de langue de culture de l’Europe, et n’est plus entendu : quand, en août 1939, le président de la République Estonienne, K. Päts, adjura la communauté mondiale, par un appel radiophonique solennel, de maintenir à tout prix la paix, gravement menacée, il le fit en latin, ne parlant pas assez couramment l’anglais, le français, l’allemand, ni le russe. Certes, les dés étaient jetés, et la Seconde Guerre mondiale allait éclater quelques jours plus tard. Mais cette action n’eut pas même d’effet dilatoire. Épisode tragi-comique, hélas, l’appel ne fut pas compris (cf. Haarmann 1975, p. 216).
Gloire ambiguë du castillan
Il se trouve qu’une grande langue européenne, héritière du latin, est apparue comme l’intermédiaire par lequel ce dernier conquérait d’immenses terres éloignées. L’illustre année 1492, dont on vient de commémorer le cinquième centenaire, n’est pas seulement celle de la chute de Grenade, point d’orgue de la Reconquête et fin de l’islam andalou, celle de l’expulsion des Juifs, celle, enfin, où sont mises à voile les caravelles de Colomb. C’est aussi l’année de gloire du castillan.
Le castillan, langue d’État et la conquête de l’Amérique
En 1492, un professeur de rhétorique de l’université de Salamanque, A. de Nebrija, compose à l’intention des Rois Catholiques une Grammaire du castillan. C’est le premier ouvrage de ce genre, en Europe, à codifier une langue vulgaire, alors que le latin est loin d’avoir perdu son prestige, puisque le même Nebrija avait, en 1481, publié une Grammaire latine qui contribua fortement à jeter les bases de l’humanisme en Espagne. Dans la dédicace de 1492 à la reine Isabelle, on lit ces mots célèbres (dont il importe peu de savoir si Nebrija les a ou non repris à un contemporain, car ils reflètent bien l’esprit du temps) : « La langue a toujours accompagné la puissance. » De fait, les langues autres que le castillan, seul symbole du pouvoir politique, ne cessent de reculer, notamment le catalan ; et quant à l’aragonais, dont Ferdinand ne surestimait pas le poids dans l’alliance des deux couronnes, il est en plein déclin (cf. Pérez 1988, p. 400). Ainsi, le castillan reçoit les normes propres à un instrument de communication que les armes, les prêtres et les ambassadeurs de l’Espagne vont répandre dans le nouveau monde au XVIe siècle. Et l’on sait qu’en Amérique latine, l’espagnol est le plus souvent désigné par son nom exact de castellano, l’appellation d’español étant relativement récente, en tout état de cause.
L’étonnante aventure de l’espagnol dans les terres situées au sud du Rio Grande justifie le nom d’Amérique latine. À peine consacré comme haute langue à l’égal du grec et de l’hébreu, l’espagnol transportait en Amérique, sous les vêtements que les siècles lui avaient donnés en Espagne, ce même latin dont d’autres langues romanes, en France, en Italie, au Portugal, en Roumanie, prolongent aussi l’ancienne domination. Ainsi, l’Amérique indienne se latinisait à travers l’espagnol. Les Aztèques, les Incas, et bientôt une grande diversité d’autres nations, recevaient, par la voie de l’évangélisation en espagnol, le dépôt différé de la langue et de la civilisation latines. Car l’Église catholique et romaine en était devenue le pilier, et la Castille, après sa victoire sur les Maures, se considérait comme l’avant-garde de cette Église. L’espagnol, fils du latin, était parvenu à se maintenir en Péninsule Ibérique malgré huit siècles de domination arabe, qui suivaient eux-mêmes trois siècles d’occupation vandale et wisigote, alors que dans une autre péninsule, celle des Balkans, les Thraces et les Illyriens, peuples latinisés, avaient ensuite été slavisés. Mais l’espagnol n’apparaissait pas seulement comme l’âme ressuscitée du latin venant romaniser les Amériques. Il allait même, intercesseur et messager, faire voyager d’une langue indienne à l’autre, au long des migrations qui le transportaient partout, certains vocables autochtones. Ou bien il allait, à travers sa présence de langue étrangère unifiée, favoriser par contrecoup, comme une réaction de défense, la promotion de koinês locales au-delà des dispersions dialectales, ainsi qu’il advint pour les langues de la famille tupi-guarani, au Paraguay.
Quels titres au statut de langue commune en Europe l’espagnol peut-il puiser dans une destinée aussi extraordinaire ? Moins qu’il n’en paraît, en réalité. Car l’espagnol n’a jamais vraiment, au cours de son histoire, connu d’utilisation comme langue de communication supranationale en Europe. Il n’y est pas plus répandu que le polonais ou l’ukrainien, qui, comme lui, ont entre trente et trente-cinq millions de locuteurs. Il a, certes, été, au gré des unions dynastiques, parmi les langues maternelles de souverains qui ont régné sur des empires plus étendus que l’Espagne. Mais il n’a pris nulle part une place dominante : ni au Portugal ni au-delà de la Péninsule Ibérique, par exemple aux Pays-Bas espagnols durant les XVIIe et XVIIIe siècles, ou à Milan, ou à Naples. Il aurait eu vocation à devenir une des langues communes de l’Europe, si l’histoire ne l’avait orienté vers les façades lointaines de l’océan, et si un certain type de société, d’économie et d’usage politique du religieux n’avait façonné en Espagne, jusqu’au milieu du XIXe siècle, une civilisation assez étrangère à celle qui était commune aux autres États d’Occident. Il est vrai, cependant, que la place croissante tenue aux États-Unis par les variantes américaines du castillan, c’est-à-dire portoricain à l’est et mexicain à l’ouest, peut apparaître comme une promesse quant à l’avenir de l’espagnol. Ses défenseurs auraient lieu de rêver au jour où, ayant investi une partie de l’Amérique plus vaste encore qu’aujourd’hui, il regagnerait l’Europe en triomphateur. Quoi qu’il en soit, il ne se présente pas, pour l’heure, comme un des modèles fédérateurs du continent européen.
L’expulsion des Juifs, la gloire du judéo-espagnol et son agonie
Si pourtant l’on retient, parmi les traits qui définissent ces modèles, l’existence d’un épisode historique de diffusion à travers l’Europe, il faudrait alors inclure l’espagnol. Les Rois Catholiques n’ont certainement pas contraint à l’exil quelque 150 000 Juifs pour se donner et donner à leurs descendants le plaisir de contempler l’essaimage de ceux qui portaient au loin le castillan. Ils l’ont fait parce que leur idéologie ne les mettait pas en ...