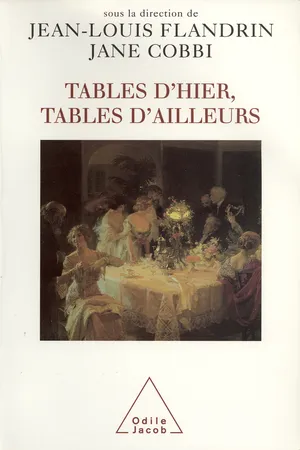
- 480 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Tables d'hier, Tables d'ailleurs
À propos de ce livre
Chez les Romains de l'Antiquité, le pain et les légumes se mangeaient à toute heure, hors des repas — plutôt centrés sur les viandes. La collation aux champs des paysans vietnamiens passe pour n'être qu'une boisson. Dans l'ancien service à la française, les plats disposés sur la table n'étaient pas censés être consommés par chacun des convives. Chez les Pygmées, chaque famille partage la nourriture qu'elle cuisine avec tout le campement. En Inde, ceux qui donnent un banquet offrent aussi des cadeaux alimentaires. Qu'est-ce qu'un repas ? Qu'est-ce qu'une boisson ? Des historiens et des ethnologues répondent, brossant un tableau des pratiques de tables, des règles alimentaires, des usages conviviaux à travers les différentes cultures. Jean-Louis Flandrin est professeur émérite à l'université de Paris-VIII et directeur d'études à l'EHESS. Il a notamment publié Le Sexe et l'Occident, Histoire de l'alimentation et Chroniques de Platine. Jane Cobbi est directeur du groupe de recherche « culture matérielle et vie quotidienne au Japon » du CNRS.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Tables d'hier, Tables d'ailleurs par Jean-Louis Flandrin,Jane Cobbi en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Art et Art général. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
PREMIÈRE PARTIE
Tables d’hier
Manger entre citoyens
Les repas dans les cités grecques antiques
par PAULINE SCHMITT PANTEL
« Il faut se figurer une de ces petites sociétés primitives rassemblée tout entière, du moins les chefs de famille, à une même table, chacun vêtu de blanc et portant sur la tête une couronne : tous font ensemble la libation, récitent une même prière, chantent les mêmes hymnes, mangent la même nourriture préparée sur le même autel ; au milieu d’eux les aïeux sont présents et les dieux protecteurs partagent le repas. De là vient l’intime union des membres de la cité. » Ainsi Fustel de Coulanges, dans La Cité antique, met en scène les repas des anciens Grecs et en fait un des éléments clefs de la cohésion sociale1.
Depuis 1864, date à laquelle Fustel de Coulanges publia ces lignes, les historiens se sont peu intéressés aux repas grecs. Tout ce qu’il fallait connaître à leur sujet paraissait être résumé dans les articles du Dictionnaire des antiquités qui leur avaient été consacrés à la suite d’une compilation massive des sources antiques2. Les repas faisaient tout au plus l’objet d’un chapitre dans tout livre traitant de la vie quotidienne3. Depuis peu, toutefois, le domaine de l’alimentation et de la consommation grecques a été l’objet de nouvelles approches qui permettent de parler différemment des repas.
L’alimentation grecque tout d’abord est mieux connue grâce aux recherches sur les techniques agricoles et de transformation des aliments, sur l’approvisionnement et les phénomènes de pénurie comme les disettes et les famines, sur le régime alimentaire, vu sous le regard des médecins, et sur l’ivresse4. La sociabilité que créent les repas est au cœur de travaux qui s’intéressent au symposion, c’est-à-dire au moment où les Grecs buvaient ensemble et développaient un grand nombre d’autres activités comme la conversation, le chant et la poésie, le jeu5. La valeur symbolique des aliments consommés et leur fonction essentielle dans la définition grecque du partage entre le monde des dieux et le monde des hommes sont mieux cernées grâce aux enquêtes sur les formes du sacrifice et de la consécration du vin6. On explore aussi la place des repas dans la vie de la cité comme marque de la citoyenneté et comme critère de différence entre des régimes politiques à différents moments de la longue histoire des Grecs7. Ajoutons à cela les résultats des fouilles archéologiques qui chaque année mettent au jour de nouveaux bâtiments où se tenaient ces repas – de la pièce réservée à cet usage dans la maison privée au grand complexe de salles de banquets dans certains sanctuaires –, et l’étude en plein renouvellement des images de scènes de banquet, on voit que le thème des repas est maintenant au carrefour de recherches portant sur des sources diverses et de problématiques variées elles aussi8. Il n’est pas question ici en quelques pages d’essayer de faire une synthèse de tant d’apports, mais plutôt de rappeler les traits caractéristiques des repas grecs puis de choisir un axe, celui des banquets publics, pour replacer ces repas dans une dynamique historique.
Repas à la grecque
Observons une cité au banquet, telle que la met en scène Euripide. Il s’agit du festin offert par Ion aux habitants de Delphes. « Un héraut, se haussant sur la pointe des pieds, ensuite proclama que tous les Delphiens pouvaient, s’ils le voulaient, prendre place au banquet. Et la salle étant comble, on vit les conviés se couronner de fleurs et s’emplir à cœur joie d’une chère abondante. Puis l’appétit calmé, un vieillard s’avançant au milieu de la foule fit beaucoup rire les convives par son zèle empressé : tantôt il versait sur leurs mains l’eau des aiguières, ou faisait évaporer la sueur de la myrrhe, ou se chargeait lui-même de présider au service des coupes d’or. Enfin l’heure venue des flûtes, du cratère commun, le vieillard dit : “Enlevez ces petites coupes de vin, il faut nous apporter les grandes pour mettre tous nos gens plus vite en belle humeur.” Et les phiales d’or et les coupes d’argent circulaient9. » Ce texte permet de présenter quelques traits caractéristiques des banquets grecs.
Manger puis boire
Le repas se compose de deux activités différentes qui se succèdent. Manger : la prise de nourritures solides, essentiellement des céréales, sous diverses formes, et des viandes, occupe le premier temps du banquet. Boire : la consommation du vin, préalablement préparé (le vin pur est mélangé à de l’eau dans des proportions fixées d’un commun accord par les convives), commence une fois l’appétit calmé, le ventre rassasié. Quand le cadre le permet, les deux moments du banquet sont nettement séparés : les tables sur lesquelles les nourritures étaient présentées sont enlevées et remplacées par d’autres sur lesquelles les coupes succèdent aux plats. Les convives se lavent les mains, se parfument, se couronnent, bref se préparent à la partie la plus longue et la plus agréable du banquet. Ce deuxième temps du banquet porte un nom particulier : symposion, soit le fait de boire ensemble. Manger puis boire, « repas » et symposion, sont les deux faces indissociables et complémentaires des banquets grecs.
Mais le repas est d’abord le signe du rapport entre les hommes et les dieux, il est le dernier temps du rite du sacrifice. En effet, les viandes qui forment l’essentiel des mets du « repas » proviennent d’animaux sacrifiés, quel que soit le type de repas. Les bêtes, des animaux domestiques et, en particulier, des bœufs, sont abattues, dépecées, partagées rituellement et leur viande est ensuite consommée soit immédiatement après le sacrifice, soit de façon différée, lors du repas.
Le déroulement du sacrifice sanglant alimentaire grec est bien connu : à la mise à mort de la bête succèdent un premier partage entre la part des dieux (les os et les graisses brûlées sur l’autel) et la part des hommes (les chairs), puis un second partage entre les hommes selon différentes modalités faisant jouer à la fois la hiérarchie et l’égalité. On donne par exemple des parts d’honneur aux représentants de l’autorité politique comme les magistrats ou religieuse comme les prêtres, puis le reste de la bête est réparti de façon égale entre les participants. La présence d’un mageiros (sacrificateur et découpeur des viandes) est souvent requise10. Les viandes sont ensuite soit rôties enfilées sur de longues broches soit cuites dans un chaudron. La cuisson et la consommation des viandes et d’autres aliments parmi lesquels les céréales qui ont, elles aussi, été consacrées, marquent les dernières étapes de ce rituel complexe, étapes qui sont senties comme l’aboutissement du sacrifice, même si un certain temps s’intercale entre l’abattage de la bête et le repas.
La signification de ce repas est double : le repas rappelle le temps où hommes et dieux vivaient ensemble et prenaient part à de grands banquets, mais il répète aussi la séparation définitive entre le monde des dieux et celui des hommes, racontée dans le mythe de Prométhée11, les seconds étant désormais les seuls à consommer les viandes et autres aliments, à travailler la terre, à se reproduire et à mourir. Tout repas est donc un moment du rite qui essaie de définir la place respective du divin, de l’humain et du bestial (les bêtes ne sacrifient pas et mangent cru). Ainsi, si le fait de manger de la viande dans une société rurale traditionnelle est un événement rare et une source de contentement, le plaisir pris aux grillades a un important arrière-fond : la consommation des chairs est une des pratiques symboliques constitutives de l’identité de la cité.
On peut en dire de même de la consommation du vin. De la culture de la vigne jusqu’à l’ivresse en passant par le bon usage du mélange dans le cratère, le vin est placé sous le signe de Dionysos et des valeurs que ce dieu promeut dans les cités. Le symposion est, comme le repas, un rituel qui a un aspect sacré, qu’il soit à l’image irénique du banquet idéal que propose le poète Xénophane12 ou à celle, plus mouvementée, que créent les peintres des vases attiques. La libation, l’invocation, la prière, la possession, le plaisir sont autant de marques des liens qui unissent le monde des dieux et celui des hommes, et l’usage réglé du vin est une des composantes de tout banquet grec chez les particuliers comme dans le cadre de la cité.
« Repas » et symposion tirent leur valeur non seulement des aliments absorbés, mais aussi de la consommation en commun, de la commensalité qui fonde ou renforce les liens sociaux et exprime la communauté.
Une pratique communautaire
En effet, manger et boire sont des actes qui en eux-mêmes n’ont guère d’intérêt. L’important pour les Grecs est le type de rapport qui s’instaure autour de la nourriture et de la boisson prises en commun, comme le montre une étude du vocabulaire des repas.
La langue grecque utilise en ce domaine de très nombreux mots qui peuvent se regrouper autour de quelques grandes familles sémantiques13. La première concerne la notion de partage : autour de la racine * dai- qui signifie « partager » sont forgés les noms du « repas-partage », la dais, de ceux qui se partagent un repas, du verbe « festoyer »… La deuxième concerne la notion de communauté, rendue par des mots commençant par le préfixe sun –, « avec ». Ainsi le sussition (syssitie) est le « repas où l’on mange avec », le « repas commun », le sumposion, « le fait de boire avec », le sundeipnos, le « convive », et l’on pourrait allonger la liste. La troisième est la notion d’accueil auprès du foyer, hestia, et d’hospitalité : recevoir quelqu’un auprès du foyer, c’est l’accueillir pour un repas (verbe : hestiaô), d’où le substantif hestiasis, « repas », et d’autres mots dérivés de la même notion. D’autres termes utilisés font référence à la notion de joie (thalia), de plaisir (eilapinê), de régal (thoinê), au sentiment d’être bien (euphrosunê, euochia), voire à celui d’amour (agapê). Tous ces termes sont polysémiques et ne désignent spécifiquement les repas que parfois. Il en est de même d’un terme précis : eranos, dont le sens peut être « le repas où chacun apporte son écot ». Bref, cet échantillon des mots montre que les idées de nourriture et d’assouvissement des besoins de l’individu ne sont pas celles que la langue grecque met en avant, y compris d’ailleurs dans les trois termes qui indiquent le moment de la prise de nourriture (akratismos : « petit déjeuner » ; ariston, « déjeuner », deipnon : « dîner »), termes sur lesquels je reviendrai plus loin. Ce que la langue souligne, c’est la sociabilité.
En témoigne aussi, de façon claire, la réprobation qui entoure ceux qui consomment en solitaires. La femme chez Hésiode engrange dans son ventre la peine des hommes, la femme-belette chez Simonide est vorace et carnivore, les femmes chez Aristophane se goinfrent et se saoulent dès que l’occasion se présente : ceux qui dévorent et s’enivrent ainsi sont des femmes, des esclaves, des barbares, ceux-là mêmes qui ne connaissent pas la commensalité et n’ont pas de place aux banquets. Définir le groupe qui prend part au repas est donc primordial. Or du groupe domestique, familial, jusqu’au collectif des citoyens, les cas de figure sont nombreux, qu’il s’agisse du « repas » ou du symposion. La pratique des repas couvre tout le champ des relations sociales. Avant de choisir un domaine particulier, celui des repas communs à l’ensemble de la cité, je rappelle les grandes lignes du déroulement des repas dans la vie de tous les jours.
Les repas quotidiens
Le repas principal, le seul, à vrai dire, qui mérite le nom de repas, si l’on retient l’idée d’une communauté qui partage, a lieu en fin de journée : c’est le deipnon. Les Grecs se nourrissent à deux autres moments du jour : le matin, au lever, ils peuvent prendre quelques morceaux de galette d’orge ou de blé trempés dans du vin (akratismos) et, au milieu du jour, une collation rapide, l’ariston, faite de galettes et de quelque assaisonnement. De ces repas on sait peu de chose. Celui du soir est le seul qui donne éventuellement lieu à un certain apparat, celui aussi pour lequel on invite des amis. Mais avant de décrire le déroulement d’un deipnon, il faut remarquer que, pour l’immense majorité de la population grecque, le repas principal était lui aussi excessivement frugal et que la diète quotidienne était plutôt celle d’une « population efflanquée et se nourrissant autant dire de rien », selon le mot d’Aristophane dans Les Guêpes (vers 674). Deux textes permettent de rappeler ce qu’était l’ordinaire : l’u...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Préface de Jane Cobbi
- Préface de Jean-Louis Flandrin
- Première partie - Tables d’hier
- Deuxième partie - Tables d’ailleurs
- Conclusion de Jean-Louis Flandrin
- Les auteurs
- Table