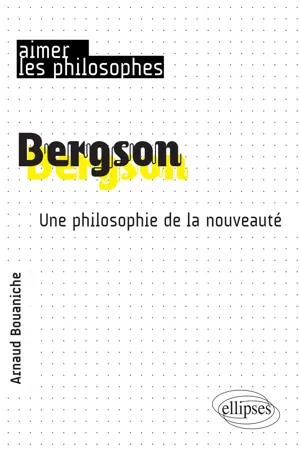![]()
Parcours en pensée
![]()
Chapitre 1
Une philosophie de la surprise
Un philosophe sans idée fixe
Il est une image insistante qui accompagne le nom de Bergson, et qui bien souvent précède la lecture de son œuvre : celle d’un inlassable chantre du changement, du devenir et de la mobilité, soucieux de rétablir la part de contingence et d’inattendu d’une réalité mobile, inachevée, toujours en train de se faire. Il est vrai que c’est là un leitmotiv qui traverse à ce point tous les livres du philosophe, qu’il serait tentant d’y voir, comme certains, une véritable obsession, confinant presque au comique (Bergson a lui-même montré dans son célèbre essai sur le rire le caractère justement risible de la figure de l’obstiné !) : le grand penseur du changement n’aurait jamais varié, le philosophe de l’imprévisible n’aurait au fond cessé de dire… toujours la même chose.
Une telle impression n’est certes pas sans fondement. Dans toute son œuvre, et dès son premier livre, Bergson s’est efforcé de reconsidérer la totalité des problèmes de la philosophie, et, au-delà, l’existence humaine dans son ensemble, à partir de l’unique expérience du temps, qu’il appelle plus précisément « la durée », et dont il ne cesse de rappeler qu’elle est le « centre même de sa doctrine » (EP, p. 443) : ce dont il est parti, à quoi il est « constamment revenu », et vers quoi tout lecteur ou commentateur de son œuvre doit lui-même « sans cesse revenir » (ibid.), sous peine de passer à côté de l’essentiel.
On aurait tort cependant de conclure ici à une quelconque obsession bergsonienne du temps. En 1924, dans un entretien tardif, Bergson précise à son interlocuteur et disciple Jacques Chevalier, que la durée, pourtant « centrale » dans toute son œuvre, n’est pas pour lui une « idée fixe » (EP, p. 967). Bergson se défend d’être le penseur monomaniaque d’un seul principe qu’il aurait eu pour ambition de retrouver partout et d’imposer à tout prix dans tous les domaines. En aucun cas, il n’est question pour lui d’adhérer a priori à une vision du monde, et si être bergsonien c’est constamment revenir à la durée, ce ne sera jamais à la faveur d’un postulat initial, et comme par automatisme, mais toujours à chaque fois au contact et à l’épreuve de l’expérience, en renonçant à toute idée préconçue, fut-elle métaphysique. Évoquant, dans le même entretien, les recherches qui devaient le conduire à son grand livre de 1907, L’Évolution créatrice, Bergson va même jusqu’à dire : « Lorsque j’abordais l’étude de la vie, je doutais que la vie durât, qu’elle évoluait » (EP, p. 967). Déclaration stupéfiante quand on connaît l’affinité ontologique à laquelle Bergson conclura finalement entre la vie et la durée ! « Partout où quelque chose vit, écrira-t-il, il y a, ouvert quelque part, un registre où le temps s’inscrit » (EC, p. 16 ; c’est Bergson qui souligne cette phrase). On pourrait dire que L’Évolution créatrice a d’abord été une « évolution créatrice » pour son auteur. Si en définitive la durée a finalement dû être ontologiquement rattachée à la vie, cela n’aura donc pas été pas en vertu d’une décision préalable, et par conséquent arbitrairement, mais parce qu’elle s’y était « réellement » trouvée. La recommandation méthodologique vaudra dès lors pour toute l’œuvre :
« Étendre logiquement une conclusion, l’appliquer à d’autres objets sans avoir réellement élargi le cercle de ses investigations, c’est une inclination naturelle à l’esprit humain, mais à laquelle il ne faut jamais céder » (PM, p. 98).
Lire Bergson, ce sera se souvenir à chaque livre, chaque page, chaque paragraphe, que rien n’est joué, ni garanti à l’avance. Revenir au temps n’est pas un but en soi, n’est pas « le » but ultime, mais une exigence, dont les effets doivent être eux-mêmes imprévisibles. C’est pourquoi le philosophe qui règle son effort sur le temps rigoureusement compris, ne peut être, à tout âge, qu’un « étudiant » (PM, p. 73), et sa philosophie, non pas un système, mais une multiplicité de tentatives qui prennent chacune la forme d’un « essai ». Mais « où sera-t-on conduit ? Nul ne le sait. » (PM, p. 72).
« Une surprise nous attendait »
S’il est vrai que les résultats philosophiques atteints furent à chaque fois inattendus, leur point de départ le fut tout autant, en ce sens que rien ne prédestinait Bergson à la durée et à la thèse métaphysique qui lui est associée, celle d’une imprévisibilité constitutive du réel. Il faudrait même aller plus loin : c’est à contrecœur que la durée s’est imposée à lui. Au début de La Pensée et le mouvant, dans un texte-testament qu’il fait paraître sept ans avant sa mort, et dans lequel il retrace sur un registre autobiographique les origines de sa propre philosophie, Bergson évoque une « surprise ». Dans sa « première jeunesse », entre 1881 et 1883, à sa sortie de l’École normale supérieure, son intention était, explique-t-il, de poursuivre la philosophie — alors très commentée en France — de Spencer, qu’on a déjà mentionnée plus haut, non sans cependant la rectifier sur certains points, et notamment en mécanique. Dans sa jeunesse, et selon ses propres mots, Bergson était alors tourné vers les sciences et les mathématiques, avec le projet revendiqué « d’étendre à l’univers entier l’explication mécaniste, seulement précisée et serrée de plus près » (EP, p. 966) !
C’est alors qu’un événement se produit, que Bergson relate dans ces termes, en commençant par rappeler sa détermination de marcher dans les pas de Spencer :
« Nous aurions voulu reprendre cette partie de son œuvre, la compléter et la consolider. Nous nous y essayâmes dans la mesure de nos forces. C’est ainsi que nous fûmes conduits devant l’idée de Temps. Là, une surprise nous attendait » (PM, p. 2).
Tout tient ici dans l’écart entre les deux mots qui encadrent presque ce passage et se répondent en écho : le projet initial d’une « reprise » brusquement contrarié par une « surprise ». En effet, la confrontation avec la notion de temps, qui devait n’être qu’un chapitre parmi d’autres d’un programme de vérification et de consolidation théoriques, vint tout à coup enrayer l’entreprise de continuer Spencer, de sorte que le temps apparut d’abord à Bergson, pour emprunter une image de L’Évolution créatrice pour le désigner, comme ce qui « met des bâtons dans les roues » (EC, p. 233). Et voici Bergson, qui n’aurait voulu que prolonger un héritage, contraint d’entreprendre quelque chose de nouveau : rien de moins qu’une philosophie.
Mais en quoi consiste au juste cette « surprise » ? « Nous fûmes très frappé, poursuit Bergson dans le même passage, de voir comment le temps réel […] échappe aux mathématiques » (PM, p. 2) ; ou ailleurs encore, et comme en écho à ces mêmes lignes : « Je m’aperçus à mon grand étonnement que le temps scientifique ne dure pas » (EP, p. 745, c’est Bergson qui souligne). C’est une véritable révélation qui s’impose à Bergson : l’incapacité structurelle des sciences, et singulièrement des mathématiques, à étreindre le temps dans sa réalité la plus simple, la plus concrète, la plus sensible. Derrière le traitement scientifique du temps, Bergson découvre, à sa grande stupéfaction, une sorte d’objet impossible, comparable au « cercle carré » ou à la « montagne sans vallée » de la tradition : un temps qui ne dure pas. En ne considérant en effet que la « forme » abstraite du passage d’un instant à un autre, applicable à n’importe quel objet, la science invente un temps neutre et indifférent, un temps qui donc n’existe pas, au sens fort, mais qui se résout en une série indéfinie d’instants quelconques, une juxtaposition d’unités ou de simultanéités valables pour tous et pour tout, un « temps » où plus rien ne (se) passe :
« Entre les simultanéités se passera tout ce qu’on voudra, le temps pourrait s’accélérer énormément, et même infiniment, rien ne serait changé pour le mathématicien, pour le physicien, pour l’astronome » (PM, p. 3).
La science traite le temps comme une variable manipulable à volonté par la pensée. L’astronome, par exemple, peut, par l’artifice du calcul, se reporter aujourd’hui à l’éclipse de Lune qui se produira dans un an, dans dix ans ou dans mille ans. Ce faisant, ce n’est pas réellement au temps qu’il a affaire. Car le temps n’est pas ce cadre immuable qui reste identique à soi, qui peut être accéléré sur commande et indifféremment rempli par n’importe quel contenu. Le seul temps qui existe est celui vécu par une conscience, car en dehors d’elle qui le fait, il n’y a qu’un pur évanouissement : chaque moment qui apparaît remplace le précédent qui disparaît, sans qu’aucune succession ne puisse jamais se constituer. Ce temps réel, la « durée », est alors ce qui ne cesse de changer, ou mieux : il est le fait même du changement, ce qui ne cesse de différer d’avec soi, pure différence, « hétérogénéité pure ». La surprise dont parle Bergson n’est donc pas seulement celle qu’il éprouve lui-même devant l’écart entre le temps tel qu’il est construit par la science et le temps qu’il est vécu par la conscience. Elle est surtout pour quiconque le seul mode de donation possible du temps réel, dès lors que chacun de ses moments est unique et inattendu.
Mais de cette surprise devant le temps découle immédiatement une conséquence critique qui n’en finira pas de retentir dans toute l’œuvre : la contestation du déterminisme. Sitôt en effet que la durée est reconnue dans sa réalité, et pour ce qu’elle est, c’est l’idée même d’une « mathématique universelle » qui est refusée, c’est-à-dire le projet d’application et d’extension du principe de causalité à l’ensemble de la réalité. La durée oblige Bergson à admettre que le réel, contrairement à ce qu’il a cru d’abord (et même espéré !) ne peut intégralement se résoudre en systèmes conservatifs, c’est-à-dire en systèmes parfaitement délimitables dont l’état ultérieur pourrait se déduire complètement de l’état antérieur. Si le temps existe, tout n’est pas déterminable à l’avance, chaque moment apportant avec lui, et même créant par l’effet même de sa succession quelque chose qui n’était pas contenu ni présent dans le moment précédent. Reconnaître la réalité du temps, c’est admettre qu’à chaque instant quelque chose se fait, qui ne peut pas être « donné » avant de se faire. La philosophie de Bergson n’est pas seulement un « chant » en l’honneur de la mobilité et du changement (selon une formule proposée par Gilles Deleuze), elle est aussi un « cri » contre une certaine rationalité qui affirme que le même succède au même, le semblable au semblable, l’identique à l’identique. Pour autant, il ne...