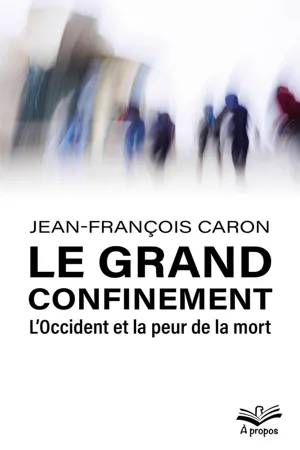Chapitre 1
Comment la conception hobbesienne de la vie est devenue dominante dans les sociétés occidentales
Je pense que la pandémie de COVID-19 a démontré très clairement que les sociétés occidentales ont adopté sans réserve ce que j’ai décrit précédemment comme une conception hobbesienne de la vie humaine. Comme son nom l’indique, cette conception découle de la philosophie de Thomas Hobbes et des raisons pour lesquelles les hommes acceptent de quitter l’état de nature pour s’unir socialement et politiquement au sein d’un Commonwealth. Dans sa célèbre théorie, Hobbes imagine l’humanité sans gouvernement, sans lois et sans aucune organisation sociétale dans un état qu’il appelle « l’état de nature ». La nature égoïste des êtres humains fait de l’état de nature un état de peur constante où chaque être humain est un loup pour les autres, dans le sens où chacun a le même droit20 de s’en prendre à autrui pour rester en vie et où l’industrie et la propriété privée ne peuvent exister. Par une loi évidente de la raison, tous les êtres humains se rendront compte que cette réalité hostile dans laquelle ils vivent, dans « la crainte permanente et le danger d’être la victime d’une mort violente » et où leur vie « est solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève21 », est inhospitalière pour leur préoccupation la plus fondamentale, à savoir demeurer en vie le plus longtemps possible. C’est cette conclusion qui va les conduire à confier leur sécurité à un gouvernement puissant surnommé « le Léviathan ». Pour Hobbes, parce que le retour à l’état de nature serait une calamité, « procurer au peuple la sécurité [c’est-à-dire la vie et les biens], fonction à laquelle il est obligé par la loi de nature22 », est donc la responsabilité première de cette autorité politique.
Je crois que Hobbes serait fier de voir comment les États occidentaux ont assumé cette responsabilité pendant la pandémie de COVID-19. En effet, comme il s’agit d’un virus transmissible de personne à personne et potentiellement mortel, une inaction de l’État pour limiter cette menace aurait flirté avec une violation du pacte qui unit le souverain à ses citoyens. À cet égard, pour que l’État demeure fidèle à sa mission, il est parfaitement acceptable que ce dernier impose des mesures « par la terreur de quelque châtiment plus grand que le bénéfice qu’ils comptent tirer de la violation de la convention23 ». C’est exactement la logique qui a été utilisée dans de nombreuses sociétés occidentales où le non-respect des fermetures et autres mesures était sanctionné par des amendes et même des menaces d’emprisonnement24. Puisque la conception dominante de la vie découle de cette logique hobbesienne, les gens soutiennent massivement leurs gouvernements respectifs, même si cela implique des mesures qui les privent d’exercer leurs libertés individuelles. Or, dans les circonstances, il ne s’agit pourtant pas d’une contradiction de cette logique dominante, car la liberté est manifestement subordonnée, par ce schéma logique, à l’obligation de l’État d’empêcher les gens de mourir.
Cette comparaison entre la théorie de Hobbes et la perspective dominante à travers laquelle la pandémie a été perçue n’est en aucun cas une coïncidence, puisque le philosophe anglais qui a traduit la Guerre du Péloponnèse de Thucydide était bien conscient des conséquences possibles qu’une pandémie – comme ce fut le cas de la peste qui a frappé Athènes en 429 av. J.-C. et en 427-426 av. J.-C., tuant un quart de sa population – pouvait avoir sur les sociétés25. L’effondrement possible d’une société et son retour malvenu à l’état de nature en période de pandémie sont dus au fait que les gens n’ont plus de raisons de craindre les conséquences de la violation des règles de leur État. À ce sujet, Thucydide a écrit ceci :
La maladie déclencha également dans la ville d’autres désordres plus graves. Chacun se livra à la poursuite du plaisir avec une audace qu’il cachait auparavant. À la vue de ces brusques changements, des riches qui mouraient subitement et des pauvres qui s’enrichissaient tout à coup des biens des morts, on chercha les profits et les jouissances rapides, puisque la vie et les richesses étaient également éphémères. Nul ne montrait d’empressement à atteindre avec quelque peine un but honnête ; car on ne savait pas si on vivrait assez pour y parvenir. Le plaisir et tous les moyens pour l’atteindre, voilà ce qu’on jugeait beau et utile. Nul n’était retenu ni par la crainte des dieux ni par les lois humaines ; on ne faisait pas plus de cas de la piété que de l’impiété, depuis que l’on voyait tout le monde périr indistinctement ; de plus, on ne pensait pas vivre assez longtemps pour avoir à rendre compte de ses fautes. Ce qui importait bien davantage, c’était l’arrêt déjà rendu et menaçant ; avant de le subir, mieux valait tirer de la vie quelque jouissance26.
En vertu de cet exemple historique, l’idée consiste donc à imposer des mesures pour limiter la propagation du virus avant que la situation dégénère au point de ressembler à l’état de nature où tous les êtres humains sont des loups pour les autres humains. Les sociétés occidentales ont donc suivi une ligne de conduite exemplaire face à « notre peste du xxie siècle » qui ferait la fierté de Thucydide et de Hobbes, même si la pandémie de COVID-19 n’est en rien comparable à la peste, bien que certains médias et représentants de l’État aient pu tenter de nous convaincre du contraire27.
Suivant la logique hobbesienne, le but des associations politiques est plutôt basique et ne voit pas la préservation de la vie comme un outil pour atteindre certains objectifs, mais considère plutôt la survie comme une fin en soi. C’est pourquoi cette compréhension des objectifs que les États doivent poursuivre peut facilement conduire à une forme de « maternalisme » qui caractérise les sociétés occidentales. En revanche, ce que j’ai décrit précédemment comme une vision aristotélicienne-lockéenne de la vie perçoit l’existence humaine plutôt comme un moyen d’atteindre d’autres objectifs qui seront propices à notre bonheur et à celui d’autrui. À cet égard, la joie peut être soit animale et fondée sur la satisfaction de besoins fondamentaux sans considération de leurs effets à long terme, soit intrinsèquement humaine en servant des finalités morales supérieures. En conséquence, l’accomplissement de la vie humaine selon l’interprétation aristotélicienne-lockéenne exige d’être social et de s’engager avec les autres dans la poursuite de fins morales supérieures, alors que la conception hobbesienne s’en abstient. La domination de cette dernière sur la première est apparente à bien des égards lorsqu’on observe les sociétés occidentales, et c’est ce que ce chapitre va présenter.
L’éthique « zéro mort » et la fin de l’immunité souveraine
Si l’incapacité de faire face à ce que l’on peut appeler une « mort médiatisée et publique » fut une caractéristique dominante de la pandémie de COVID-19, ce trait psychologique s’est également manifesté sous diverses formes au cours des 50 dernières années. La plus évidente est certainement l’éthique « zéro mort » adoptée depuis par les organisations gouvernementales de nombreux États, les corps militaires étant les plus touchés. Avant la guerre du Vietnam, il n’était pas inhabituel pour les États de voir des dizaines de milliers de leurs soldats perdre la vie non seulement au cours d’une guerre entière, mais aussi lors d’une seule bataille. On peut penser à cet égard à la bataille des Frontières livrée au début de la Première Guerre mondiale. Le 22 août 1914, l’armée française attaquait les lignes allemandes à 15 endroits, de Mons en Belgique jusqu’à Mulhouse dans l’est de la France ; cette poussée a entraîné la mort de 27 000 soldats français en ce jour fatidique (et d’un nombre inconnu de soldats allemands28). La bataille de la Somme de 1916 est un autre exemple flagrant de l’utilisation de soldats comme chair à canon, puisque près de 20 000 soldats britanniques ont perdu la vie au cours du premier jour de la bataille (pour un gain de terrain minime, voire nul). Le sacrifice le plus tragique est probablement celui du Newfoundland Regiment qui a vu ses 22 officiers être tués, alors que 658 de ses 758 sous-officiers subirent le même sort.
Si ces événements tragiques ont fait la une des journaux en France et au Royaume-Uni à l’époque, ils n’ont pas eu d’effet négatif sur la perception de la population quant à la nécessité de continuer à se battre dans ces pays29. Les pertes humaines énormes se sont poursuivies pendant la Seconde Guerre mondiale, même si les commandants – du moins, ceux des alliés occidentaux – étaient soucieux d’établir des stratégies et de planifier des missions dans le but de minimiser autant que possible la mort de leurs hommes. Cette réalité a pris un tournant radical dans les années 1960 avec la guerre du Vietnam, où le nombre de plus en plus élevé de soldats américains tués était en corrélation directe avec une résistance croissante contre la guerre aux États-Unis, ce qui a finalement conduit les Américains à quitter le pays et à abandonner leurs alliés sud-asiatiques. Afin d’éviter qu’un résultat similaire vienne entraver les efforts de guerre de l’Amérique, les présidents George H. W. Bush et son fils, George W. Bush, ont tous deux décidé d’empêcher les médias de filmer et de diffuser des images de corps de soldats pendant le processus de leur rapatriement post-mortem lors de la guerre du Golfe de 1991 et en 2003 après l’invasion de l’Irak. L’idée était de projeter un traitement de la guerre au moyen d’images hostiles à la mort qui ne provoqueraient pas un flux de contagion visuelle afin d’éviter un autre « syndrome du Vietnam » de la part de la population américaine30. La Maison-Blanche savait très bien qu’une diffusion répétitive d’images de cercueils empilés couverts de drapeaux arrivant quotidiennement sur le sol américain aurait un effet négatif sur le soutien de l’opinion publique à la guerre, nonobstant la pertinence de la mission. C’est pourquoi les retours au pays de soldats décédés furent habilement planifiés afin que le symbole suprême du sacrifice (le cercueil drapé du drapeau national) demeure une affaire privée. C’est ce que William O. Sass et Rachel Hall ont admirablement décrit :
Par cette mesure, le Pentagone disperse géographiquement le fardeau visuel et affectif du sacrifice militaire et empêche ainsi le public, y compris les familles des militaires, d’être témoin de plusieurs morts à la fois. Les histoires de victimes racontées au niveau local, dans la ville natale d’un soldat ou d’une épouse, sont le plus souvent d’intérêt humain et font rarement le lien entre la mort et la politique ou la stratégie militaire actuelle, et reflètent l’idéologie de l’armée volontaire31 [traduction CD].
L’incapacité à gérer les décès liés à la guerre a contribué au développement d’une éthique « zéro mort » qui a influencé la manière dont les États occidentaux agissent désormais dans les zones de conflits. Craignant qu’un grand nombre de morts entrave le phénomène de « ralliement autour du drapeau » (rally around the flag), les stratèges militaires occidentaux espèrent au mieux une fin rapide de la guerre (ce qui aurait pour effet de comprimer dans le temps l’exposition publique potentielle des soldats décédés) ou – dans un monde idéal – un conflit qui répondra à la célèbre formule de George S. Patton selon laquelle « l’objet de la guerre n’est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d’en face meure pour le sien ». Ce dernier objectif, atteint pour la première fois en 1999 lorsque les forces de l’OTAN sont intervenues dans l’ex-Yougoslavie32, a conduit à ce que Martin Shaw a appelé une logique de transfert des risques qui se définit désormais par une volonté claire de limiter les risques pour la vie des soldats occidentaux dans le but de minimiser les risques politiques pour les gouvernements, même si cela se fait au détriment de civils tués à l’étranger33. Avec l’aide de technologies comme les missiles à longue portée, le plus connu étant probablement le « missile Tomahawk », et les véhicules armés sans pilote, communément appelés « drones », cet objectif a été atteint. Grâce à ces technologies, les soldats occidentaux ont désormais la possibilité de mener des guerres parfois à des milliers de kilomètres du champ de bataille et de tuer des combattants ennemis – ou des personnes identifiées comme telles – en appuyant simplement sur un bouton, comme s’ils jouaient à un jeu vidéo dans le confort de leur maison. Pour certains, cette caractéristique de la guerre contemporaine a entraîné l’élimination de la notion « d’honneur » de la logique militaire, une notion qui repose sur l’égale capacité des adversaires à tuer leur ennemi. Au contraire, cette caractéristique a conduit de nombreux auteurs à suggérer que ces technologies ont créé une situation de guerre sans risque, avec une dynamique plus proche de la chasse à l’homme que du duel34.
De nos jours, la...