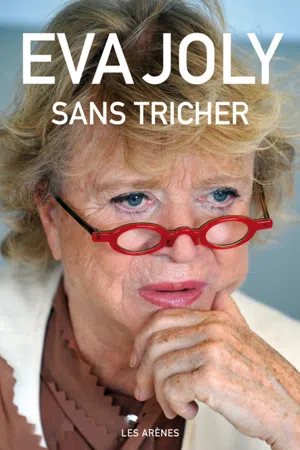1. La trahison de « ceux qui savent »
Chacun de nous est en dette avec son enfance. C’est à ma jeunesse en Norvège que je dois ma combativité. Entre hier et aujourd’hui, il existe un fil rouge, un chemin. D’où est-ce que je viens ?
La figure la plus importante de mon enfance est celle de ma grand-mère. Elle était divorcée, ce qui était exceptionnel à cette époque. Son père avait fait fortune dans l’immobilier durant les brèves années de prospérité que la Norvège a connues entre les deux guerres, avant la grande crise de 1929. Ce fut une intense période de croissance, de faste même. Sa famille possédait des immeubles à Oslo. Fille d’institutrice, ma grand-mère avait des aspirations culturelles et une attirance pour la beauté en général. Passionnée de musique, exceptionnellement belle, elle était le point fixe de notre famille.
Ma grand-mère a épousé un homme que l’on m’a décrit ensuite comme séduisant et intelligent. Simple ouvrier, il travaillait dans la construction navale. Mais il avait un problème avec l’alcool. Quand il avait bu, il devenait violent et la battait. Alors elle l’a quitté. Elle n’avait pas trente ans.
À la mort de ses parents, la fortune familiale était restée en indivision. Son frère la gérait pour elle, plutôt mal. Les immeubles se sont rapidement dégradés car les loyers étaient bloqués et, rattrapés par l’inflation, ne rapportaient rien. Elle a élevé seule ma mère et mon oncle dans un appartement modeste d’un quartier pauvre de l’est d’Oslo, tout en travaillant comme coiffeuse.
Ma grand-mère se sentait déclassée. Elle rêvait d’une vie qui correspondrait à ses aspirations. L’évocation de ce paradis perdu des années 1920 a marqué mon enfance. Ma mère nous a éduqués dans l’idée que nous connaîtrions bientôt des jours meilleurs. Certes, la vie était dure, mais elle n’avait pas été toujours comme ça et les bons jours reviendraient, du moins si chacun travaillait en conséquence.
Mon père était fils d’un tailleur dans l’armée. L’atelier de mon grand-père marchait bien. La famille jouissait d’une aisance suffisante pour que ma grand-mère paternelle ne soit pas obligée de travailler. Je me souviens qu’il soulignait ce fait avec fierté. Dans la Norvège des années 1930, marquée par la crise économique et le chômage, c’était un vrai privilège. Mes parents m’ont donc transmis le souvenir de cette époque de dépression économique où le simple fait d’occuper un emploi dans le tram ou le métro était une chance, car c’était un « vrai » métier, avec un salaire assuré.
Ma grand-mère avait appris à ma mère la coiffure et lui avait inculqué une passion authentique pour la musique et le chant. Mes souvenirs d’enfance sont tissés de ces bonheurs simples : chanter et écouter de la musique ensemble. Ma grand-mère trouvait que son gendre n’était pas assez bien pour sa fille. Elle pensait que c’était un plouc, dont la famille venait juste d’abandonner l’agriculture. La terre leur collait encore aux semelles. Elle était convaincue qu’avec ce paysan mal dégrossi d’Eyvind (le prénom de mon père) ma mère ne connaîtrait jamais une vie digne d’elle. C’était injuste. Mon père est mort à 93 ans et, jusqu’à la fin, j’ai été très proche de lui. Il s’est révélé un homme bon et vrai.
La conviction d’être déclassée et d’appartenir à un autre milieu que celui dans lequel je grandissais m’a marquée. Nous étions des artisans, mais nous savions qu’il existait un autre monde. Nous portions en nous, et moi la première, l’espoir acharné d’une autre vie. En attendant, il fallait faire bonne figure. Cela passait par notre extrême souci de la tenue, des vêtements, de l’élégance. Maman se faisait une certaine idée de la distinction. Pour elle, cela comptait. Il fallait qu’on fasse un effort d’apparence, qu’on s’identifie à un milieu qui n’était pas le nôtre. Maman nous racontait parfois qu’elle avait été invitée à quelques réceptions qui lui avaient permis de découvrir la bourgeoisie norvégienne. Cela ravivait sa nostalgie. Dans sa représentation du monde, les ingénieurs occupaient le haut de la pyramide. Ils dirigeaient les entreprises. Elle leur prêtait une culture et un savoir-faire hors du commun.
Nous avions intériorisé, quant à nous, un vif sentiment d’infériorité. Certes, nous étions heureux et nos parents étaient débrouillards. Il n’empêche que nous vivions avec la conscience aiguë qu’il existait des gens mieux que nous, des gens plus instruits, plus puissants, capables de faire tourner le monde. La seule façon de leur ressembler, c’était d’apprendre sans relâche. C’est formidable de comprendre le monde, voilà ce que nous avions en tête. À toutes les étapes de ma vie, cette envie m’a poussé en avant. J’ai longtemps cru – pour de bon – que la richesse et la culture allaient ensemble ; que ceux qui « avaient » étaient les mêmes que ceux qui « savaient ». J’ai pensé ainsi jusqu’au jour, assez tardif, où j’ai commencé à comprendre que l’ordre des choses n’était pas forcément celui-là. Les possédants ne sont pas toujours les meilleurs, loin s’en faut. Ils sont le plus souvent égoïstes ; ils se désintéressent du monde. Cette prise de conscience a culminé avec mon instruction de l’affaire Elf. Ce fut violent. J’étais sidérée de découvrir à quel point j’avais été naïve. Et docile…
Toute notre formation est une éducation à l’obéissance. On nous répète : « Tu vas passer des examens », « Tu vas subir ce test d’embauche », « Tu ne te révoltes pas ». On n’enseigne pas la révolte. Cela génère chez nous, l’idée qu’il y a des gens qui savent, des gens qui gèrent l’économie mondiale, des gens qui s’occupent vraiment des questions importantes et que chacun doit faire son travail. Tu es brancardier, tu fais ton travail de brancardier, et tu laisses le fonds monétaire faire son travail de fonds monétaire !
Au moment de l’affaire Elf, quand j’ai pu apercevoir le dessous des cartes des multinationales, je suis tombée de haut. Tout comme m’a sidérée le discours justificateur de ces dirigeants qui, pour minimiser leurs actes – c’est-à-dire piller pour eux-mêmes et pour leurs amis –, me répétaient que tout le monde le faisait.
Je me suis sentie d’autant plus choquée que, vus de près, ces hommes qui dirigeaient Elf étaient plutôt quelconques. Ma vision du monde a commencé à changer. J’ai acquis la conviction que les décisions politiques n’étaient pas prises dans l’intérêt collectif. J’ai décidé qu’il fallait tout faire pour corriger ce désordre, arrêter cette immense tromperie, même si, comme chacun, je savais que cela prendrait du temps : le monde est un énorme paquebot dont on ne peut pas modifier le cap du jour au lendemain. En tout cas, l’indignation qui m’a saisie a décuplé mon énergie. Voilà d’où vient ce que mes ennemis appellent ma « dureté ».
Les « dissidences » démocratiques
L’écho de l’enfance porte loin. Aujourd’hui encore, je peux comprendre ce qu’éprouve un jeune chômeur de banlieue ou une caissière en intérim, cette impression de déclassement, de relégation, de mise à distance par « ceux qui savent ». Instinctivement, je l’ai vécu, nous avons d’abord tendance à imaginer que les gens éduqués sont responsables et que nous pouvons leur faire confiance. Nous acceptons plus ou moins d’appartenir à une classe qui n’a pas droit à la parole. Cette humilité naturelle fausse notre compréhension du monde. Le jour où l’on découvre que rien de tout cela n’est vrai, c’est un choc.
Les prétendus responsables que j’interrogeais dans le cadre des enquêtes financières, n’étaient pas seulement cupides. Il y avait souvent chez eux une sorte de courte vue proche de la bêtise. De fait, je sais maintenant que la bêtise, y compris la bêtise savante, joue un rôle dans la marche du monde. Nombre de tragédies lui sont imputables, qu’il s’agisse des crises financières ou des guerres. Je parle de la bêtise – ou de l’ignorance – de ceux qui sont censés savoir et maîtriser la situation.
C’est un point central du dysfonctionnement de nos démocraties. Les citoyens cèdent trop facilement au discours culpabilisateur tenu par les experts sur le mode : « Vous n’avez pas le droit à la parole parce que vous ne comprenez pas la nature du problème, c’est trop compliqué pour vous ! » Les questions financières ? Elles sont bien trop complexes pour vous être accessibles. Ce ne peut pas être pas votre problème ! La technologie ou les OGM ? Vous n’avez pas la formation scientifique requise pour vous prononcer ! Le nucléaire ? C’est une immense question que seuls les spécialistes peuvent juger. Ils en arrivent à tant impressionner les gens que personne n’ose plus penser par soi-même. Ils s’abandonnent à la distraction, au « divertissement » (notamment télévisé), avec le risque de ne plus être des citoyens à part entière. Je parle d’autant plus librement de cette humilité instinctive que j’en ai été la victime consentante pendant des années.
Il m’a fallu beaucoup de temps pour sortir de l’illusion. Redevenir citoyen, ou militant, c’est cela. On se dit que ça suffit, qu’il est temps de refuser d’être intimidé par les discours venus d’en haut. On ne veut plus accorder aveuglément sa confiance aux « décideurs ». On a compris qu’ils font – et feront sans doute – un mauvais usage de cette confiance. Aujourd’hui, des millions de gens en sont là. Ils se méfient a priori des experts. L’actualité des vingt ou trente dernières années leur a donné une foule d’exemples d’erreurs dramatiques, commises au nom du savoir ou de la compétence. C’est peu de dire qu’ils en gardent le souvenir.
Songeons aux grandes affaires touchant à la santé publique : de la vache folle au sang contaminé, à l’amiante en passant par les morts de la canicule ou le scandale du Médiator. Pensons aux désastres nucléaires – Three Miles Island en 1979, Tchernobyl en 1986, Fukushima en 2011 –, désastres dont on nous disait qu’ils ne « pouvaient » pas se produire, car ces affaires étaient gérées par des gens sérieux.
N’oublions pas certaines autres catastrophes, climatiques celles-là : le cyclone Katrina à la Nouvelle-Orléans en août 2005 ou les inondations meurtrières de la côte atlantique française, au moment de la tempête Xynthia en février 2010. Tous ces événements ont montré a posteriori que les lois et les règles élémentaires de prudence n’avaient pas été respectées par les « responsables », lesquels étaient plus soucieux de profit que d’intérêt général. N’oublions pas les accidents financiers comme celui des subprimes en septembre 2008, d’abord imputables à la cupidité ou à l’irresponsabilité des gens sérieux. Leur défaillance, intellectuelle et morale, a été – est encore – effroyablement coûteuse pour les peuples ignorants (nous tous !) dont ils avaient la charge.
Pensons même à certaines aventures militaires comme l’intervention américaine de 2003 en Irak, décidée par Georges W. Bush et fondée sur un mensonge initial à propos des « armes de destruction massive » que Saddam Hussein était supposé posséder. N’oublions pas non plus cette longue, très longue guerre en Afghanistan, qui défiait le bon sens et s’est terminée en quasi-déroute. La bêtise savante est capable de mettre le feu au monde. Je pourrais citer bien d’autres exemples analogues. Chaque fois, ils révèlent que des élites ont failli, au sens le plus fort du terme. Ils montrent que les responsables ne l’ont pas été.
À force d’intimider les gens en mettant en avant leur « ignorance », le système politique finit par les détourner de leurs réflexes citoyens. Ils s’imaginent, à tort, qu’ils ne sont pas à la hauteur, que le monde est devenu trop complexe pour qu’ils puissent agir sur lui. C’est ainsi qu’insensiblement, la démocratie s’alanguit, s’étiole, se désactive. Les citoyens, découragés, font dissidence. Ils peuvent le faire de deux façons : soit passivement en désertant les urnes, comme en témoigne la tendance grandissante à l’abstention dans la plupart des démocraties modernes, y compris les États-Unis ; soit en choisissant, par dépit, un vote purement protestataire, ce qui alimente un peu partout en Europe, le populisme d’extrême droite. Au fond, ces deux dissidences participent d’une même désespérance des citoyens. Ils n’y croient plus. Les pouvoirs ont tout fait pour les amener là.
Mais une histoire n’est pas faite d’une seule pièce. Le sentiment de déclassement, avec lequel j’ai grandi, s’accompagnait d’une grande curiosité. J’étais tenaillée par la volonté de progresser, d’enrichir ma connaissance du monde, de m’élever au sens où l’entendait ma mère. Ces étapes successives, je les appelais mes « plates-formes », un peu comme un alpiniste parle des camps successifs qui lui permettent de grimper en altitude, à partir du camp de base. Autour de mes vingt ans, ma « plate-forme » de Norvège n’était déjà pas si mal. J’avais passé mon bac avec succès, ce qui dans mon milieu était assez improbable. En 1962, à peine 15 % d’une classe d’âge réussissait son bac. La reproduction sociale avait fait son travail de sélection naturelle. Nous étions seulement deux élèves issus de mon cours préparatoire à atteindre ce niveau.
Je dois ce premier succès à tous ces gens, y compris ma mère, qui nous ont poussés au travail en nous persuadant que nous pouvions espérer mieux que la classe où nous vivions.
Ma « plate-forme » de Norvège, c’était cela : j’avais montré que j’étais assez intelligente pour obtenir brillamment mon bac. En outre, j’avais fait un peu de théâtre, et j’avais été sélectionnée pour concourir à l’élection de Miss Norvège. Après tout, ce n’était déjà pas rien.
J’avais vingt ans quand je suis arrivé en France. L’occasion s’était présentée de perfectionner mon français en partant un an comme jeune fille au pair. J’ai saisi ma chance. Quel bonheur ! Aujourd’hui, la Norvège est un pays riche, grâce au boom du pétrole en mer du Nord, et les gens sont connectés au reste du monde. Mais dans les années 1960, entre la Norvège et la France, c’était le jour et la nuit. Par rapport au Paris enchanteur que je découvrais, mon pays natal m’apparaissait pauvre et rugueux, étroit d’esprit. Je revois encore les marchés remplis de fruits, de légumes et de fleurs, les cafés, les boutiques et les vitrines éblouissantes, les rues pavées d’histoire, la culture, la séduction et l’humour des Français que je croisais, les cinémas et les librairies à chaque coin de rue. Les Québécois emploient l’expression « tomber en amour ». Je suis littéralement tombée en amour avec ce pays. Je suis d’ascendance viking sur vingt générations au moins. Mais une partie de moi, de mes rêves, mes aspirations à « la vie bonne » dont parlait Montaigne, cette partie-là a immédiatement résonné avec la France, a fait corps avec elle.
Après une première expérience désagréable dans le xvie arrondissement de Paris, je suis arrivée comme jeune fille au pair dans la famille Joly en février 1964. J’ai écrit un jour que cette famille vivait avec la conviction d’habiter le plus bel appartement dans la plus belle rue de la plus belle ville du monde. Cette phrase les résume dans leur orgueil et leur faiblesse. Ils étaient intelligents, brillants et cultivés. Je connaîtrais par la suite leurs secrets, mais c’est la lumière qui m’a d’abord frappée.
J’ai vite compris que ma « plate-forme » norvégienne ne suffirait plus. J’avais d’autres codes à apprendre. Belle leçon de modestie, y compris sur le plan vestimentaire. On m’a tout de suite dit que je n’avais aucun goût. Je portais des vêtements à la mode en Norvège, mais sûrem...