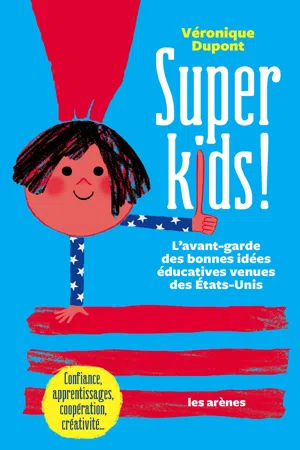![]()
1
La confiance avant tout
«Papa, depuis que tu es parti, chaque jour je pense à toi et tu me manques. Tu étais mon roc, mon principal soutien, tu trouvais tout ce que je faisais super et tu étais mon premier fan. » Quand Erica a posté ce message sur Facebook un jour de fête des Pères, j’ai commencé par lever les yeux au ciel en pensant que les Américains ont vraiment tendance au sentimentalisme. Puis, je me suis dit en définitive que cette déclaration symbolisait quelque chose que j’admirais beaucoup dans l’éducation outre-Atlantique : le résultat positif de la valorisation permanente de l’enfant, ici par un père qui a chéri, soutenu de façon inconditionnelle sa fille et lui a permis de devenir une femme équilibrée, responsable, heureuse dans sa vie personnelle.
Erica, mère d’une amie de Lila lorsque nous vivions à New York, reproduit le schéma paternel avec ses propres filles, qu’elle complimente et soutient sans relâche, aussi bien l’intrépide aînée qui, à 2 ans, escaladait les échelles à toute vitesse, genre chef de bande, que la timide cadette. Quand celle-ci a commencé la maternelle à 2 ans, elle pleurait tous les matins en arrivant en classe. Au bout de quelques jours, Erica a décidé de la retirer de l’école et de la laisser un an de plus à la maison avec leur nounou. « Elle n’est pas prête, je ne veux pas la forcer », a-t-elle expliqué. Six mois après, Erica postait sur Facebook une photo de sa fille riant aux éclats dans les bras d’une monitrice de natation, avec la légende : « Mon bébé qui n’est plus si timide. » Elle a respecté l’individualité de sa fille, qui a pris de l’assurance, désormais prête à se lancer à la découverte du monde.
Je me souviens de cette autre maman new-yorkaise toute menue, mais femme de tête, chef d’entreprise, marathonienne, qui, parlant de son fils, affirmait avec fermeté : « Tout ce qui compte pour moi, c’est qu’il soit bien dans sa peau. »
En France aussi, on vous dit que c’est important d’être « à l’aise dans ses baskets », mais c’est un peu plus compliqué. On se focalise plus sur l’apprentissage de la vie en société. Éduquer, c’est beaucoup (re)cadrer. Dans la patrie de Molière et de Nadine de Rothschild, on pousse l’enfant à se tenir parfaitement à table, à parler doucement, à dire « bonjour » et « au revoir ». Le pédiatre américain John Lovejoy, qui exerce à l’hôpital américain de Neuilly, constate que les Français peuvent être plus impatients avec leurs enfants que ses compatriotes. « Ils disent : “Je suis fatigué, tu m’énerves.” »
C’est que, dans la France pétrie de culture des Lumières, l’enfant est considéré comme un être cognitif, un adulte en devenir à qui on doit apprendre le monde, alors qu’aux États-Unis l’enfance est un état célébré en soi, presque sanctifié. Les Américains « laissent les gamins être des gamins ». Leur culture donne presque toujours la priorité au confort pour le meilleur et parfois pour le pire : la température doit être à 18 degrés même s’il fait 40 dehors, on mange quand on veut, on peut se tenir avachi même en réunion… Chez les petits, idem, le bien-être est une priorité et les parents sont bien moins exigeants en termes de comportement. « Il n’a pas dit bonjour parce qu’il ne se sentait pas à l’aise. » Pour eux, un enfant de 5 ans n’est pas tenu aux mêmes standards de politesse ou bonne tenue qu’un adulte. Donc, si Jeremiah se roule par terre dans le hall d’un hôtel ou hurle dans un restaurant, ce n’est pas la fin du monde.
Nos cousins d’Amérique ont foi en l’avenir : ils veulent croire que s’ils montrent l’exemple, répètent et expliquent, leurs petits monstres finiront bien par se transformer en êtres civilisés. Et ils ont raison : les Américains sont dans l’ensemble un peuple courtois qui vous tient la porte, arrive à l’heure, ne double pas dans la file d’attente et ne coupe pas la parole.
Un besoin fondamental
Pourquoi une telle attention portée à la confiance ? Pour le célèbre psychologue américain Abraham Maslow, la quête du bonheur – gravée dans la Déclaration d’indépendance comme le but ultime de la démocratie américaine – se poursuit en satisfaisant successivement une série de besoins fondamentaux : d’abord, les nécessités physiologiques de sécurité, chaleur, nourriture et sommeil. Viennent ensuite l’amour, puis la confiance en soi. Pour la majorité des psychologues, l’estime de soi va jouer un rôle prédictif : les jeunes qui ont une piètre opinion d’eux-mêmes se laisseront plus facilement embarquer dans des relations toxiques, auront tendance à consommer plus de psychotropes, n’oseront pas défendre leur travail, demander des promotions… Résultat, « les adolescents avec une faible image d’eux-mêmes auront une santé mentale et physique moindre, des perspectives économiques plus faibles, et un niveau de criminalité plus élevé à l’âge adulte », affirme le professeur de psychologie Alfie Kohn. Chez les préadolescents, la faible confiance en soi se traduit par des comportements agressifs, des désordres alimentaires, plus de tendances suicidaires ou de comportements à risque.
À l’inverse, une self-esteem solide est une arme pour la vie, pour savoir s’entourer de gens qui vous font du bien et se tenir à l’écart des relations malsaines. Dans la vie professionnelle, elle fait partie de ces qualités subjectives que l’on n’apprend pas dans des livres, mais qui font de vous quelqu’un qu’on écoute et qui sait convaincre. Quelqu’un qui sait prendre des risques, ose être ambitieux, n’a pas peur d’essayer et même de se tromper sans se remettre entièrement en question, sans penser « je suis nul » ou « ça ne marchera jamais ».
Quand j’entends certaines de mes amies les plus talentueuses me dire qu’elles ont l’angoisse de la page blanche, le syndrome de l’imposteur ou qu’elles se sentent incompétentes, je me dis qu’on a encore du travail en matière de confiance en soi en France – surtout chez les femmes, mais c’est une autre histoire.
La confiance en soi, qui s’appuie sur une saine self-esteem, est l’une de ces qualités subjectives, comme l’empathie, l’imagination, l’aisance à communiquer, de plus en plus recherchées par les recruteurs des universités les plus prestigieuses, des grandes écoles ou des entreprises qui joueront un rôle clé dans le monde de demain, où s’accroît sans cesse la robotisation. Les études sur l’avenir du travail, comme celles du cabinet d’études Pew Research, projettent la disparition de nombreux emplois qui vont être automatisés : dans les usines, les magasins, les restaurants, les hôtels, mais aussi dans les services comme la comptabilité, et jusque dans des secteurs tels que le montage audiovisuel, le journalisme, la médecine et tant d’autres. Les métiers du futur seront de moins en moins dédiés aux tâches d’exécution et dépendront de la créativité, des capacités à concevoir, organiser, communiquer ses idées, à convaincre de les adopter, etc.
S‘émerveiller
Comment apprennent-ils, ces Américains, à avoir une foi inébranlable en eux-mêmes ? Dès le berceau, leurs parents les abreuvent de « good job ! », « tu es le meilleur ! », qui font souvent sourire, vus de chez nous.
Pour donner confiance à leurs petits, les aider à s’élancer dans la vie au sens propre comme au figuré, ils s’émerveillent devant le moindre pas, dessin, mot balbutié, la moindre note de musique produits par leurs chérubins, sans craindre de les rendre imbus d’eux-mêmes, privilégiant la construction, la protection de leur ego. « Je suis très fier de ma fille, elle est arrivée troisième de sa course », « bravo, mon fils, mon soleil, quel danseur/athlète/écrivain », « bon anniversaire, Reese, tu es intelligente, courageuse, avec un grand cœur »… À l’ère des réseaux sociaux, c’est encore plus visible : les parents américains chantent en permanence les louanges de leurs rejetons.
Quand on est une mère française, c’est un apprentissage : si Lila joue un peu trop vite un morceau de violon, j’ai du mal à retenir un : « Va doucement, c’est faux là ! » Et parfois, c’est Lila qui me reprend, en bonne petite Américaine qu’elle est devenue : « Mais maman, tu dois m’encourager ! », mi-contrite, mi-indignée. À force de voir faire mes voisins, j’apprends à dire plutôt : « Bravo, c’est super ! Joue-le encore une fois, tout doucement et encore plus parfait ! » Lila est tellement contente, et redouble d’efforts.
Mon amie Sonia a vécu dix-huit mois à New York avec ses deux garçonnets : elle se souvient de la positivité à tout prix du coach de base-ball de son aîné. « C’est dur pour les débutants, Simon n’arrivait pas du tout à frapper la balle avec sa batte, il les manquait toutes, mais l’entraîneur trouvait toujours malgré tout un compliment pour l’encourager : “Superbe swing ! Quelle force ! Oh là là, quel mouvement !” », se souvient-elle en riant.
Caprices ou immaturité ?
Là où les Frenchies comme moi ont du mal à suivre, c’est face au zen des parents américains devant une colère de leur petit amour. Lysiane, maman de 35 ans qui travaille dans le cinéma et a passé un an à Los Angeles, a aussi du mal à s’habituer : « Un jour, dans la queue d’un café, un enfant hurlait. Sa mère lui disait juste : “Calme-toi” et continuait sa commande comme si de rien n’était. Moi, j’aurais attrapé mon enfant… Quand je les vois rester calmes, je me dis : “Comment font-ils ?” Et en même temps, ils ne font rien. L’enfant pique une colère, mais on n’intervient pas. »
C’est qu’outre-Atlantique toute crise de larmes, toute colère, tout refus obstiné de dire bonjour ne sont pas automatiquement catalogués comme caprice. Les Américains considèrent que le cerveau de leurs petits anges est, après tout, ce qu’il est : immature. Les études en neurosciences, dont est friand le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, montrent que les cris, gesticulations, pleurs inconsolables et démesurés ne sont pas le résultat d’une volonté intrinsèque de faire tourner en bourrique les adultes, mais d’une immaturité du cortex.
Les auteurs du best-seller Le Cerveau de votre enfant, Daniel J. Siegel et Tina Payne Bryson, décrivent les complaintes sans queue ni tête des tout-petits non pas comme une manifestation de leur ingratitude, mais comme des « déferlantes d’émotions venues du cerveau droit », « sans qu’elles soient encore équilibrées par le cerveau gauche », celui de la logique, qui ne fait pas (encore) son travail.
Les parents yankees avaient déjà tendance à être relax mais, avec la vulgarisation de ces théories, ils apprennent encore plus à oublier les réflexes autoritaires (« va dans ta chambre », « arrête ces enfantillages »…) et à écouter leur enfant. Conséquence : ils les...