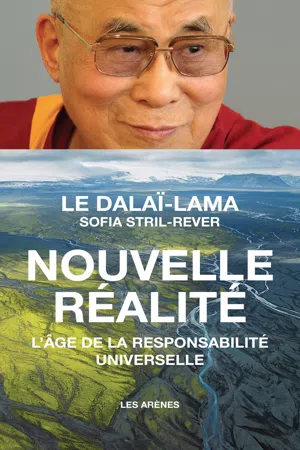![]()
II
L’ÂGE DE LA RESPONSABILITÉ UNIVERSELLE
On ne peut pas résoudre un problème avec le même état de conscience qui l’a créé. Il faut apprendre à regarder le monde avec des yeux neufs.
ALBERT EINSTEIN
![]()
Chapitre 1
ANTHROPOCÈNE,
L’ÂGE DE L’HUMANITÉ
Nous sommes des visiteurs sur cette planète. Nous sommes ici pour 90 ou 100 ans, tout au plus. Pendant cette période, nous devons tenter de faire quelque chose de bien, quelque chose d’utile, de nos vies. Contribuer au bonheur des autres est le but véritable, le sens véritable de la vie.
LE DALAÏ-LAMA
Espérer le meilleur, tout en se préparant au pire
De par leur nature, tous les phénomènes du monde sont reliés entre eux. On peut parfois penser que certains sont circonscrits à une zone ou une période donnée. Mais tel n’est pas le cas, la réalité est interdépendante. Notre santé est liée au climat, le climat aux activités humaines, les activités aux décisions politiques, la politique à l’état d’esprit de ceux qui gouvernent. Quant aux êtres humains, pour prendre soin de leur santé, ils ne peuvent pas se focaliser simplement sur un symptôme particulier et prendre des médicaments pour traiter ce seul problème sans tenir compte de leur état général. Cela ne saurait suffire. Dans notre corps, de la tête aux pieds, tout est lié. Et, plus important encore, il faut tenir compte de l’influence des émotions. Notre corps, nos émotions et notre esprit sont très dépendants. Il est donc nécessaire, en règle générale, d’adopter une perspective holistique.
Le voile de tristesse qui a plombé le visage du Dalaï-lama à l’évocation du Tibet s’estompe très vite quand nous changeons de sujet. Certes, la dégradation environnementale est exacerbée sur le troisième pôle. Si le Tibet était une île détachée du reste du monde, comme le PC chinois voudrait le faire croire, la catastrophe en marche pourrait être irréversible. Mais tel n’est pas le cas. Tous les phénomènes étant reliés, ils évoluent dans la chaîne des événements de la vie aux répercussions infinies.
L’une des formules favorites du Dalaï-lama est : « Espérer le meilleur, tout en se préparant au pire. » Pour espérer encore, la perspective holistique engage à revenir à notre humanité première, au-delà des distinctions secondaires de nationalité ou de religion. Au nom du réalisme, le Dalaï-lama n’oppose pas Chinois et Tibétains mais les voit comme des frères et sœurs, aspirant également au bonheur. Et il invite à ne jamais oublier que ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous divise :
Chacun de nous fait partie de l’humanité et doit s’efforcer d’être bénéfique à l’humanité. Notre mental s’attache trop aux différences. Mais, à la naissance, il n’y a pas de différences. Et, au moment de la mort, il n’y a pas de différences, ni non plus quand nous sommes malades. Donc, à la base, nous sommes les mêmes êtres humains, mentalement, émotionnellement, physiquement. Et le plus important est que chacun veut une vie heureuse, sans souffrance, sans guerre, sans violence. Or, la violence ne tombe pas du ciel, c’est nous qui en sommes l’origine. Je dis souvent aux États-Unis qu’il ne suffit pas de parler sans arrêt d’interdire les armes à feu. La vraie parade contre les armes est un esprit totalement engagé dans la non-violence. De sorte que, même si des armes sont disponibles, personne ne sera tenté d’en faire usage.
Force est de constater que ni la religion, ni la morale, ni la science, ni la médecine, ni le système d’éducation actuels n’ont réussi à inculquer les principes de non-violence. Je ne vois qu’un seul recours, faire prendre conscience de la responsabilité qui découle de notre humanité commune. Alors, les différences relatives à nos appartenances ethniques, religieuses ou autres deviennent secondaires. Elles passent à l’arrière-plan. Nous nous sentons tous responsables des 7 milliards d’êtres humains et de l’environnement durable, nécessaire à la vie. Telles sont nos responsabilités communes.
Changeons l’état de fait ! Ce ne sont pas les Nations unies mais des mouvements populaires qui sont à l’origine de bien des évolutions sociales positives. Les peuples ont le pouvoir de changer le monde.
Le peuple est un ensemble d’individus, par conséquent chacun d’entre nous est responsable et se doit d’apporter sa contribution pour un monde heureux et en paix. Que ce siècle soit heureux dépend en fin de compte de chacun de nous.
Le changement du monde s’effectue d’abord
dans les consciences
La responsabilité universelle ne connaît pas de frontières et ouvre sur la prise de conscience que chacun, à titre individuel, fait partie des problèmes qui se posent, et donc aussi des solutions. L’état actuel de la planète, qui peut sembler en phase terminale à bien des égards, n’est pas une fatalité. Le Dalaï-lama sait cela mieux que quiconque, lui dont la résilience est forgée par l’épreuve de plus d’un demi-siècle d’occupation de son pays. Il sait aussi que rien n’est scellé. C’est une erreur trop commune de penser qu’une situation nous dépasse et qu’on est impuissant face aux crises du monde. Chaque acte, même le plus insignifiant, est une contribution essentielle et très concrète, comme le Dalaï-lama s’en explique :
Je fais moi-même très attention à limiter ma consommation d’énergie. Et je suis content de voir que, de plus en plus, dans les hôtels, des panonceaux sont disposés pour inviter les clients à adopter un éco-comportement. Je veille moi-même à éteindre les lumières chaque fois que je quitte une pièce. Je ne prends plus de bains, seulement des douches…
Le Dalaï-lama s’esclaffe :
C’est vrai que je me douche deux fois par jour ! De toute façon, c’est mieux que de prendre deux bains par jour !
Il redevient sérieux :
Le plus problématique, ce n’est pas ça. Ce sont mes déplacements en avion, qui font grimper mon empreinte carbone. Quoi qu’il en soit, nous devons toujours être vigilants et ne pas gaspiller les ressources de la planète.
Chaque geste compte, et aussi chaque pensée. Car, au final, ce qui fera basculer l’humanité dans un cycle vertueux, ce sera la contribution de tous sur la plan de la conscience. Le changement du monde s’effectue d’abord dans les consciences. Comment imaginer qu’on puisse transformer le monde sans, au préalable, transformer l’esprit de l’être humain ? La nouvelle réalité nous appelle à cette transformation urgente.
Je pose alors la question de savoir comment, sur notre Terre meurtrie, amorcer le changement. Les politiques le promettent, les peuples le réclament, car la conviction générale, appuyée par les rapports des experts, est que la marche actuelle du monde nous conduit à une apocalypse. Mais aucune direction claire, cohérente, ne se dessine. Par où commencer ?
La réponse fuse. Directe, concise. Elle tient en un seul mot : « Interdépendance. » Un silence suit.
Ceci étant, cela vient à exister
Dans ce silence, j’entends l’écho de tant de déclarations du Dalaï-lama. J’en ai traduit bon nombre dans le cadre de ses enseignements et de ses conférences publiques. Pour comprendre le sens spécifique que donne le Dalaï-lama au mot « interdépendance1 », je me suis plongée dans la métaphysique de la voie médiane, exposée par Nagarjuna, et j’ai écouté des heures durant le Dalaï-lama exposer les arcanes de cette philosophie s’attachant à décrire la réalité telle qu’elle est :
Le bouddhisme propose une méthode qui nous rendra meilleurs en reflétant la nature véritable des choses, sans nous laisser duper par les apparences. Dans la perception que nous en avons, les phénomènes, tels qu’ils se manifestent à nous, n’ont pas de réalité ultime. Prenons l’exemple d’une montagne. Elle semble être pareille aujourd’hui à ce qu’elle était hier. Formée il y a des milliers d’années, elle représente une continuité dans le monde des phénomènes. Si l’on constate une stabilité relative dans son apparence au niveau grossier, il faut pourtant admettre que chacune de ses particules, à un niveau d’analyse très fin, se transforme d’instant en instant. Le changement, au plan infinitésimal, s’accompagne dans notre esprit d’une apparence de continuité. Or la continuité ainsi perçue est illusoire. Car rien ne perdure, il n’y a pas deux instants consécutifs qui soient identiques.
Après l’exemple de la montagne, prenons celui de la fleur, dont la fragilité et le caractère éphémère sont évidents. La fleur, aujourd’hui éclose, fut d’abord graine, puis bourgeon. Ces changements d’état illustrent l’impermanence subtile de chaque instant qui est la véritable nature de la fleur, vouée à une destruction rapide. Qu’il s’agisse d’une montagne ou d’une fleur, il faut nous habituer à comprendre qu’à l’instant où un phénomène apparaît, il porte en lui la cause de sa propre fin2.
Ces exemples du Dalaï-lama illustrent parfaitement le processus de production des phénomènes extérieurs. Selon une métaphore chère au Bouddha, de la graine éclot la pousse quand sont réunies d’une part les sept causes reliées – graine, pousse, cotylédons3, tige, bourgeon, fleur et fruit – et d’autre part les six conditions liées – terre, eau, feu, vent, espace et temps. En filant cette métaphore, le Bouddha expose les traits spécifiques de l’interdépendance des causes et des effets, au nombre de cinq. Le premier est l’impermanence : une pousse surgit seulement lorsque la graine a cessé d’exister. Le second, la continuité, car on n’observe pas d’interruption entre la cessation de la graine et la naissance de la pousse. Le troisième est la spécificité de chaque phénomène séquentiel, puisque graine et pousse ont des identités et des fonctions distinctes. Quatrièmement, une cause minime a le potentiel d’engendrer un grand effet, comme la graine minuscule qui se transforme en un arbre de très grande taille. Enfin, cinquièmement, cause et effet se suivent dans une continuité d’essence : un grain de blé donnera naissance à un épi de bl...