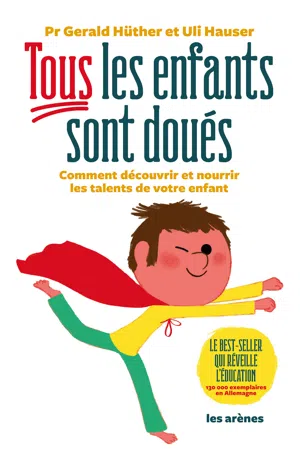![]()
1
Avant de commencer
Et s’il était permis d’être, tout simplement ? De choisir ce que l’on veut faire ou non. Se lever le matin, ouvrir la fenêtre, respirer l’air et être heureux. Heureux d’être en vie, heureux d’être au monde, heureux d’avoir des amis, des parents, une famille ?
Et si nous pouvions nous souvenir de l’instant où nous avons ouvert les yeux sur le monde pour la première fois ? Où nous avons plongé notre regard dans celui de notre mère, de notre père ? Comme nous étions bien dans leurs bras, souriant, babillant, bavouillant… Comme notre imperfection nous était égale, alors ! Que ne donnerions-nous pas pour revivre l’instant où nous fûmes propulsés de l’ombre vers la lumière, dans l’aventure palpitante nommée la vie ? Tout était si grand, si nouveau. Il semblait n’y avoir ni espace ni temps. Le simple fait d’être là était fantastique. Sans autres exigences que de respirer, manger, boire et dormir. Quand nous étions fatigués, nous nous endormions. Quand nous étions tristes, nous pleurions. Et il suffisait pour nous ravir qu’un regard joyeux se pose sur nous.
Que ne donnerions-nous pas pour revoir le monde avec nos yeux d’enfant ? Revenir à ce temps où une sensation chassait l’autre, où nous étions dans l’étonnement permanent, à la fois trop excités pour dormir et épuisés par ce trop-plein d’impressions. Comme envoûtés par les odeurs et les bruits nouveaux, et par tout ce qui nous venait à l’esprit. Nous laissions libre cours à notre imagination, à nos inventions, à des jeux qui nous projetaient dans la vie. Nous étions des rois, pas des valets. Dans notre monde fantasmé, nous marchions sur la lune, le temps n’avait plus prise sur nous. C’était comme si les autres n’avaient attendu que nous, intrépides conquérants : « Hé, toi, petit malin ! »
Comme c’était simple ! Et comme la vie est dure désormais. La légèreté s’est envolée, tant de choses nous fatiguent. Qu’est devenu notre enthousiasme d’alors ? Ce sentiment que chaque seconde est porteuse d’inédit, chaque minute d’émotions exaltantes et chaque heure d’une nouvelle perspective sur le monde ?
Nous voici maintenant, adultes, sortis de l’enfance, arrachés à l’étonnement depuis longtemps. Le devoir, les responsabilités, les habitudes ont tout enseveli. Ce qui était simple est devenu complexe. Ce qui était lent s’est accéléré. Ce qui était grand a rapetissé. Nous ne prenons plus le temps, c’est le temps qui nous prend. Nous perdons les pédales. Nous sommes fatigués, épuisés ; nous nous sentons lessivés, dépassés. Le monde du travail impose sa cadence à notre quotidien, détermine nos relations, nos conditions de vie, nos pensées. Nous en faisons chaque jour l’expérience : le progrès technique, les mutations sociales et le rythme de la vie nous laissent au bord du chemin, de plus en plus désemparés. Vivre est devenu un parcours du combattant, exigeant efficacité, perfection et optimisation. Tout doit avoir une pertinence, une fonction. Notre existence n’est qu’analyse : sans cesse nous évaluons et sommes évalués. La compétition s’est emparée de nous dans tous les domaines : dans le choix d’un partenaire, à la naissance d’un enfant, au travail comme dans nos loisirs. Nous sommes en réseau, nous sommes câblés, nous avons la tête farcie d’images que nous peinons à démêler. Nous avons un mot pour tout, mais plus de temps pour rien. Nous pensons à ce qui sera et à ce qui fut. Nous traversons l’existence en trombe, en oubliant d’être. Nous nous plions à des contraintes sans les remettre en question et acceptons d’être à la merci d’un système dominé par trois injonctions : moi, tout, tout de suite. Voilà la Sainte Trinité de notre époque.
Nous nous soucions de tout et de tout le monde. Mais quel souci avons-nous de notre propre vie ? Qui sommes-nous et que voulons-nous ? Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi vous êtes devenu tel que vous êtes ? Qui vous a le plus influencé, quelles expériences vous ont marqué ? Êtes-vous devenu qui vous vouliez être ? Ou qui vous deviez être ? Avez-vous choisi vous-même votre voie ? Vous en souvenez-vous ? Les efforts que vous avez fournis pour progresser et réussir vous ont-ils vraiment fait avancer ? Auriez-vous préféré choisir un autre chemin, qui autorise les détours, qui offre une diversité d’impressions et d’expériences nouvelles ? Peut-être alors auriez-vous acquis d’autres capacités. Peut-être d’autres talents auraient-ils éclos en chemin.
Il est difficile de dire tout ce qui était en vous quand vous étiez petit. De quoi vous rêviez, ce qui déclenchait votre enthousiasme. Ce qui vous faisait avancer. Et avec quels dons vous êtes né. Vous êtes-vous déjà demandé lesquels de vos talents sont restés en friche, inexploités dans votre vie jusqu’à présent ? Et avez-vous une idée des talents qui sommeillent en vos enfants ? De ce qu’ils savent vraiment bien faire ou non ?
Qu’est-ce, au juste, qu’un talent, un don particulier ? Comment naît-il ? Les talents sont-ils innés ? Comment savoir s’il y a chez un enfant quelque chose que les autres n’ont pas ? Et qu’advient-il de ce don si personne ne le découvre ni ne fait en sorte qu’il s’épanouisse chez cet enfant ? Si personne n’est là pour conforter, encourager, inciter ? Il y a fort à parier que ce talent s’étiole.
Quel dommage ce serait ! Que le monde serait pauvre, si nous ne jouissions pas de ses immenses talents ! Que ne devons-nous pas à tous les héros de l’histoire qui ont fait fructifier leurs dons : Armstrong et Chaplin, Dalí et Disney, Mozart et Wagner ! Leurs œuvres, qui ont traversé le temps, sont éternelles. Ils ont suivi leur vocation, et nul ne peut dire, a posteriori, quand ils en ont entendu l’appel pour la première fois. Qu’est-ce qui a fait qu’ils l’ont reconnue, puis furent reconnus ? Que serait-il advenu si les parents d’Einstein avaient fait passer l’envie de rêver à leur rejeton timide, s’ils lui avaient interdit de passer des heures à construire des châteaux de cartes ? Si ses enseignants n’avaient pas toléré que le petit Albert rumine durant des heures la réponse à une question et se montre incapable d’apprendre par cœur ses leçons ? Interrogé plus tard sur le secret de son succès, le grand penseur à la veste informe donna une réponse inattendue : il n’avait aucun don particulier, il était juste « passionnément curieux ».
Formidable ! Mais à quels signes reconnaît-on les dons et les talents qui se cachent chez un enfant ? Un don, en effet, ne se traduit pas immédiatement par une performance, un savoir-faire ou une aptitude exceptionnels. Un don ou un talent se présente d’abord comme une simple possibilité, celle d’acquérir plus tard une faculté particulière et de réaliser des performances remarquables par rapport à ce que d’autres sont en mesure d’assimiler et d’accomplir dans le même domaine.
Certains experts, dénicheurs de talents autoproclamés, se targuent de découvrir si un enfant est porteur d’un potentiel de ce genre. Dans le sport de compétition, ils sont nombreux à faire le tour des stades. Ils examinent très tôt les enfants, observent leurs mouvements, évaluent leur volonté et rendent leur verdict. Ces « scouts » sont peut-être capables de jauger, d’après sa constitution, si un enfant présente des dispositions propices à de futures prouesses. Mais à la réflexion, quand on sait, par exemple, que de très grands sportifs, tel le footballeur Lionel Messi, élu à plusieurs reprises meilleur joueur de l’année, sont plutôt de petite taille, le manque de fiabilité de ce genre de pronostics saute aux yeux.
Repérer un talent n’est donc pas si simple et se révèle encore plus délicat quand il s’agit de découvrir précocement des dons d’ordre musical, créatif ou intellectuel, qui exigent d’y regarder d’encore plus près. Thomas Alva Edison, par exemple, l’un des plus grands inventeurs de l’histoire de l’humanité, a toujours été le plus mauvais élève de sa classe. Les professeurs de Marcel Proust trouvaient ses dissertations grotesques. Pablo Picasso ne put jamais retenir l’alphabet dans l’ordre. Giacomo Puccini échoua à tous ses examens. Et Paul Cézanne fut refusé aux Beaux-Arts.
Discerner les dons qui feront des enfants des dirigeants politiques ou économiques de premier plan n’est pas plus facile. Et il en va de même quant aux personnalités renommées pour leur engagement et leur humanité. Qui aurait imaginé, quand il était sur les bancs de l’école, que le petit Nelson Mandela deviendrait l’une des plus grandes figures de l’histoire mondiale, comparable au mahatma Gandhi ? Lequel Gandhi parlait de ses années d’école comme de la période la plus malheureuse de sa vie. Aurait-on pu deviner que la fille de modestes paysans albanais consacrerait sa vie à aider les pauvres sous le nom de Mère Teresa ? Ou qu’un garçon replet prénommé Winston deviendrait le grand Churchill ? Autant d’exemples, autant de possibilités. Ces personnages, en effet, sont des génies inégalés, comme le furent Beethoven dans le domaine de la musique ou Henry Ford dans celui de l’entreprise moderne. Si l’on en croit la légende, le petit Henry démontait et remontait déjà des montres à l’âge de 7 ans. Il passait son temps à bricoler, explorer et construire, jusqu’à ce qu’un jour un engin motorisé à quatre roues trônât dans son garage : l’automobile était née.
Qui se demanderait à quel moment on s’est aperçu qu’untel était capable de réaliser des performances hors du commun ou d’assumer de très hautes responsabilités serait déconcerté par la réponse : ces gens-là, précisément, ne se sont pas fait remarquer par leurs résultats exceptionnels quand ils étaient petits, ni au jardin d’enfants ni à l’école, ni plus tard à l’université – s’ils y sont allés. Au contraire, la plupart d’entre eux se sont plutôt distingués par le fait qu’ils n’étaient à leur place ni à l’école ni en formation professionnelle. L’école, a déclaré le compositeur norvégien Edvard Grieg, « n’a développé en moi que le mauvais, sans toucher au bon ». La plupart des génies, à force de frustration, ont interrompu leur scolarité. Ils ont été des élèves sans motivation, des originaux têtus, des anticonformistes inadaptés, affranchis des modèles standards. Ils n’arborent ni réussite scolaire particulière ni diplômes professionnels ou universitaires exceptionnels. Nombre de ceux qui aujourd’hui enrichissent nos existences n’ont pas eu la vie facile étant enfants. John Lennon, par exemple, fut exclu du jardin d’enfants et Woody Allen avait des problèmes à l’école car il s’intéressait à tout sauf à ce que disaient ses enseignants.
Les aptitudes hors du commun que nous admirons aujourd’hui chez ces personnalités se sont manifestées lorsqu’elles se sont consacrées à ce qui était important pour elles – et non plus à ce que l’on attendait d’elles. Salvador Dalí dessinait du matin au soir et Pablo Picasso refusa d’apprendre à compter. Ils peignaient, exploraient, rêvaient. Et cela avec une résolution, un savoir-faire et un succès dont personne – parents, éducateurs, enseignants, formateurs, professeurs – ne les aurait crus capables. Dès lors, ils firent preuve de caractère, de constance, de créativité et d’opiniâtreté. Restant parfois des heures concentrés sur une question, jusqu’à trouver la réponse. Ils étaient simplement eux-mêmes, fidèles à leurs propres exigences. Rien de moins.
À l’école, cependant, l’obstination et le caractère ne sont guère appréciés. La tâche de l’enseignant consiste à exiger un résultat précis, normé une fois pour toutes, puis à comparer ce résultat à d’autres. Pour ce faire, un bulletin est rempli, une moyenne est calculée. Si la moyenne générale est trop basse, il faudra surtout travailler les matières qu’on aime le moins, celles où l’on a les plus grosses lacunes. C’est ainsi que l’on met en place du soutien en français, pour passer de « médiocre » à « passable ». Mais pas en anglais, pour passer de « satisfaisant » à « très bien ». C’est un système absurde, qui consiste à passer beaucoup de temps là où l’on n’est pas très doué, au lieu d’en investir davantage là où l’on a des capacités, afin de devenir vraiment bon. Dans le système scolaire, une seule chose compte à la fin : être en mesure de présenter une moyenne passable. Qui avait cru jusque-là que vivre, c’est aspirer à s’élever ne tarde pas à apprendre qu’il vaut mieux viser la moyenne. Ce que disait le talentueux philosophe des Lumières et satiriste Georg Christoph Lichtenberg à propos de l’école est peut-être juste : « Je crains que notre éducation par trop soignée ne produise que des fruits nains. »
Ce système a fonctionné tant bien que mal ces dernières décennies. Ce que l’on devait savoir à un moment donné fut arrêté un jour, avec une note pour chaque bonne réponse. Qui ne rapportait pas les meilleures notes à la maison devenait mécanicien ou plombier ; qui voulait devenir médecin devait potasser. On consacrait peu de temps à promouvoir l’autonomie et à identifier les potentiels. Comme, par exemple, chez les enfants qui, en raison d’une déficience génétique, la trisomie 21, étaient considérés, il y a quelques années encore, comme incapables d’apprendre. Étant donné qu’ils ressemblent un peu à des Mongols, on les qualifiait de « mongoloïdes ». Ou bien on les traitait d’« idiots », médecins et psychologues ayant longtemps considéré comme tels les individus porteurs d’un lourd handicap mental. Or, ces enfants passent désormais le bac et font des études. Leur anomalie génétique est toujours là, mais ils ont eu la chance de tomber sur des enseignants qui ont refusé de croire qu’il n’y avait rien à tirer d’eux. Ceux-ci ont traité ces élèves particuliers avec respect et ont accepté leurs spécificités, sans craindre d’aller à leur rencontre. Ils ont compris leur très grande sensibilité et leur ont remonté le moral dans des situations apparemment sans issue. Ils ont été enthousiasmés par leur naturel joyeux. Et ce qui paraissait impensable fut soudain possible.
Mais, la plupart du temps, école et développement du potentiel ne font pas bon ménage. Et le fait que nombre d’enfants et d’adolescents continuent d’être considérés comme des bons à rien n’inquiète pas les responsables de notre système éducatif. Ce qui compte avant tout, ce sont les bons diplômes. C’est la production d’individus hyperperformants, censés prendre le leadership. Tout système éducatif supporte un certain nombre de ratés, tant qu’il génère suffisamment d’élèves d’élite et de diplômés des universités en mesure d’occuper des postes-clés dans l’économie, la science et la politique.
C’est ce que pensaient jusqu’ici la plupart des citoyens cultivés. Et c’est pour cela que notre système éducatif a perduré en l’état. Talents et bonnes notes continuent d’être confondus. Savoir exprimer sa sympathie à autrui et l’écouter ne joue aucun rôle sur un bulletin, ni pour obtenir une place à l’université. Pour devenir médecin, les maths l’emportent sur la compassion.
Mais cette façon de penser est révolue. Elle ne nous mènera pas plus loin. Nos écoles sont dépassées. Notre système éducatif archaïque, avec ses critères sélectifs, n’est plus à la hauteur des nouvelles exigences.
Qui plus est, même les prétendus high performers s’avèrent de plus en plus souvent n’être pas si bons que cela. Les élèves modèles arborent d’excellents bulletins et des diplômes éblouissants. Ils réussissent avec brio...