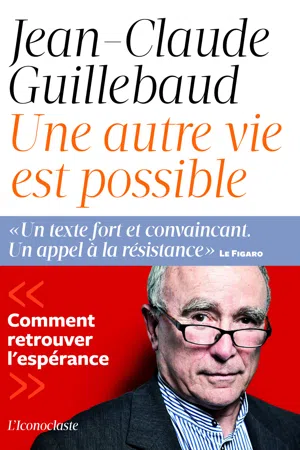1. Renverser la montagne
J’aimerais trouver les mots, le ton, la force afin de dire pourquoi m’afflige décidément la désespérance contemporaine. Elle est un gaz toxique que nous respirons chaque jour. Et depuis longtemps. L’Europe en général et la France en particulier semblent devenues ses patries d’adoption. Elle est amplifiée, mécaniquement colportée par le barnum médiatique. Oui, mécaniquement. Par définition, le flux médiatique est un discours attristé, voire alarmé. Il s’habille en noir. Or la réalité n’est jamais aussi sombre. Elle est faite d’ombres et de lumières. Elle mêle le pire au meilleur. Partout. Toujours. À n’insister que sur les ombres, on pèche — et on ment — par omission. En toute bonne foi. Vieille question ! Cette insuffisance n’est pas facile à corriger. L’optimisme n’est plus « tendance » depuis longtemps. On lui préfère le catastrophisme déclamatoire ou la dérision revenue de tout, ce qui est la même chose. Se réfugier dans la raillerie revient à capituler en essayant de sauver la face. Après moi le déluge…
Cette culture de l’inespoir — avec ses poses et ses chichis — me semble aussi dangereuse que les idéologies volontaristes d’autrefois. Elle désigne le présent comme un répit, et l’avenir comme une menace. Elle se veut lucide, et même « raisonnable ». Qui croit encore aux lendemains qui chantent ? Pourquoi perdre son temps à rêver au futur ? Telle est la doxa (« ensemble des opinions communément admises ») du moment. Les affligés professionnels tiennent le haut du pavé et, de ce promontoire, toisent tout un chacun. Il est de bon ton de citer Arthur Schopenhauer, sa référence au « temps cyclique » et son (prétendu) pessimisme, ou encore Émile Cioran, auteur de Sur les cimes du désespoir. L’écrivain anglais Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) n’avait pas tort de dire qu’il existait une « Église du pessimisme ».
Ajoutons que ce renoncement au goût de l’avenir peut devenir une injonction discrètement idéologique. En dissuadant les citoyens de trop penser au futur, elle les invite à s’accommoder du présent, c’est-à-dire de l’ordre établi. Elle promeut pour ce faire quantité de formules passe-partout qui sont devenues autant de slogans conservateurs. On se souvient du There is no alternative, « Il n’y a pas d’alternative », de Margaret Thatcher. Citons aussi l’inévitable « C’est plus compliqué que cela », qu’on oppose aux citoyens indignés par une injustice et révoltés par la prédation des virtuoses de la finance. Ou encore le « Face au chômage, on a tout essayé », exclamation malheureuse de François Mitterrand en 1993. Pendant plusieurs décennies, les élus de droite et de gauche auront tenu et conforté ce que l’économiste Jean-Paul Fitoussi appelle le discours de l’impuissance. À force d’insister sur les « contraintes », il aggrava la crise de la démocratie et jeta les citoyens dans une langueur dont nous ne sommes toujours pas guéris.
J’aimerais trouver les mots pour parler autrement… J’y pense presque chaque matin, à l’aube, quand je vois rosir le ciel au-dessus des toits de Paris ou monter la lumière derrière la forêt de la Braconne, chez moi, en Charente. L’espérance a beaucoup à voir avec le petit matin. Ou le mois d’avril. L’idée d’un commencement, d’une remise en route, d’une infatigable renaissance. L’appétit de l’avenir et l’énergie du matin sont vraiment le propre de l’homme. Nous sommes mus par le besoin d’un « en-avant » déterminé. Seul cet impératif nous dissuade de trop sacrifier à la nostalgie et aux tentations restauratrices qui lui font escorte. Je pense à cette petite voix qui nous souffle parfois à l’oreille : « C’était mieux avant, retournons en arrière. »
J’ajoute que la petite fille espérance que célébrait Charles Péguy n’est pas, loin s’en faut, l’apanage des juifs ou des chrétiens. C’est un athée résolu, marxiste non orthodoxe, Ernst Bloch, qui publia dans les années 1950 un maître livre en trois volumes, intitulé Le Principe espérance. Je m’en suis beaucoup nourri. Il y pointait le risque létal de ce que les Grecs appelaient la heimarmené, l’inéluctable destin d’un monde clos, c’est-à-dire sans projet ni dessein. Aujourd’hui, Bloch paraît oublié ou carrément contredit. Serions-nous condamnés à cette clôture de l’avenir ? Serait-ce là notre nouveau fatum (destin) ? Je ne m’y résous pas. Je sais qu’un monde ainsi borné ne serait pas durablement habitable.
Trouver les mots pour parler simplement d’espérance, cela implique — d’abord ! — de refuser la niaiserie. Je pense à celle du professeur Pangloss (« Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ») dont Voltaire se moque avec raison dans Candide. À travers Pangloss, Voltaire ironise sur la théodicée du philosophe et scientifique allemand Gottfried Wilhelm Leibniz. Le conte Candide, publié en 1759 — trente petites années avant la Révolution —, est d’ailleurs ironiquement sous-titré : L’Optimisme. Trouver les mots, c’est montrer que ni l’optimisme ni l’espérance n’équivalent à une sotte crédulité de ce genre. Quant à sa jumelle inversée, la désespérance, fût-elle talentueuse, elle n’est pas toujours aussi lucide qu’elle le prétend. Pour dire la vérité, elle l’est rarement et succombe le plus souvent à la futilité. Désespérer avec ostentation, sauf s’il s’agit de littérature, est un dandysme qui ne m’a jamais tenté. Où conduit-il ? Je garde en tête un vers de Goethe : « Le pessimiste se condamne à être spectateur. » Très peu pour moi.
Cherchant les mots et le ton, je relis l’admirable préface écrite par Bernanos à ses Grands Cimetières sous la lune. Quel rapport ? Dans ces pages rédigées en 1937, Bernanos adjure ses amis catholiques de désavouer les crimes commis par les soudards franquistes. Il les presse de condamner les évêques espagnols qui, toute honte bue, absolvent les assassins et bénissent les tanks de Francisco Franco Bahamonde. « La colère des imbéciles m’a toujours rempli de tristesse, mais aujourd’hui, elle m’épouvanterait plutôt. Le monde entier, ajoute Bernanos, retentit de cette colère. » Il écrit résolument contre les siens, contre toute facilité tribale et en bravant la bienséance catholique. Il cherche les mots pour renverser les montagnes. Il subira injures et moqueries venues de son propre camp. Il tiendra bon. C’est en cela qu’il est notre contemporain.
Théorisé, rabâché, valorisé, l’inespoir d’aujourd’hui est plus lourd qu’une montagne. Il pèse le poids d’une pierre tombale. L’époque nous inspire des idées de fatalité, ou de causes perdues. Jouissez vite du présent et n’attendez rien de l’avenir : on connaît la rengaine. Elle est mortifère. À ce discours désappointé, il faut opposer une parole plus robuste. Espérer ne consiste pas à rêvasser ni à se priver de je ne sais quelle jouissance immédiate. Si l’espérance concerne l’avenir, elle se vit au présent, un présent qu’elle éclaire et enrichit. Loin de « soustraire » quelque chose au bonheur immédiat — comme le répète depuis vingt ans le philosophe André Comte-Sponville —, elle lui ajoute une dimension. Et une saveur. Renoncer à l’espérance n’entraîne par conséquent aucun « bénéfice » en termes d’hédonisme. Si tel était le cas, alors les sociétés rassemblées autour d’un projet d’avenir et d’une espérance seraient moins heureuses que celles qui, n’espérant plus rien, se vouent à l’ébriété du présent.
L’absurdité du raisonnement saute aux yeux. On voit la mystification dont Comte-Sponville se fait, en toute bonne foi et avec un grand talent, le troubadour. La sagesse grecque — hédoniste ou stoïcienne — procède par adaptation à un monde qu’elle renonce à transformer. Pourquoi tenterait-on de corriger une réalité cosmique qui redeviendra, fatalement, ce qu’elle fut ? Faire aujourd’hui retour à ce stoïcisme, c’est consentir à baisser les bras. Cela conduit à accepter docilement la « fin de l’histoire », pour reprendre l’expression hâtive par laquelle Francis Fukuyama prenait acte, en 1992, de l’effondrement du communisme. C’est une lâcheté. Vingt ans après, qui soutiendrait encore que l’Histoire est « finie » ? Qui pourrait affirmer que le débat n’a plus lieu d’être ? Espérer, c’est refuser de s’en remettre à la fatalité. J’aime par-dessus tout un passage de la Torah (« livre des Psaumes ») qui nous invite à ne pas « abandonner le monde aux méchants ».
Mais attention ! Cet optimisme du projet que j’oppose ainsi à une « sagesse » trop docile ne doit pas devenir angélique, ou alors il devient une posture comme une autre. Bernanos, dans ses « Cimetières », se défie avec raison de la fausse béatitude de Pangloss : « L’optimisme, écrit-il, m’est toujours apparu comme l’alibi sournois des égoïstes, soucieux de dissimuler leur chronique satisfaction d’eux-mêmes. » Plus tard, il sera plus violent encore en écrivant dans La Liberté, pour quoi faire ? : « L’optimisme est une fausse espérance à l’usage des lâches et des imbéciles. » Ne jouons surtout pas au ravi de la crèche ! Non, tout n’est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le désarroi et la souffrance partout présents en portent témoignage. C’est dire s’il faut peser ses mots quand on refuse le pessimisme contemporain. À bien des égards, il est justifié. Pas question de lui opposer un optimisme trop claironnant qui fermerait les yeux sur les périls.
Durant l’année 2011, dans le cadre d’un colloque à Strasbourg, je fus invité à commenter la fameuse exclamation du pape Jean-Paul II : « N’ayez pas peur ! » J’ai répondu que, prise au pied de la lettre, elle pouvait apparaître comme une fanfaronnade chrétienne. Il existe quantité de raisons d’avoir peur par les temps qui courent. Je vois bien la peur que ressentent les hommes et les femmes autour de moi. Je la respecte. Il m’arrive de l’éprouver moi-même. Elle est légitime. Je pense aux peuples de notre vieille Europe qui craignent le chômage de masse et la précarité, qui perçoivent autour d’eux une société disloquée, redoutent de ne plus pouvoir compter sur le rôle protecteur de l’État, ou s’alarment simplement du lien social qui se rompt. Dans son dernier livre, le philosophe Jean-Pierre Dupuy, inventeur de l’expression « catastrophisme éclairé », écrit que ce dernier est « un optimisme fondé sur la raison ». J’ajouterai que l’espérance est — aussi — une disposition de l’âme, une sensibilité qu’il faut mettre en mouvement.
Puisque je parle en mon nom propre, évacuons d’abord les aspects personnels de la question. Voilà des années qu’on me questionne sur l’espérance qui m’habite, contre toute vraisemblance, ajoute-t-on. On en trouve trace dans tous les livres que j’ai écrits. On me dit qu’elle détonne. Comme journaliste, j’ai passé vingt-cinq ans de ma vie à « couvrir » les guerres, les révolutions, et les tragédies. Au journal Le Monde, comme grand reporter, je fus le préposé aux catastrophes. Cela correspond à des centaines d’heures passées au milieu des égorgements, des famines, des tueries et des désastres. Du Biafra (1969) à la Bosnie (1994), j’ai vu mourir et s’entre-tuer les hommes. En toute logique, cet exil consenti dans les tragédies du lointain aurait dû faire de moi un tourmenté sans illusions sur la nature humaine. De ces victimes dont j’ai partagé — pour de brefs moments — l’épouvante, je devrais, paraît-il, porter le deuil. On attend de moi des propos sombres, voire un dégoût de la vie. À la limite, on comprendrait que je sois devenu cynique. Et taiseux.
Ce n’est pas le cas. Le cynisme me fait horreur, et la désillusion m’apparaîtrait comme une trahison. Mon optimisme n’a pas « survécu » aux famines éthiopiennes, aux assassinats libanais ou aux hécatombes du Vietnam. Tout au contraire, il leur doit d’exister, il s’est nourri et fortifié de ce que j’ai vécu là-bas. Quand je me remémore ces années-là, c’est l’énergie des humains, l’opiniâtreté de leur espérance, l’ardeur de leurs recommencements qui me viennent en tête. Je pourrais mettre des noms propres sur tous ces êtres que j’ai vus s’accrocher à l’avenir, avec cette infatigable volonté qui leur permettait de rester debout dans le désastre. Ceux-là continuaient de penser qu’au-delà des souffrances et des dévastations un « demain » demeurait possible.
Comprenons également qu’à cette espérance droite et forte s’ajoutait une solidarité instinctive, un réflexe d’entraide qui en était à la fois la cause et la conséquence. Les sociologues, psychologues ou psychiatres ont étudié cet altruisme paradoxal qui surgit au cœur même des catastrophes. Ils citent aujourd’hui l’exemple des attentats du 11 septembre 2001 à New York, ou bien celui de l’ouragan Katrina en septembre 2005, à La Nouvelle Orléans. Il s’est passé dans ces deux villes des scènes de courage, de solidarité, de générosité dont on se souviendra longtemps. Cette empathie spontanée et cette espérance, je les ai vues à l’œuvre pendant vingt ans, et sur tous les continents.
À la longue, j’ai fini par me sentir comme dépositaire de cette flamme. Des bidonvilles de Calcutta aux rizières du delta vietnamien, des villages de la montagne du Chouf libanais déchirés par les massacres aux vallées du Sahel érythréen bombardées par les Sukhoï de l’aviation soviétique : partout la même leçon de courage. À Sarajevo en 1992, dans cette avenue mortelle qu’on appelait snipers alley car elle était sous le feu des tireurs serbes embusqués dans les collines, j’ai assisté à une scène inimaginable. Alors que les rares passants se mettaient précipitamment à courir pour échapper aux balles des Tchetniks serbes, un homme d’une quarantaine d’années a interrompu sa course. Reprenant une allure normale, il a parcouru la dernière centaine de...