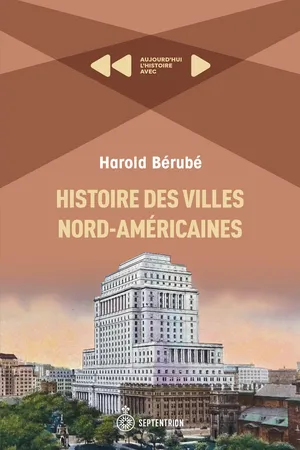![]()
L’invention du
gratte-ciel, cathédrale
du Nouveau Monde
« J’ai vu New York
New York U.S.A.
J’ai vu New York
New York U.S.A.
J’ai jamais rien vu d’au
J’ai jamais rien vu d’aussi haut
Oh ! C’est haut c’est haut New York ! »
New York U.S.A., chanson composée par Babatunde Olatunji et interprétée par Serge Gainsbourg (1964)
Il est difficile, voire impossible, d’imaginer un paysage métropolitain nord-américain sans ses gratte-ciel. Ces flèches verticales qui s’élancent vers le ciel et dominent les centres-villes du continent sont depuis plus d’un siècle des éléments centraux du décor urbain. Ces édifices coûteux et complexes représentent tout à la fois une solution pratique aux problèmes de densité des grandes métropoles par l’expansion verticale du bâti, mais également d’importants symboles de prestige pour ceux qui les construisent ou y apposent leur nom, ainsi que pour les villes dans lesquelles ils se trouvent. On a qu’à penser aux deux tours du World Trade Center, symbole de la puissance financière de la métropole américaine, et au choix des terroristes d’Al-Qaeda d’en faire une de leurs cibles en septembre 2001. Et c’est pour restaurer ce symbole qu’on s’empressera de construire, sur leur site, la Freedom Tower. C’est aussi une puissance symbolique dont on continue de se réclamer à travers le monde de nos jours. Songeons simplement à ces villes chinoises transformées, en quelques décennies, en vastes métropoles aux hautes tours illuminées ou aux constructions, toujours plus hautes et élaborées, construites ces dernières années à Dubaï. Le gratte-ciel a conquis le monde. Cela dit, il demeure d’abord et avant tout une « invention » américaine. Et si ce modèle est reproduit à travers le monde, certains édifices made in the USA, comme l’Empire State Building, ont acquis un caractère emblématique.
Les villes de Chicago et New York n’ont pas le monopole du gratte-ciel. Toutefois, on peut difficilement faire l’histoire de ces édifices sans s’intéresser à ces deux métropoles américaines. La première est le laboratoire où seront développées et perfectionnées plusieurs des technologies qui rendent possible leur construction, alors que la seconde devient rapidement la vitrine où se déploient les gratte-ciel les plus emblématiques du continent.
L’invention du gratte-ciel
Comme bien d’autres phénomènes urbains décrits dans les pages de cet ouvrage, le gratte-ciel est une innovation relativement récente dans l’histoire des villes du continent nord-américain. Ces hautes tours apparaissent dans les années 1880, mais ne commencent à se multiplier rapidement que durant les années 1920. Ce développement relativement tardif d’édifices construits en hauteur s’explique bien sûr par les nombreux obstacles techniques et technologiques qu’il fallait surmonter pour les ériger. Or, il en va aussi d’une certaine volonté urbanistique : ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que le développement vertical des villes devient un enjeu suffisamment important pour justifier un tel déploiement de ressources.
Gratte-ciel de New York, 1901. Illustration : Otto H. Bacher, Washington, D. C., Library of Congress, LC-DIG-cai-2a11521.
Il est d’ailleurs facile d’oublier que l’apparition des gratte-ciel marque une rupture avec les villes préindustrielles. Après tout, l’apparition des premières grandes tours représente une véritable conquête du ciel pour leurs bâtisseurs. Rappelons par exemple qu’au milieu du XIXe siècle, l’édifice le plus haut de la ville de New York est l’église Trinity, d’une hauteur de 86 mètres. Construit en 1841, cet édifice religieux demeure le bâtiment le plus élevé de la ville pendant 53 ans ! Par la suite, aucun autre édifice new-yorkais ne sera en mesure de conserver ce record aussi longtemps. Ajoutons que, sur le plan symbolique, il y a quelque chose de frappant dans le fait que ces édifices à vocation religieuse, qui ont longtemps dominé le paysage urbain, vont peu à peu se perdre entre les gratte-ciel qui symbolisent, quant à eux, l’incroyable puissance financière des métropoles de l’ère industrielle.
Sweet Home Chicago
Cela dit, avant de nous tourner vers la Big Apple, il est nécessaire de porter notre attention du côté de Chicago, métropole du Midwest américain. On peut se demander avec raison pourquoi cette ville deviendra le véritable berceau du gratte-ciel. Au milieu du XIXe siècle, avec ses 29 000 habitants, elle est loin de pouvoir rivaliser avec les grands centres portuaires de la côte est. Cela dit, durant les décennies 1850 et 1860, profitant de son rôle de plus en plus central comme carrefour entre l’est et l’ouest du pays, Chicago va croître à un rythme infernal. Au début des années 1870, alors qu’elle compte plus de 300 000 habitants, la ville est le théâtre d’une tragédie qui aurait pu l’emporter, mais qui contribuera plutôt, ironiquement, à son épanouissement comme métropole.
En octobre 1871, la légende veut qu’une vache appartenant à Patrick et Catherine O’Leary ait fait tomber une lampe à l’huile dans la grange où elle se trouvait, provoquant un incendie qui ravage pendant deux jours la plus grande partie de la ville, surtout composée de bâtiments de bois. Dans les circonstances, les pertes de vies occasionnées par la conflagration sont remarquablement basses, entre 200 et 300 victimes, mais c’est plus du tiers des habitants de la ville qui sont alors jetés dans la rue. De plus, l’ensemble du district commercial est réduit à néant par l’incendie. Confrontées à ce désastre, les élites politiques et économiques locales se lancent, dans les années 1870 et 1880, dans une des plus vastes entreprises de reconstruction du continent. L’incendie est, à certains égards, une véritable opportunité. En effet, l’ancien cadre bâti de la ville est presque anéanti, ce qui signifie qu’on n’a pas à négocier l’expropriation et la démolition de tel ou tel bâtiment. Cela signifie également qu’il est possible de procéder plus largement à la reconstruction, sans devoir contourner des édifices, pâtés de maisons ou secteurs dont les propriétaires seraient récalcitrants. En d’autres mots, le cœur de la ville est devenu une véritable tabula rasa sur laquelle il sera possible de rebâtir la ville à neuf à l’aide des techniques les plus avancées de l’époque, techniques qui ouvrent la porte à des constructions d’une hauteur sans précédent.
Les ruines de Chicago après le grand feu de 1871. Photo : G. M. Watson, Washington, D. C., Library of Congress, LC-DIG-ds-14601.
Il ne faut d’ailleurs pas sous-estimer la complexité des technologies nécessaires pour construire et rendre habitable un gratte-ciel, que l’on pense simplement aux ascenseurs et aux systèmes de ventilation, chauffage et climatisation. Ces diverses technologies se développent et se raffinent au fil du XIXe siècle, mais la plus importante est très certainement l’acier, indispensable à la construction des structures qui supportent le poids de l’édifice. Une des principales préoccupations des habitants de Chicago, dans le cadre de la reconstruction de la ville, est évidemment la lutte aux incendies. Alors que plusieurs des bâtiments détruits en 1871 étaient réputés être résistants aux flammes, de nouvelles mesures sont mises de l’avant pour les rendre encore plus ignifuges et sécuritaires. Une de ces mesures est l’utilisation plus systématique d’acier.
Dans les années 1870-1880, l’utilisation de fer et d’acier dans la construction de bâtiments n’est pas nouvelle. On emploie ces matériaux en Grande-Bretagne dès la fin du XVIIIe siècle. Toutefois, la production d’acier demeure extrêmement dispendieuse, ce qui en limite considérablement l’utilisation. Au milieu du XIXe siècle, l’introduction du procédé Bessemer, qui permet de produire un acier de bonne qualité à relativement peu de frais, va révolutionner le monde de la construction. Les architectes s’intéressent d’abord assez peu à cette innovation, tandis que les constructeurs de chemins de fer et de ponts en font bon usage. C’est d’ailleurs par l’entremise de ces derniers que l’acier sera graduellement introduit dans la construction de bâtiments. En effet, les exploits des constructeurs de ponts, appelés à bâtir des structures qui doivent être à la fois longues et relativement légères, attirent rapidement l’attention des architectes : c’est notamment le cas du pont de Brooklyn, dont la construction très médiatisée s’étale de 1869 à 1883.
Bien que la technologie le permette, pourquoi construire en hauteur ? À cause de sa géographie particulière, le centre-ville de Chicago est particulièrement étroit. En effet, il est encerclé à la fois par le lac Michigan, la rivière Chicago et le chemin de fer dont dépend la bonne fortune économique de la ville. Les terrains qui se trouvent dans ce secteur central et enclavé, surnommé le Loop, valent donc une fortune. Les membres de la vieille élite économique de Chicago ne réalisent pas initialement tout le potentiel de ces terrains. En fait, cet espace limité leur apparaît d’abord comme un problème. Mais un riche homme d’affaires de Boston, Peter C. Brooks, qui vient investir dans l’ouest du pays, réalise rapidement qu’un développement vertical plus ambitieux permettrait de faire des affaires d’or sur les terrains convoités du Loop.
Brooks s’associe à un autre homme d’affaires de Nouvelle-Angleterre, Owen F. Aldis, lui aussi attiré par les possibilités d’affaires à la suite de l’incendie de 1871. Ils achètent rapidement un lot sur lequel ils espèrent élever un édifice d’une hauteur sans précédent. Brooks écrit alors une lettre à Aldis où se trouve magnifiquement résumée la philosophie architecturale qui viendra à dominer la construction de gratte-ciel en Amérique du Nord : « The building is to be for use and not for ornament. Its beauty will be in its all-adaptation to its use. »
Pour réaliser leur projet, les deux associés approchent les architectes Daniel Burnham (que l’on a croisé dans le chapitre sur le mouvement City Beautiful) et John Wellborn Root. Comme beaucoup de leurs collègues de Chicago, les deux hommes n’ont pas une formation très poussée et ont l’habitude d’improviser, de chercher des solutions innovatrices aux problèmes pratiques auxquels ils sont confrontés. L’édifice Montauk, qu’ils vont construire pour Brooks et Aldis en 1882-1883, n’est pas à proprement parler le premier gratte-ciel malgré ses dix étages et ses 40 mètres, mais c’est le premier édifice à intégrer plusieurs des technologies qui permettront à ce genre de bâtiment de se développer. Burnham et Root utilisent notamment beaucoup d’acier dans la structure et, surtout, développent de nouvelles techniques pour poser les fondations de leur édifice, un défi majeur pour la construction de gratte-ciel. En effet, plus les édifices sont grands, plus leur poids est important. Leurs fondations doivent être en mesure de supporter cette charge...