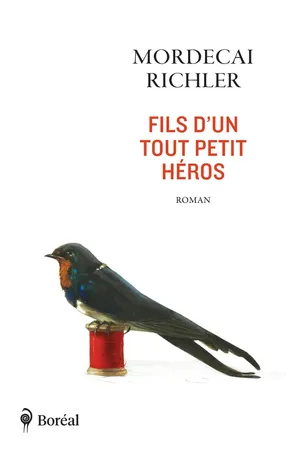DEUX
Automne et hiver 1952
1
En fin de compte, Mme Mahoney n’avait rien contre les pitounes ni même contre les fêtes, à condition d’être invitée. Elle était terriblement seule. Noah mangeait avec elle une fois par semaine et l’emmenait au cinéma dès que l’occasion se présentait. Il se lia aussi avec le couple d’en face, M. et Mme Joey Nowacka, et cette amitié fortuite lui coûta son tourne-disque. Joey buvait et perdait de l’argent aux courses de chevaux, Bertha était enceinte. Bien vite, Bertha devint la responsabilité de Noah – et ses économies y passèrent.
Noah était seul, lui aussi. Il parlait beaucoup de sa famille à Mme Mahoney et aux Nowacka. Souvent, pendant les périodes creuses, il roulait dans les rues du ghetto, se remémorait les lieux et les choses qu’il y avait faites. Une fois, sa résolution avait faibli et il avait envisagé de rentrer, mais une visite à sa mère l’avait vite convaincu qu’il n’y avait pas de retour en arrière possible. Il lisait beaucoup. Il marchait. Sa chambre était peuplée de rêves et il n’était pas heureux. L’université, par exemple, avait été une déception de plus.
Le principal du collège Wellington était un petit homme aux yeux incolores dont on se souviendrait et qu’on célébrerait parce qu’il craignait Dieu et se montrait tolérant envers les hommes. Universellement respecté, il n’oubliait jamais le visage d’un wellingtonien. Le doyen avait constitué une colossale bibliographie miméographiée où étaient énumérés les dimensions, le titre, le nombre de pages, les illustrations, l’auteur et le sujet de tous les livres publiés au Canada. Edward Walsh, le vice-doyen, possédait un sourire resplendissant : comme hôte, il n’avait pas d’égal. Il commençait ses cours d’initiation aux sciences politiques en écrivant sur le tableau noir :
I. SYSTÈMES DE GOUVERNEMENT
a. monarchie
b. totalitarisme
c. démocratie
d. autres
(Le Canada est une démocratie parlementaire)
La plupart des étudiants du collège avaient été refusés par McGill en raison de leurs notes insuffisantes. D’autres étaient des Juifs rejetés par l’université à cause des quotas en vigueur.
Un jour, ce sympathique repaire de médiocres vit débarquer un jeune professeur de littérature anglaise du nom de Theo Hall. On était alors à l’automne 1952, plus ou moins cinq ans après son mariage avec Miriam Peltier. Theo, engagé pour diriger le département de littérature anglaise, hérita d’enseignants du secondaire à la retraite, de ménagères de classe moyenne entichées de poésie et de vieux diplômés qui écrivaient leur autobiographie. Il aurait pu trouver un meilleur poste dans une grande université américaine. Il aurait pu rester au Magdalen College, à Oxford, et devenir fellow. Theo, cependant, avait la foi. Trois cents ans avant lui, les jésuites avaient pagayé jusqu’à Hochelaga et opposé leurs bibles aux tomahawks des Iroquois et des Sioux. Depuis, Hochelaga était devenu Montréal. Les païens avaient été boutés dehors et les chrétiens assuraient la permanence. Theo était de la même étoffe que ces intrépides jésuites. Armé des œuvres de Wilson, de Trilling et de Leavis, il comptait arracher Montréal à l’emprise des philistins.
C’était un homme de haute taille au regard las et à la toute petite bouche. Son sourire pâle et condescendant était celui d’un novice chargé de faire visiter Saint-Pierre à un groupe de paysans. Il aurait aimé être poète, mais, peu enclin à s’apitoyer sur ses limites, il n’enviait pas la réussite de ceux qui y étaient parvenus. Ayant choisi l’autre voie, il prononçait le mot art tel un homme en prière. Son espoir était de refonder le département de littérature anglaise sur des assises plus rationnelles et de créer une revue qui publierait ce que la littérature et la critique canadiennes avaient de mieux à offrir. Theo s’attaqua d’abord à la bibliothèque du collège. Au terme d’un mois consacré à l’étude des catalogues, il commanda sept cents nouveaux titres. Il révisa la liste des cours de littérature anglaise et, à la fin de la première année universitaire, il avait réussi à se débarrasser d’un grand nombre de dinosaures, qu’il avait remplacés par de jeunes et brillants enseignants de son choix.
Les déceptions ne manquèrent pas. Dans les cercles universitaires canadiens, Direction fit peu de convertis et n’inspira pas grand monde. Malgré quantité de soumissions, aucun talent percutant n’émergea. Après le troisième numéro, la revue revit son tirage à la baisse. De ses sept cents exemplaires, environ deux cents étaient écoulés aux États-Unis, une centaine en Angleterre et le reste au Canada. L’ambassade de Russie en prit trois. Mais les malins donnèrent vite à la revue le surnom de No Direction. Les étudiants de Theo le déçurent aussi. Aux examens, la plupart s’en tiraient plutôt bien, mais Theo avait un besoin presque maladif de s’entourer de disciples et de découvrir de grands esprits. Chaque fois qu’il tombait sur un étudiant doté d’une intelligence supérieure à la moyenne, il s’emballait. Il invitait chez lui ces prodiges qui, l’un après l’autre, se révélaient d’une grande banalité. Ses espoirs déçus, il s’en prenait avec cruauté à ces talents en puissance. Sujet aux diverses formes d’exaspération mentale dont souffrent la plupart des réformateurs, il avait tendance à voir, dans la vulgarité des esprits médiocres, un affront personnel. Il était social-démocrate. Devant toutes les formes de divertissement conçues à l’intention des masses, il s’étouffait et serrait les poings. Il avait du mal à supporter la société, en somme.
Miriam faisait de son mieux pour l’aider. Quand il était déprimé, elle le dorlotait ; quand son enthousiasme fiévreux était à son paroxysme, elle s’efforçait de le faire redescendre sur terre. Elle l’adorait pour ses emportements et l’épaulait dans sa lutte contre le sectarisme sans une plainte et sans arrière-pensée, mais elle croyait davantage en lui que dans les causes qu’il défendait. Si, dans leur cercle d’amis, quelqu’un disait voir dans le mariage une institution vouée à l’échec, on rétorquait invariablement : « Et que faites-vous des Hall ? »
En cet après-midi de la première semaine de novembre, Theo Hall rentra du collège plus tôt que d’habitude. Il lança sa serviette sur le canapé et sourit d’un air juvénile.
« J’ai invité quelqu’un pour l’apéro.
— Aïe, c’est reparti. »
Ils s’embrassèrent machinalement.
« Tu as l’air crevé. Dure journée ?
— Bof. »
Elle sourit d’un air serviable. Theo se laissa choir sur le canapé et ferma les yeux. Parfois, quand elle lui souriait de cette façon, il se sentait complètement inepte. Depuis quelques mois, leurs moments d’intimité se caractérisaient par une sorte de pauvreté. Elle semblait s’ennuyer, ses enthousiasmes d...