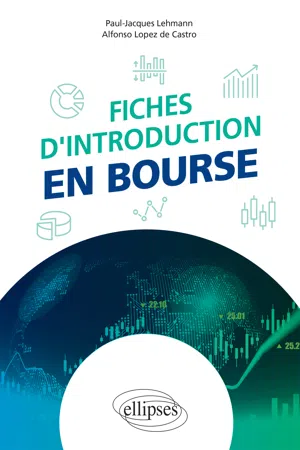![]()
Fiche 1
La Bourse, institution de financement parmi d’autres
À partir du moment où, les économies se développent, la monnaie se substitue au troc, des besoins de financement se manifestent en raison des délais que nécessitent les opérations de production. Mais, rapidement, le financement monétaire se révèle insuffisant dans la mesure où la thésaurisation (épargne non rémunérée) ne satisfait plus les agents économiques qui réclament un revenu pour leurs économies, à l’origine de la création des marchés financiers et de nouveaux circuits de financement.
I. Le financement monétaire de l’économie
A. La monnaie, condition du fonctionnement d’une économie développée
La monnaie est une partie intégrante de l’économie. Elle permet de faire le lien entre la perception des recettes et le paiement des dépenses en raison des décalages qui existent à court terme. En effet :
– les ménages reçoivent leurs revenus de façon discontinue tandis qu’ils effectuent leurs dépenses de façon continue. Ils disposent donc, en début de période, d’un excédent de monnaie qu’ils thésaurisent et qui diminue régulièrement jusqu’à devenir nul en fin de période. Plus leurs revenus sont importants, plus leur thésaurisation l’est aussi. Inversement, plus la distribution des revenus est fréquente, moins les individus thésaurisent sur la période : par exemple, des salariés payés une fois par mois thésaurisent en moyenne davantage que des salariés payés une fois par semaine ;
– les entreprises doivent faire face à « un besoin en fonds de roulement », c’est-à-dire à un besoin de liquidités à court terme car elles paient leurs fournisseurs avant d’être payées par leurs clients ;
– les administrations publiques supportent des décalages de nature différente selon les périodes. Ainsi, en début d’année, l’État doit honorer ses dépenses sans avoir perçu d’impôts. Puis, à chaque fois que ceux-ci sont versés, il dispose d’un excédent monétaire qui diminue à mesure que de nouvelles dépenses sont assumées et qui se reconstitue quand de nouveaux impôts sont appelés.
De plus, à long terme, la monnaie permet de faire face aux besoins d’investissements puisque ceux réalisés par les entreprises (pour renouveler ou accroître leur outil de production), par les administrations (pour développer les services collectifs rendus et faire face aux déficits budgétaires et des comptes sociaux) et par les ménages (pour devenir propriétaires de leur logement) doivent être financés. Or, les résultats à court terme et à long terme s’additionnent : le besoin de financement à long terme aggrave la situation des agents qui supportent déjà un besoin à court terme et détériore celle d’agents qui dégagent une capacité à court terme. Le circuit monétaire permet aux agents éprouvant un besoin global de financement de trouver les fonds nécessaires auprès des agents bénéficiant d’une capacité globale.
B. Le circuit monétaire et le financement de l’économie
La capacité de financement se met au service du besoin de financement
Les ménages, pris dans leur ensemble, dégagent toujours une capacité de financement. De leur côté, les administrations et les entreprises supportent le plus souvent un besoin de financement. En règle générale, la capacité de financement des ménages permet de financer les besoins des administrations et des entreprises. Si la thésaurisation dégagée au niveau national ne suffit pas, le reste du monde (l’extérieur) apporte le complément. Dans le cas contraire, la capacité de financement excédentaire qui ne trouve pas de débouchés dans le pays est proposée à l’étranger.
Au niveau individuel, cependant, certains agents ont un comportement différent de celui du groupe auquel ils appartiennent. Ainsi, des ménages éprouvent parfois un besoin de financement s’ils rencontrent des difficultés exceptionnelles de trésorerie dues à des dépenses inattendues ou lorsqu’ils financent l’acquisition de leur logement. Inversement, dans quelques secteurs, des entreprises disposent en permanence d’une capacité de financement :
– à court terme, en raison d’un excédent en fonds de roulement (par exemple les compagnies d’assurance qui reçoivent des primes avant de verser les indemnités et les rentes ou les entreprises de la grande distribution qui règlent leurs fournisseurs à crédit alors qu’elles sont payées au comptant par leurs clients) ;
– à long terme parce que leurs investissements sont inférieurs à leur thésaurisation.
Cependant, le financement monétaire connaît des limites
D’abord, la thésaurisation n’est pas rémunérée. Cette situation, acceptable quand la capacité de financement est faible, ne l’est plus dès que son montant atteint un niveau tel que son rôle économique devient prépondérant pour le développement d’un pays. Les agents concernés exigent alors qu’un intérêt leur soit versé. Le financement par l’épargne, nécessitant l’existence de titres financiers, se substitue, alors, en grande partie, au financement par la seule thésaurisation.
De plus en plus, dans la plupart des pays, le financement par l’épargne a tendance à être effectué sur des marchés, même si des intermédiaires continuent à jouer un rôle essentiel dans le financement de l’économie. Ces organismes, créés dès qu’une épargne se manifeste afin d’assurer son développement et sa meilleure répartition possible, mettent à la disposition des agents économiques de nouveaux moyens de financement par les crédits qu’ils leur accordent.
II. De la thésaurisation à l’épargne
L’analyse de l’épargne est identique à celle de la thésaurisation à une différence fondamentale près : le surplus des ressources sur les emplois n’est pas conservé sous forme monétaire, mais donne lieu à un placement, rémunéré le plus souvent par un intérêt. En facilitant le transfert de l’excédent des agents à capacité de financement vers les agents à besoin de financement, l’épargne constitue l’une des sources essentielles de la croissance. En effet, elle permet le financement de l’un des deux facteurs de production (le capital). L’épargne est expliquée par des variables tant économiques que non économiques.
A. Les variables économiques explicatives de l’épargne
Si l’épargne constitue un concept facilement mesurable, les variables économiques qui l’expliquent ont toujours donné lieu à des controverses. D’une part, il est difficile de connaître l’influence de chaque variable prise isolément, d’autre part, il existe une opposition sur le sens de la causalité entre les différentes variables et l’épargne : par exemple, des variations du montant de l’épargne conduisent à des fluctuations du taux d’intérêt, mais des fluctuations du taux d’intérêt entraînent aussi des variations du montant de l’épargne.
Le taux d’intérêt
C’est uniquement par facilité de langage que l’on parle du taux d’intérêt car, dans la réalité, il en existe une multitude. Toutes les théories reconnaissent le rôle du taux d’intérêt sur l’épargne, mais ne lui accordent pas la même importance.
■ Le rôle empirique du taux d’intérêt
Le taux d’intérêt nominal, exprimé sus forme d’un pourcentage annuel, indique le rendement annuel d’un placement. Il correspond à la rémunération d’un service rendu et d’un risque assumé en contrepartie de la mise à disposition d’une somme d’argent pendant un certain temps. Le taux représente aussi le coût d’opportunité de la monnaie : plus il est élevé, plus une encaisse conservée de manière oisive (par exemple dans un but de précaution) entraîne un manque à gagner par rapport à un placement réalisé pour un montant identique.
■ Le rôle théorique du taux d’intérêt
Pour certains économistes, le taux d’intérêt est le prix de la renonciation à la consommation. Il conduit à l’équilibre entre l’épargne et l’investissement. En effet, l’épargne est une fonction croissante du taux d’intérêt (une hausse du taux rend les placements plus attractifs) et l’investissement est une fonction décroissante du taux d’intérêt (une hausse du taux rend plus onéreux les emprunts pour investir). Il existe donc un taux d’intérêt pour lequel le montant de l’épargne est égal au montant de l’investissement. Pour d’autres économistes, l...