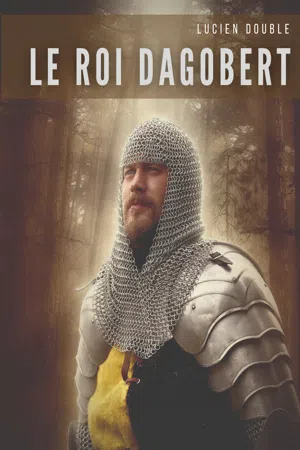![]()
IX
Le commerce à l'époque de Dagobert. Le marchand Samon, roi des Wendes.
Guerre de Dagobert contre Samon. Trahison des Austrasiens. Massacre des
Bulgares. 631. Dagobert forcé d'accepter les offres des Saxons. Intrigues en
Austrasie. L'Austrasie, séparée définitivement des États de Dagobert, est
remise à Sigebert. La France et l'Allemagne. 633.
L'Austrasie paraît domptée, l'armée est prête à de nouveaux combats, semble pleine d'enthousiasme, et Dagobert se prépare à continuer le cours de ses exploits en allant attaquer un nouveau peuple, les Wendes, que gouverne alors un marchand franc d'Austrasie, Samon, du pays de Soignies, en Hainaut.
Qu'ici l'on nous permette une digression nécessaire pour expliquer l'origine de cette guerre et l'élévation au trône du marchand Samon, car, bien qu'aux siècles mérovingiens nous soyons très véritablement au temps où les rois épousaient des bergères (et souvent pis que cela), il n'en est pas moins étrange de voir un simple commerçant ceindre la couronne royale. Nous allons d'abord donner un court aperçu du commerce, tel qu'il se pratiquait alors, et l'on comprendra facilement les causes qui amenèrent la haute fortune de Samon.
Le commerce florissant sous Brunehaut, déclinant sous Clotaire II, avait, nous l'avons dit, repris sous Dagobert une certaine animation ; il était même alors plus actif qu'il ne le fut sous les Carolingiens, dont l'inepte domination, l'esprit étroit, amenèrent la grande barbarie du moyen âge. Installés, non sur le Rhin, comme Charlemagne et ses successeurs, mais au centre de la Gaule, les rois mérovingiens avaient pris une teinte de civilisation, et le vir inluster Dagobert était peut-être beaucoup moins barbare que le César Maximien Hercule ou que l'Auguste Maximin Daïa. Le grand centre du monde, c'est alors Byzance ; les enfants de Mérovée ont pour l'héritier de Constantin cette même déférence instinctive qu'auront plus tard pour le successeur de saint
Pierre les fils hébétés de Charlemagne. Rome n'est rien alors ; à Constantinople, au contraire, fleurissent les arts de toute espèce. Dans ce coin du monde, pressée par les Barbares, s'est comme resserrée la civilisation antique.
Pendant les beaux jours de Brunehaut, des communications plus fréquentes s'étaient établies entre la Gaule et Byzance, et le règne fort et paisible de Dagobert avait favorisé ces relations commerciales ; les Grecs avaient repris le chemin de Marseille et d'Arles, établi des comptoirs dans les principales villes du littoral méditerranéen.
Mais, depuis quelques années, depuis l'extension de la puissance franque sur les peuplades germaines, un nouveau courant commercial s'était dessiné au nordest, encore bien faible, il est vrai, mais entièrement alimenté par des Francs, également avides d'or, de voyages et d'aventures. De nos jours, ce sont d'ordinaire les hommes de caractère paisible, de nature tranquille, qui embrassent la carrière mercantile ; jadis c'était différent. Il est vrai que le commerce du septième siècle ne ressemblait guerre à la pacifique industrie du temps actuel.
Suivons plutôt dans son long voyage vers l'Orient, vers le pays des riches tissus, des aromates précieux, une caravane de marchands francs.
Des portes antiques de Trêves ou de Cologne sort le long cortège des aventuriers ; point de chariots ni de voitures, bientôt toute route cessera, à peine si les chevaux et les mulets passeront dans les bois, dans les marais. Jusqu'au pays de Bavière, dans les duchés tributaires, la route est relativement aisée ; il a des tronçons de chemins dallés, quelques bourgades, quelques postes militaires. A Passau, à Ratisbonne on fait une dernière halte ; pour la dernière fois on dort en sûreté, et, le lendemain matin, suivant l'onde grise du Danube qui les mènera jusqu'aux lointains rivages de l'Euxin, nos voyageurs se lancent dans l'inconnu ; ils forment une longue colonne de cavaliers armés entourant quelques bêtes de somme. Les lances sont hautes, les francisques brillent ; graves, inquiets, les chefs précèdent, interrogent le pays. Lentement la caravane s'avance sans s'écarter du fleuve qui la guide ; la nuit les feux s'allument dans quelque clairière ; la moitié des hommes veille et prête l'oreille aux bruits sans nombre des grands bois. Au petit jour, dans le brouillard, alourdis sous leurs sayons humides, les Francs reprennent leur pénible voyagé ; à chaque instant il faut s'arrêter ; làbas, sur l'écueil qui domine le Danube, sur le rocher qui barre la vallée, dans le bois qui surplombe la route, veille le blende sauvage, l'esclave des Huns, trop craintif pour attaquer de vive force, mais assez avide pour tenter une surprise. Des troupes de bandits chassés des pays francs, des Saxons païens, révoltés contre leurs prêtres imposés, parcourent ces pays désolés. Chaque rocher, chaque tronc d'arbre peut cacher un ennemi.
Enfin les voilà passés ces défilés des marches pannoniennes ; à perte de vue s'étend l'immense plaine du bas Danube ; là, pas d'arbres, pas de gorges, pas de rocs propices aux embuscades, rien qu'un océan de grandes herbes ; la caravane est-elle en sûreté ? Non ; un jour, subitement, sur son passage, jaillira de cette herbe épaisse une horde de Sorabes errants.
Les Francs en ont triomphé ; maintenant, il leur faut traverser les grands marécages que forment au sud du bas Danube ses affluents débordés ; à chaque pas on s'embourbe, au loin flottent lourdement les brumes malsaines, les chevaux glissent, s'enfoncent dans ces herbes putréfiées, dans ce sol qui se dérobe. Malheur aux voyageurs surpris dans ces marais ; Francs, baissez vos lances, tirez de leurs gaines vos couteaux rouillés du voyage ; regardez : au fond de l'horizon, aussi loin que porte la vue, apercevez-vous ces points presque invisibles ? On dirait, se levant au bout de la plaine, un vol funèbre d'oiseaux de proie ; ils approchent : des ombres rapides se dessinent vaguement, puis grandissent dans les brouillards des marais : ce sont les cavaliers avares, les vautours du Danube, hurlant sur leurs gris étalons, grimaçant de désir et de cupidité.
Ceux-ci ne sont qu'une bande, on en vient encore à bout ; la large épée et la francisque les fauchent, et leurs lances de fer friable se cassent contre la chemise de mailles que portent les voyageurs francs.
Mais le pays devient de jour en jour plus dangereux ; les chefs des caravanes envoient en avant quelques fidèles cavaliers habitués à ces parages. Ces éclaireurs s'avancent avec précaution, regardent loin devant eux, l'éperon sur le flanc du cheval, prêts à tourner bride s'ils entrevoient seulement ce qu'ils redoutent et ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, le voici.
Sur une colline isolée, comme égarée dans la monotonie des plaines, brille un trône d'or, barbare et massif ouvrage ; sur ce trône élevé un homme est assis ; autour de lui flottent, agitées par le vent, des crinières ou des queues de cheval teintes en rouge. Rangés par cercles immenses autour de la colline, montés sur de maigres chevaux, cent mille cavaliers sont réunis : on dirait une assemblée de démons ; noirs, sales, la face hideusement tailladée de cicatrices, vêtus les uns de peaux de rats mal cousues, les autres de loques de soie, de débris de tentures de pourpre, restes informes de quelque pillage, ils portent des armes bizarres, des lances en forme de tridents, des mâchoires d'ours sauvages, garnies encore de leurs dents aiguës, des fragments d'épées byzantines ou de scramasaxes francs, taillés en scie, emmanchés dans des branches d'arbre ; des quartiers de viande pendent sous leurs selles entre leurs cuisses nues dégoutantes de sang. Ils tournent au galop autour du trône d'or, s'agitant sur leurs selles, roulant du col à la queue de leurs coursiers, entrechoquant leurs armes, frappant avec frénésie sur des peaux tendues au-dessus de cercles de bois. A ce bruit sans doute bien connu, accourent des bandes de grands chiens sauvages au poil rude, à l'œil sanglant. Bientôt, du trône qui reste vide, abandonné, gardé seulement par la terreur que le maître inspire, descend le chef impassible ; il s'élance sur un étalon qui l'attend entravé au pied de la colline, il saute en selle, et, au milieu d'un redoublement de cris, de chocs d'armes, de roulements des peaux sonores, de hennissements, d'aboiements, hurlant, bondissant, dévorant l'espace, hommes, chevaux et chiens se lancent à travers l'immensité des plaines, foudre vivante, aussi terrible que la foudre céleste ; ce sont les fils d'Attila qui s'en vont en guerre par le monde26.
Enfin, tous ces dangers sont passés ; les Francs les ont surmontés ou les ont évités ; ils se dirigent vers le sud ; voici les montagnes de Thrace, les cimes neigeuses des Balkans, et dans les gorges étroites, aux flancs âpres des pics, encore des bandits.
Mais ce ne sont que des Grecs : les hommes d'Austrasie ne les craignent guère ; d'ailleurs c'est la dernière épreuve. A leurs yeux éblouis brillent déjà dans le lointain les dômes étincelants de la ville impériale, à leurs pieds s'étend la mer bleue de la Propontide. Une dernière halte, on fourbit les armes, on polit les casques, on rajuste les sayons usés et, dans sa parure de guerre, sous les arcs de marbre des Césars, sous les portiques dorés des empereurs, devant les parvis émaillés des églises byzantines, la lance haute et la hache au poing, défile fière et grave notre bande aventurière.
On comprend qu'une telle manière de faire le commerce trempait vigoureusement les âmes, et l'on s'étonnera moins de la haute fortune de Samon.
En l'an 623, une fois que ce Samon traversait à la tête d'une troupe de marchands francs le pays des Wendes, ceux-ci, alors révoltés contre les Huns, lui avaient demandé secours contre leurs maîtres abhorrés, qui venaient chaque hiver ravir à leurs malheureux vassaux leurs bestiaux et leurs femmes, pertes qui leur étaient également douloureuses. Samon avait accepté le commandement que lui offraient les Wendes ; habitué à la guerre, comme tous les Francs, il avait discipliné ses sauvages soldats, et bientôt, grâce à la supériorité stratégique des civilisés, les hordes des Huns avaient été mises en déroute. Reconnaissants, les Wendes supplièrent Samon d'être leur roi. Samon ne rit aucune difficulté, et pour montrer qu'il adoptait de cour les mœurs de ses nouveaux sujets, il épousa le même jour douze femmes de leur race. Dès lors, affermi sur le trône, sûr de l'affection de son peuple, il chercha à fortifier sa situation politique à l'extérieur. Son premier mouvement fut de se mettre sous la protection de Dagobert, son souverain naturel. Le roi des Francs accueillit fort bien les ouvertures du roi improvisé des Wendes, et, pendant quelques années, tout alla pour le mieux. Le commerce, devenu plus facile pour les sujets de Dagobert, maintenant que les vastes régions occupées par les Wendes obéissaient à un de ses vassaux, fit de notables progrès. Malheureusement, au bout de quelques années, les Wendes, devenus plus turbulents et pour qui c'était une violente tentation que de voir perpétuellement défiler sous leurs yeux les caravanes des marchands austrasiens qui portaient à Constantinople des pelleteries rares, de l'ambre et surtout de jeunes eunuques27, et qui revenaient ensuite chargés d'or et d'épices, les Wendes, disions-nous, perdirent patience et pillèrent quelques convois ; après en avoir préalablement assassiné les maîtres. Dagobert, irrité à juste titre, envoya auprès de Samon le comte Sichaire, chargé d'exiger une réparation.
Samon se sentait dans son tort ; il chercha tous les prétextes possibles pour ne pas recevoir l'ambassadeur ; enfin, Sichaire, qui d'ailleurs ne paraît pas avoir été d'un caractère bien patient, finit par se déguiser en blende et, un beau jour, arrêta brusquement le roi au passage. Il le menaça de la colère de Dagobert et lui rappela durement qu'il n'était que le vassal des Francs. Samon répondit avec assez de calme : Notre terre est à Dagobert et nous sommes ses hommes, mais à condition qu'il nous témoignera de la bienveillance et de l'amitié. — Il est impossible, répliqua Sichaire, que des chrétiens comme nous soient les amis de chiens comme vous. — Alors, reprit Samon, si vous êtes les serviteurs de Dieu, nous, nous sommes ses chiens et, comme vous l'offensez continuellement, il nous permettra de vous mordre.
Après cet échange de communications diplomatiques, du reste fort dans le goût du temps, la guerre était inévitable. Il était naturel que les contingents austrasiens, limitrophes des Wendes, fussent chargés de l'expédition. Mais c'était justement l'époque où Dagobert commençait ses réformes fiscales et forçait les grands chefs austrasiens à se soumettre, eux et leurs leudes, au paiement de l'impôt. L'armée franque s'en alla donc en guerre, animée des plus mauvaises dispositions contre Dagobert. D'ailleurs, les Wendes, pillés depuis un temps immémorial par les Huns, ne pouvaient fournir qu'un maigre butin aux envahisseurs. Deux corps de troupes devaient seconder la principale armée composée des forces austrasiennes ; l'un, qui devait opérer au sud du pays rende, était fourni par les Lombards, qui, bien que dispensés du tribut par Clotaire II, étaient restés soumis à la suzeraineté franque ; l'autre, qui devait agir sur les frontières nord-ouest de Samon, était formé de bandes levées chez les tributaires de l'Austrasie, Alemans, Bavarois, Franconiens, et placées sous le commandement suprême du duc franc Chrodobert. Chrodobert et les Lombards combattirent avec énergie, remportèrent des victoires et firent de nombreux prisonniers. Mais la conduite des Austrasiens fut toute différente. Arrivés, grâce aux succès de leurs alliés, sans rencontrer d'obstacles, jusqu'aux palissades de Wogastiburg, où Samon s'était renfermé avec l'élite des guerriers vendes, ils se laissèrent battre après trois jours de siège, et s'en retournèrent en désordre, entièrement débandés, jusqu'au cœur de l'Austrasie. Ce ne fut pas tant, avoue Frédégaire, la valeur des Wendes qui les rendit victorieux que l'abattement des Austrasiens qui se voyaient dépouillés par Dagobert — c'est-à-dire réduits à payer régulièrement l'impôt.
Cette lâcheté eut des suites funestes ; les Wendes, reprenant courage, envahirent la Thuringe, la Franconie et vinrent même insulter les villes d'Austrasie. Dagobert fut atterré ; un autre danger le menaçait encore ; quelque temps auparavant, neuf mille Bulgares, chassés par les Huns de la Pannonie, étaient venus se réfugier dans le pays des Bavarois ; enhardis par les succès des \Vendes, très probablement d'accord avec eux, ils allaient se soulever, quand Dagobert, prévenu, les fit exterminer en une nuit. Cette mesure, assurément
cruelle, lui est vivement reprochée par les historiens ; peut-être n'a-t-on pas assez tenu compte de la situation dangereuse et presque désespérée où l'avait placé la trahison des Austrasiens. Déjà cantonnés sur le sol franc, ces Bulgares pouvaient donner la main aux envahisseurs \vendes ; il fallait nécessairement s'en défaire. Quelques centaines de ces Bulgares, qui parvinrent à s'échapper, trouvèrent d'ailleurs un asile auprès des Wendes, peu hospitaliers de leur nature, ce qui paraîtrait indiquer qu'il y avait accord entre eux.
C'est ce moment, alors que l'étranger franchissait leurs frontières, pillait leurs tributaires, c'est ce moment que les leudes austrasiens choisirent pour tenter le soulèvement que nous avons relaté au chapitre précédent. On a vu comment Dagobert le réprima, et nous allons reprendre à partir de l'apaisement de cette révolte le cours de notre récit.
Dagobert est donc venu à bout du soulèvement austrasien ; il s'apprête maintenant à attaquer les Wendes. Mais les guerres ne pouvaient alors durer bien longtemps sans interruption. Chaque soldat apportait ses vivres, et, au bout de quelques semaines, vivres et ressources de tout genre se trouvaient épuisés. Les Aquitains, les Neustriens et les Burgondes, qui avaient suivi Dagobert, d'abord remplis d'ardeur, s'étaient mis à réfléchir ; ils représentèrent au roi qu'ils n'avaient plus de quoi se nourrir, que le pays des Wendes était bien loin de leurs foyers ; beaucoup, enrichis par le sac de Metz, et effrayés par la perspective d'une longue campagne dans une contrée perdue, s'en retournèrent chez eux par petites bandes. Pour les retenir il aurait fallu leur donner une solde, et Dagobert était sans argent ; les frais qu'avait occasionnés nécessairement l'entretien des fidèles et des gardes palatins pendant la rébellion de l'Austrasie avaient épuisé le trésor. De plus, cette rébellion même et l'opposition grandissante du clergé avaient réduit à rien la rentrée des nouveaux impôts.
Ce fut dans ces difficiles circonstances que se présenta devant le roi une ambassade des Saxons vassaux, qui venaient offrir de se charger de la guerre contre les Wendes, de les repousser à leurs frais et à leurs risques loin des frontières, pourvu que Dagobert déchargent la Saxe du tribut de cinq cents vaches qu'elle devait payer chaque année à la nation franque. On a beaucoup blâmé Dagobert d'avoir accepté cette offre ; mais, que pouvait-il faire : sans argent, avec une armée qui semblait fondre à vue d'œil, et, derrière lui, un peuple rebelle, vaincu mais frémissant, devait-il se lancer dans l'inconnu d'une guerre ? Le roi était bien véritablement contraint par les périls de sa situation d'accepter, quoique son cœur en saignât, la proposition des envoyés saxons. Il leur remit donc leur tribut en échange du serment solennel, qu'ils prononcèrent sur leurs épées, de défendre désormais les frontières franques contre toute invasion ; puis, il s'en retourna tristement à Clichy, peu confiant sans doute en la foi saxonne.
En effet, les Saxons, dès' qu'il fut éloigné, se refusèrent effrontément à remplir les obligations qu'ils avaient contractées. Les Wendes, de plus belle, recommencèrent leurs incursions, et les Austrasiens refusèrent de rien faire pour les arrêter ; le sentiment de l'honneur semblait être éteint chez ces tristes enfants de la noble race franque ; ils ne se révoltaient même plus, honte ! ils se faisaient battre exprès.
Dagobert en perdit le sommeil ; un immense découragement s'empara de son âme ; il finit par comprendre, douloureuse conviction, qu'il y avait là deux peuples différents et que ce nom unique de Francs n'était plus qu'un vain mot. Deux nations s'étaient formées, l'une civilisée, parlant latin ou plutôt roman, l'autre restée barbare, ne connaissant que le rude et vieil idiome germanique, jalouse, envieuse de la civilisation du Midi, impatiente d'avoir à elle seule ses lois, ses haines et ses guerres. Dagobert renonça à maintenir l'accord entre ces deux races hostiles ; sans doute, pendant ses insomnies, vit-il se lever dans la brume de l'avenir, comme de vagues fantômes, l'image ...