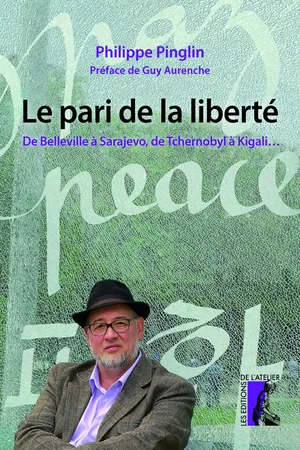![]()
Introduction
À tous ceux que les médias ignorent et qui sèment nos libertés.
Ils sont paysans, syndicalistes, médecins, présidents, danseurs... à partager un même but : la liberté. Les hommes et les femmes dont l’engagement est raconté dans cet ouvrage n’ont rien d’exceptionnel. Seuls leurs combats collectifs le sont. Ils osent s’indigner devant l’injustice et transformer leur impatience en action. Ils recherchent avant tout l’amélioration des conditions d’existence de leurs concitoyens et la réalisation d’une « humanité » de paix, de justice et de tolérance. Ils refusent l’enfermement dans des discours idéologiques, bien que leur démarche soit emprunte d’une vision de la société. Leur seul langage qui vaille est celui de la preuve. C’est simple et exigeant.
Euloge, un ami béninois, me dit un jour : « La liberté, c’est aussi simple que l’igname en flocon. » Il faisait référence à l’entreprise d’igname séchée, créée par Boniface dans les faubourgs de Cotonou au Bénin. Une fois son petit prêt en poche, il transforme une vieille machine à laver le linge en séchoir, il achète un manomètre et fait imprimer des emballages carton avec ce slogan : « L’igname en flocon libère la femme. » Le jeune Boniface, tout juste sorti de ses études de géographe, apporte avec efficacité une réponse au travail incessant des femmes africaines.
Ces petites initiatives participent au mieux-être tout en ouvrant de nouveaux espaces de liberté. Mises bout à bout, elles fertilisent le petit lopin de terre qui est autour de chacun de nous, évitant ainsi qu’il ne se transforme en champ de bataille, en champ de mines ou en cour d’exécution.
Au fil des sondages, la France déprime et les Français consomment toujours autant d’anxiolytiques. Pourtant nous vivons dans un beau pays, nous bénéficions d’un socle social envié de tous et nos solidarités produisent encore de belles histoires. Alors pourquoi ? Un début de réponse pourrait être celle-ci : les « semeurs de doute » occupent un large espace de la parole publique et les « passeurs d’espoir et de liberté » restent discrets et bien trop rares. Et pourquoi en serait-il autrement, tant que les rédactions de nos grands médias choisiront de privilégier « le sensationnel » et non « le pédagogique » de l’information, nous imposant des raccourcis aussi destructeurs que démobilisateurs du type : « Un Français sur deux se dit pauvre ou en passe de le devenir{3}. »
Cette posture pèse lourdement sur l’engagement. Canaliser son énergie pour l’intérêt général devient une prouesse, un acte d’héroïsme. Par contrecoup, cela retarde le traitement des véritables problèmes, comme l’éradication de la pauvreté pour huit millions de Français qui, eux, ont réellement besoin de sentir une nation mobilisée à leurs côtés.
Le parti pris de ce livre est justement de prendre le contre-pied des pessimistes et des semeurs de haine, de parler du verre à moitié plein, d’honorer ceux qui cherchent à vivre ensemble sur des territoires apaisés, ceux qui mettent leur énergie pour le droit de chacun à vivre dignement. Ceux qui transforment la plainte en action et l’individualisme en confiance.
Une idée fixe m’a accompagné durant la longue période d’écriture de ce livre : présenter des « histoires d’engagement » sans besoin de les habiller d’analyses et de conclusions forcément imparables, afin que la seule évocation du témoignage questionne et donne des envies aux lecteurs. Envie de se lancer dans des projets jusque-là ajournés, envie de témoigner et d’écrire, envie de réfléchir à ses propres solidarités... Pourquoi ?
Je souhaite m’adresser en priorité aux jeunes générations dont l’engagement syndical, associatif ou politique n’est pas une évidence et qui en ont assez d’entendre de vieux militants leur dire ce qu’il faut faire. Mon pari à travers ce livre est de réveiller des envies de solidarités collectives par la simple force du témoignage, sans discours idéologiques dégénérant souvent en leçon de morale. La générosité et la conscience de l’engagement traversent toutes les générations. Elles ne demandent qu’à être stimulées.
Quand éclatent la guerre dans les Balkans dans les années 1990 puis celle dans la région des Grands Lacs en 1996, faisant suite au génocide rwandais de 1994, quand la catastrophe de Tchernobyl s’invite en 1986 au cœur de l’implosion de l’Union soviétique, des hommes « ordinaires » et des femmes « normales » mobilisent leur énergie, leur courage et leur inventivité. Pour certains, l’événement provoque leur action, pour d’autres, leur engagement de longue date prend soudainement tout son sens au regard de l’évolution du contexte.
Ces hommes et ces femmes dépassent les haines, contournent les entraves bureaucratiques, résistent aux pressions et à toutes les formes de violences. Ils risquent la confiance, là où elle est improbable. Ils organisent la solidarité, là où elle n’existe plus. Ils osent l’action collective, là où elle est pourchassée. Leurs actions, bien que locales, participent à l’élargissement des droits et des libertés de tous, à la construction européenne et aux prémices d’une nouvelle gouvernance mondiale.
En quelque sorte, ils nous invitent à les rejoindre par l’action pour que nos résultats s’additionnent, pour que nos voix s’entendent de Paris à Bruxelles, jusqu’à New York. Ils démontrent que les moyens de chacun, mis bout à bout, peuvent apporter de grands changements.
J’ai la chance d’être un témoin privilégié des grands événements qui secouent le monde depuis une trentaine d’années. Éveillé par la CFDT{4}, mon engagement international se concrétise au sein du CCFD{5}. Mon travail de chargé de mission consistait à repérer les personnes engagées sur des projets répondant à des enjeux forts, comme le dialogue interethnique dans les régions en conflits, des projets favorisant des dynamiques collectives et d’émancipation des individus, là où les populations ne connaissent que la privation de leurs droits élémentaires, la destruction de leurs biens... Ce partenariat couvre la période 1993-2004 et a fait l’objet de nombreux déplacements nécessaires pour installer une relation de confiance avec les acteurs et les accompagner dans une démarche de développement qu’ils découvraient notamment dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO). La qualité du partenariat, dont dépendent ses résultats, est directement liée à celle des hommes et à la confiance qu’ils sont capables d’instaurer entre eux. Il me fallait ensuite, convaincre le CCFD et les bailleurs publics d’apporter les moyens pour soutenir leurs actions. Au-delà des soutiens financiers ou matériels, c’est une réflexion et une stratégie communes qui s’établissent pour peser sur les politiques publiques, pour s’allier au sein de réseaux afin d’organiser le lobbying auprès des institutions régionales et internationales. Ce dialogue aide également nos partenaires à se positionner comme interlocuteurs de leurs pouvoirs publics.
Nous finissions par devenir des compagnons de route, partageant des convictions communes et des engagements communs. Certains, comme Zoran en Croatie, apprendront le français pour la qualité de nos échanges. Les défis des uns devenaient au fil des ans les défis des autres. C’est le vrai sens de la solidarité internationale.
Je vous propose à présent de vous laisser porter par des histoires de vies, à la découverte de la Lituanie en quête d’indépendance, des terres contaminées d’Ukraine et de la renaissance de son agriculture, de Sarajevo assiégée et des résistances s’organisant sur les Balkans, de la forêt équatoriale dans la région des Grands Lacs qui abrite de nombreuses rébellions, mais aussi des populations qui osent la réconciliation. Et par Belleville, lieu que connaissent bien les militants de la CFDT. Je sais à présent que vous êtes en bonne compagnie.
Les scènes se passent auprès de populations qui vivent de grands drames. Mais l’espoir est toujours présent. Leurs combats ne sont pas « d’un autre temps ». Ils sont totalement d’actualité, nous ouvrant des champs de réflexions et d’actions pour affronter nos épreuves actuelles et à venir.
Notre civilisation a prouvé qu’elle savait faire de grands pas. Marchons dans les traces de celles et ceux qui éveillent nos solidarités, qui donnent un nouvel élan à la justice sociale et instaurent une gouvernance mondiale protectrice des peuples. Ainsi, nous décidons que « l’avenir » reste une belle aventure pour les générations appelées à nous succéder en leur offrant la possibilité de devenir à leur tour des « passeurs de liberté ».
![]()
La Lituanie
![]()
Chapitre 1
Le lilliputien à l’assaut du géant russe
À Claude et Yolande Caillère, accueillants comme la famille Andziulis,
ouverts autant à la vie de leur quartier que sur le monde.
Je vous dois de belles rencontres.
Vytautas et Biruté aiment leur pays, la Lituanie, ses 65 000 km2 de plaines, de forêts et de lacs qui le recouvrent.
Bien que lilliputien à côté du géant russe, le peuple lituanien oppose une résistance de tous les instants à l’occupant, sans jamais s’émouvoir d’être accolé à un pays trois cents fois plus grand et immensément plus puissant. La libération du pays en 1944 installe l’Armée rouge qui se heurte à une résistance de 100 000 hommes. Parmi eux, 30 000 sont tués, dont Jonas, ami de Vytautas, et de nombreux autres envoyés au Goulag{6}. En dix ans, la Lituanie perd un tiers de sa population. Pour l’occupant russe, il s’agit de casser cette résistance qui s’installe durablement dans le pays.
En déclarant son indépendance en mars 1990, ce « lopin de terre » se trouve au cœur du déclenchement du processus de démantèlement de l’Union soviétique. En mai 1992, la reconnaissance internationale de la Lituanie est confirmée par la visite officielle de François Mitterrand, premier chef d’État à signer un traité avec les autorités d’une ancienne république soviétique. En juin de la même année, plus de cent États ont reconnu la Lituanie. L’Empire soviétique est terrassé par l’une de ses plus petites Républiques.
Vytautas et sa femme Biruté participent à cet événement historique, de 1978 à 1991. Ensemble, ils mènent pendant treize ans une lutte clandestine contre la toute-puissance de Moscou afin d’engager la Lituanie sur la voie de son indépendance. Ils m’entretiennent de cette belle aventure lors de nos échanges.
Je les rencontre en 1995. Je sais que leur expérience durant les années d’occupation soviétique en fait de fins connaisseurs des réalités lituaniennes, à même de m’aider à structurer des partenariats avec ce pays. Pour aller à leur rencontre, je traverse à pied sec le fleuve Niémen, transformé en terrain de jeu par le froid. Je me fraye un chemin entre les enfants découvrant les plaisirs de la glisse et les pêcheurs facilement reconnaissables avec leur matériel sous un bras, le vilebrequin pour percer la glace sous l’autre. Ils cherchent le meilleur emplacement avec la maladresse d’un pingouin qui aurait enfilé deux combinaisons de cosmonaute. Je suis à quelques kilomètres du centre de Kaunas, une ville de province transformée entre les deux guerres mondiales en capitale provisoire du pays, Vilnius et sa région étant annexées par la Pologne. Je me dirige vers le quartier de Saliai, « le Soleil », à la recherche de la famille Andziulis.
Le souterrain de la résistance
Vytautas, grand, mince, le regard clair et perçant, le visage buriné par le climat et l’âge, m’attend devant la demeure familiale, sur un chemin de terre qui serpente autour d’un étang, en compagnie de sa femme Biruté dont le large sourire accentue un visage naturellement pétillant. Ils m’installent bien au chaud dans le salon devant un bol de café et une assiette de gâteaux secs et commencent le récit de treize années de leur vie, passées à la reconquête de leur liberté.
Le 16 octobre 1978, ils sont rivés à leur poste de radio. Ce jour-là, presque tous les Lituaniens et les Polonais sont unis par les ondes. La tension est à son comble lorsqu’ils apprennent qu’une fumée blanche s’échappe de la chapelle Sixtine à Rome. En fin de soirée, c’est officiel : le Polonais Karol Wojtyla devient le nouveau pape Jean-Paul II{7}, premier pape slave dans l’histoire du Vatican.
Encouragé par cette élection, Vytautas commence par creuser son jardin. Ils sont nombreux dans ces deux pays à considérer cet événement comme une occasion d’entrer en résistance contre la politique soviétique. Beaucoup pensent en effet qu’un pape slave, totalement acquis à l’indépendance des pays satellites de l’URSS et au rapprochement avec l’Union européenne, peut contribuer à braquer les projecteurs sur cette région, et qu’il est donc temps de prendre des initiatives.
Vytautas est imprimeur dans un grand atelier de Kaunas où il a débuté comme apprenti. Professionnel consciencieux, il est promu responsable de l’imprimerie dans les années 1970 avec l’accord des agents du KGB{8}. Un pape polonais d’un côté, une promotion professionnelle de l’autre, plus rien ne peut empêcher notre ami de creuser, pelleter, brouetter comme un forcené. C’est décidé, le projet prendra vie sous la maison. Un souterrain d’une dizaine de mètres part de la serre familiale, débouchant sur deux pièces de sept à huit mètres carrés. Soucieux d’être plus concret dans ses explications, il me propose de le suivre pour visiter les installations clandestines.
La serre est vide, à l’exception de quelques ossements humains et de vieilles tiges desséchées. Vytautas m’invite à le suivre jusqu’au centre de la serre où se trouve un bac en béton servant de réservoir pour l’arrosage. Il fait glisser le bac sur lui-même grâce à un système de poulie dévoilant quelques marches qui s’évanouissent dans l’obscurité. Malgré les ans et le manque de lumière, Vytautas descend avec assurance. Il a passé tant d’heures et tant de nuits à modeler cet espace qu’il s’y faufile aussi bien qu’un académicien dans le dictionnaire. Une fois l’unique ampoule allumée, il m’invite à le rejoindre par l’étroite galerie en béton menant à la première pièce. Des casiers en bois accrochés aux murs contiennent des milliers de lettres de plomb et de cales d’acier classées et ordonnées avec la précision d’un conservateur en chef des hypothèques. C’est dans ce réduit qu’il composait, récemment encore, des textes contre l’occupant. Dans le second espace, qu’il nomme « mon atelier », je vois Vytautas changer de comportement. Il se redresse malgré le poids des ans. Il semble plus grand. Il est fier de sa rotative qu’il assembla pièce après pièce pour devenir l’outil de son combat. Sa fierté me fait penser aux mineurs des corons du bassin minier de Béthune, me racontant avec dignité, avec noblesse même, l’attachement à leur métier, autour d’un bol de café. Certains délaissaient, le temps d’une discussion, l’oxygène censé soulager leur silicose.
La rotative...