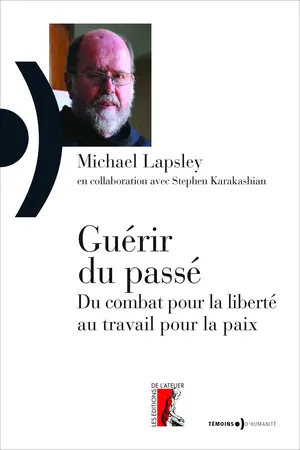![]() Troisième partie
Troisième partie
Le temps du travail de guérison![]()
9
Retour en Afrique du Sud
Se forger une nouvelle identité
Je dis souvent que mon itinéraire de vie reflète celui de la nation et ce fut particulièrement vrai lors de mon attentat. Alors que j'étais couvert de sang et recouvert de bandages sur mon lit d'hôpital à Harare, un événement se produisit six jours plus tard à plus de deux mille kilomètres de là, au Cap, qui changea le cours de l'histoire. Dans cette ville, le 4 mai 1990, le gouvernement d'Afrique du Sud et l'ANC signèrent à Groote Schuur, la résidence officielle du président, un document qui allait marquer le début des négociations qui devaient finalement déboucher sur la mise en place d'un pays démocratique, pour lequel nous avions combattu si longtemps. Pour moi et pour l'Afrique du Sud s'ouvrait un long chemin de guérison.
Parfois les gens me demandent dans quelle mesure l'attentat m'a changé, et ils apportent leur propre réponse. La plupart disent qu'ils me trouvent plus paisible et plus affable, moins polémique et plus accommodant. S'il est vrai que les autres ont souvent une meilleure perception de nous que nous-mêmes, j'ai parfois envie de dire : « En fait, je suis toujours la même personne. » Je ne trouve pas que le changement soit aussi extraordinaire que certains le disent. Certes, il est indéniable que j'ai subi des mutilations, qu'il s'en est fallu d'un cheveu que je ne trouve la mort et que je dois vivre avec un sérieux handicap. Lorsque vous avez vécu ce genre d'expérience, rien n'est plus jamais comme avant. Se laisser aller à l'amertume, c'est s'enfoncer dans la haine et la colère. Je ne peux nier que si je n'avais pas été victime de cet attentat, ma vie aurait été infiniment plus facile à certains égards. Toutefois, si je suis toujours la même personne qu'auparavant, mon travail de guérison des mémoires m'a enrichi d'une façon extraordinaire et, sans l'attentat, je ne pourrais pas en parler.
Il y a des raisons pour lesquelles d'autres me percevaient comme quelqu'un d'un peu agressif. Pour survivre à la lutte pour la libération, il faut s'endurcir. Dans la mesure où je suis blanc, certains autres Blancs me percevaient comme un traître à ma race et ils m'en voulaient car ils voyaient dans mes choix un jugement sur ceux qu'ils étaient incapables de poser eux-mêmes. J'ai dû supporter leur animosité et les propos malveillants que certains d'entre eux ont tenus à mon égard. Parfois aussi, des Noirs s'interrogeaient sur l'authenticité de mes convictions. En d'autres termes, je devais parfois faire mes preuves auprès des personnes mêmes avec lesquelles je risquais ma vie et pour lesquelles, dans certains cas, j'éprouvais de l'amour et de la sympathie.
Il faut se forger une carapace pour faire face aux attaques et aux coups tous azimuts. Je pense que j'ai dû ranger au placard certains de mes sentiments ; en quelque sorte, à cette époque, ma vie s'apparentait à un voyage « de tête » alors que depuis l'attentat elle tient davantage du voyage « de cœur », avec pour objectif de retrouver la douceur dont j'ai dû me départir. En d'autres termes, j'ai dû m'endurcir pour survivre. Che Guevara a dit un jour que les révolutionnaires devaient apprendre à résister sans renoncer à leur sensibilité ; c'est une remarque à laquelle je souscris. Je suis donc convaincu que je me suis adouci depuis mon attentat et je m'identifie aux personnes affaiblies par un handicap d'une manière plus spécifique que je n'aurais pu le faire si je n'avais pas été moi-même « brisé » par un attentat.
Par ailleurs, les changements qui sont intervenus en moi doivent être vus à travers le prisme de l'histoire. Il n'est pas vrai que j'ai changé autant que la situation a évolué. Ainsi, par exemple, de nombreux Blancs d'Afrique du Sud ont eu le sentiment que le Chris Hani qui participait aux négociations et au travail de réconciliation était une personne différente du chef d'état-major d'Umkhonto we Siswe, mais en fait les temps étaient simplement différents. Les négociations ont commencé pour ainsi dire pratiquement au moment où j'ai été victime de l'attentat. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, il s'agissait d'abattre le monstre de l'apartheid, alors que les années quatre-vingt-dix étaient placées sous le signe de la guérison et de la réconciliation. Il y a un passage clé au chapitre 12 du livre des Révélations, qui dit ceci : « Et il y eut la guerre dans le ciel ; Michel et ses anges combattaient le dragon ; et le dragon et ses anges se battaient. » C'est un passage sur le bien et le mal. Et pour nous, quelle forme prit cette bataille en Afrique australe ? C'était la lutte contre l'apartheid. Dans les Écritures, on peut aussi lire : « Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes{22} » (Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 6, 12) ; ce passage dénonce le caractère systémique du mal. À certains moments de la lutte, des voix se sont élevées en faveur de la guérison et de la réconciliation ; elles provenaient souvent des Églises et parfois de gens qui avaient un intérêt direct dans le maintien du statu quo. Ces appels étaient importants dans la mesure où ils montraient la voie vers l'issue finale, mais à l'époque ils étaient prématurés et détournaient l'attention. Les auteurs de ces propositions mettaient l'accent sur la nature interpersonnelle de la réconciliation, mais le mal était structurel et nous devions avant tout démanteler les institutions de l'apartheid.
Les temps avaient changé ; nous disposions d'un espace démocratique pour travailler, et la guérison et la réconciliation étaient au centre des préoccupations. Au moment où je m'étais remis de mes blessures, la guerre des tranchées était terminée. Le théâtre des opérations avait laissé la place à des personnes comme mon amie Glenda Wildschut, une infirmière de profession, qui rêvait de créer un centre de soins qui offrirait des services d'assistance psychologique à des personnes qui avaient été persécutées et obligées de fuir. Au fur et à mesure que le drame de la lutte perdait en intensité, il ouvrait la voie à la reconstruction de la nation et à un travail plus paisible de guérison, destiné à soigner le mal que nous nous étions fait les uns aux autres. Cette transition se refléta dans ma propre vie : de combattant pour la liberté, je devins « guérisseur ». Les témoignages présentés notamment lors des audiences de la commission vérité et réconciliation sur les droits de l'Homme étaient très variés. Certains étaient marqués au coin de la colère, mais beaucoup d'autres étaient empreints d'une certaine douceur ; parfois, le témoin étouffait un sanglot ou observait un long silence en luttant pour reprendre le contrôle de profondes émotions. Ainsi va le travail de guérison. Il nécessite une attention paisible et de la concentration, qui sont ensuite récompensées dans la mesure où, sous nos yeux, la douleur et parfois l'amertume deviennent souffle de paix et d'espoir.
Dans le chapitre 3 de l'Ecclésiaste, on peut lire : « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel [...]. Un temps pour aimer et un temps pour haïr ; un temps pour la guerre et un temps pour la paix{23}. » Même si je ne savais pas encore très bien ce qui m'attendait, l'attentat avait joué en quelque sorte le rôle de feu purificateur, qui me permit d'ouvrir progressivement les yeux : je trouverais le moyen de faire de mon handicap visible un instrument de guérison pour les autres. Comme me l'a dit mon ami Horst Kleinschmidt, je disposais désormais de nouvelles ressources, certes payées au prix fort, pour mener cette nouvelle bataille. Les preuves d'amour que j'avais reçues d'amis du monde entier constituaient un privilège qui n'était pas à la portée d'autres qui les méritaient tout autant. Qui dit privilège dit responsabilité ; j'exprimerais ma gratitude en parcourant avec d'autres le même chemin que celui qui avait été parcouru avec moi. Aujourd'hui encore, cette gratitude est le terreau de mon activité. En parcourant le monde, je me mets au service des plus pauvres parmi les plus pauvres, pour qui le privilège est une notion inconnue.
Dans un premier temps, ces idées manquaient évidemment de consistance et il convenait de cerner leurs implications pratiques. Lorsque je suis retourné au Zimbabwe après ma convalescence en Australie, j'ai appris que le poste de curé à Bulawayo que j'avais accepté avant mon attentat n'était plus disponible. Entre-temps, des changements historiques se produisirent en Afrique du Sud : la libération de Nelson Mandela, la légalisation de l'ANC et le début des négociations. Je décidai de voir ces changements de mes propres yeux et je me rendis donc en visite dans ce pays à la mi-1991. Envisager d'y retourner après toutes ces années tenait un peu de la gageure. Le rythme auquel les événements s'étaient succédé nous avait coupé le souffle.
L'ANC avait toujours parlé des quatre piliers de la lutte : la lutte armée elle-même, l'organisation clandestine en Afrique du Sud, la mobilisation massive de la population et la solidarité internationale. Les différents dirigeants avaient leurs préférences, mais l'ANC prit progressivement conscience qu'ils contribuaient tous à mettre la pression sur le régime. Certains ont peut-être imaginé qu'un mouvement de guérilla armé dans le pays finirait par s'emparer du pouvoir, et je pense que quelques-uns d'entre nous étaient persuadés que la lutte armée serait plus efficace qu'elle ne le fut en fin de compte. Au milieu des années quatre-vingt, avec la montée du Front démocratique uni (UDF) en Afrique du Sud, les publications de l'ANC commencèrent à évoquer la possibilité de rendre le pays ingouvernable. Peut-être une insurrection générale chasserait-elle le gouvernement du pouvoir, comme ce fut le cas plus tard en Égypte en 2011 ? Je ne sais pas dans quelle mesure tout cela était réaliste et peut-être y avait-il à cet égard un certain degré de naïveté. En fait, l'ANC a toujours été ouvert à des négociations depuis sa création en 1912, et il a noué au fil des ans, sous le couvert de la clandestinité, de nombreux contacts avec des figures de proue de la société civile et du gouvernement de l'apartheid, en particulier dans les années quatre-vingt. Quoi qu'il en soit, je m'étais personnellement préparé à un combat beaucoup plus long qu'il ne le fut en réalité. Comme j'étais un admirateur de la révolution cubaine et que je m'étais rendu à Cuba à plusieurs reprises, je me laissais aller à rêver que des tanks finiraient par entrer dans Pretoria et que la foule lancerait des fleurs aux combattants de la guérilla, comme elle le fit avec Fidel et le Che lorsqu'ils entrèrent de façon triomphale à La Havane. Je pense qu'aucun d'entre nous ne prenait ces rêves trop au sérieux, mais ils avaient le mérite d'exister et ils nous aidaient à garder le moral.
Le moment choisi pour mon attentat, tellement inexplicable dans un premier temps, se révéla rapidement être un indice quant à la tournure que les événements allaient prendre. Une vague de violences et d'assassinats sans précédent menaça de consumer le pays pendant la période des négociations, alors que ces dernières auraient dû être synonymes de trêve dans la répression menée par le régime de l'apartheid. Des milliers de personnes trouvèrent la mort pendant cette période et notamment notre chef bien-aimé Chris Hani, qui fut assassiné juste un an avant les élections. Le pays marcha sur la tête pour ainsi dire, et cet assassinat menaça de faire capoter l'ensemble du processus de négociation. Si une grande partie de la violence peut être attribuée directement au gouvernement de l'époque, il y eut des cas innombrables de violences entre Noirs. Des massacres furent perpétrés en pleine nuit : des gangs, qui vivaient dans des foyers loin de leur famille, agressaient au moyen de lances et d'armes à feu les malheureux habitants des banlieues noires. La plupart des agresseurs étaient des hommes pauvres et sans instruction, qui venaient de zones rurales éloignées et qui, pour venir en aide à leur famille, émigraient vers des zones plus urbaines, à la recherche d'un travail dans les mines, dans la mesure où il n'y avait pas de travail chez eux. Ils avaient été exploités par le système de l'apartheid : ils constituaient en effet une source de main-d'œuvre à bon marché, qui travaillait dans des conditions extrêmement dangereuses ; là, ils étaient une nouvelle fois exploités pour faire le sale boulot du gouvernement. Ces attaques entraînèrent évidemment des représailles. Il existait des rivalités entre différentes factions politiques dans la communauté noire, mais il a été clairement prouvé que le gouvernement exploitait de réels désaccords pour fomenter la violence. Il lui est reproché d'avoir aidé et encouragé directement ce que l'on appela la « troisième force » déstabilisante, parfois en partageant des informations confidentielles avec des groupes noirs rivaux et, dans d'autres cas, en fournissant directement des moyens matériels. Ainsi donc, le gouvernement de l'apartheid négociait le jour et tuait la nuit. Il espérait évidemment que le chaos et l'animosité qui en résulteraient empêcheraient la communauté noire majoritaire de se rassembler et de présenter un front uni pour les négociations. À certains moments, nous avons cru que le gouvernement pourrait arriver à ses fins. En fin de compte la sagesse l'a emporté grâce à la présence soutenue et rassurante de Nelson Mandela et à d'autres figures de proue de l'ANC. Une constitution intérimaire fut finalement élaborée, un processus électoral structuré fut mis en place et, à la dernière minute, tout le monde accepta d'y participer. Le 27 avril 1994 se produisit ce qui paraissait tenir du miracle : pour la première fois de son histoire, l'Afrique du Sud devint un pays démocratique géré par sa majorité, sur la base du principe « une personne, une voix ». Pour moi cependant, l'utilisation banalisée du mot « miracle » masque l'ampleur des souffrances et des sacrifices qui remontent à l'époque de l'esclavage et au-delà, et qui ont finalement permis que ces élections aient lieu.
En 1991, l'idée de retourner en Afrique du Sud me perturba quelque peu. J'éprouvai des sentiments très mitigés, n'ayant pas mis les pieds dans ce pays depuis 1976. Même si j'appréciai ce retour, je savais que ce ne serait pas facile à un moment où le pays était déchiré par la violence. J'ignorais qui m'avait envoyé la lettre piégée ; peut-être les auteurs guettaient-ils mon retour ? Compte tenu de la violence qui submergeait alors le pays, il n'était pas insensé de le penser. Des amis du Zimbabwe me dirent : « Pourquoi retournes-tu en Afrique du Sud ? Tu es fou ? Ces gens ont essayé de te tuer. Reste ici avec nous. » Malgré mes propres doutes, je leur répondis : « Si je suis au Zimbabwe, c'est uniquement pour défendre la cause de la lutte. Le moment est venu de prendre part à la construction d'un nouveau pays. Par ailleurs, vu la façon dont j'ai été capable de réagir à l'attentat, je pense que j'ai un rôle à jouer dans la guérison de la nation. Il est temps pour moi de partir. » Je devais me plonger personnellement dans les événements dramatiques en cours. Rester à l'abri au Zimbabwe à écouter les informations de l'autre côté de la frontière était bien trop frustrant. Qui plus est, d'un point de vue pratique, je souhaitais entre autres renouer des contacts personnels, qui seraient essentiels si je voulais obtenir un travail après mon retour définitif.
J'organisai un voyage de trois semaines. Dans un premier temps, ma demande de visa fut rejetée et on me fit savoir que, pour être admis dans le pays comme membre de l'ANC, j'avais besoin d'une immunité. Il ressortait des négociations que cette dernière aurait dû être accordée automatiquement, mais les Sud-Africains jouèrent au chat et à la souris avec moi. Étant donné que je suis un prêtre et non un homme de loi, il était clair pour moi qu'ils me pardonnaient leurs péchés et non pas les miens. Finalement, l'immunité me fut accordée, ce qui signifiait en théorie que j'étais supposé ne pas être arrêté lorsque j'atterrirais à l'aéroport de Johannesburg. Je n'en étais pas convaincu, même si la mission de l'ANC à Johannesburg me donna des assurances sur ce point. Alors que j'étais assis dans l'avion qui volait vers Johannesburg, mes toutes nouvelles prothèses reposant sur mes genoux, un flot de pensées et de sentiments se bousculèrent dans ma tête. Un an seulement s'était écoulé depuis l'attentat et quelques mois depuis que j'avais quitté l'Australie pour retourner au Zimbabwe, et voyager avec mon handicap m'inspirait un sentiment de vulnérabilité. Un jeune Zimbabwéen, Cosmas Mulonda, m'accompagnait pour m'aider à faire ce que je ne pouvais pas faire seul, mais j'avais toujours le sentiment que je dépendais de l'amabilité des autres. Je me sentais un peu comme un étranger dans ce pays pour lequel j'avais consenti tant de sacrifices. Le reconnaîtrais-je après si longtemps ? Par ailleurs, la plupart de mes amis et de mes camarades les plus proches étaient en exil avec moi. Si j'étais resté en contact avec des amis qui n'avaient pas quitté l'Afrique du Sud, je n'avais plus vu certains d'entre eux depuis de nombreuses années. Un sentiment étrange, mêlé à la fois d'espérance et de solitude, m'envahit. Lorsque j'arrivai à l'aéroport de Johannesburg, je ne fus pas arrêté et nous fûmes accueillis par un vieil ami, le père Kingston Erson, un prêtre de la Communauté de la Résurrection, originaire comme moi de Nouvelle-Zélande. Je débarquai parmi une foule bruyante de voyageurs ; pas de défilé pour me recevoir, pas de foule en admiration et personne pour jeter des pétales de fleurs. Je ne m'attendais bien sûr pas vraiment à recevoir des fleurs, je pensai avec une pointe d'ironie désabusée : « Ce n'est pas ainsi que les choses étaient prévues. » Quoi qu'il en soit, j'étais très ému d'être de retour.
Il était prévu que je me rende en visite dans trois villes pendant cette tournée, Johannesburg, Durban et Le Cap ; je garde un meilleur souvenir de mon arrivée à Durban qu'à Johannesburg. Mon amie Phyllis Naidoo, qui m'avait rendu visite à l'hôpital après mon attentat, nous accueillit à l'aéroport. Phyllis avait réuni un certain nombre de camarades qui vinrent me saluer à mon arrivée. Ils ne m'avaient évidemment jamais connu sans mains et même si Phyllis les avait certainement prévenus, me voir ainsi a dû être un choc. Cela n'enleva rien à leur enthousiasme et ils me dirent simplement : « Bienvenue à la maison, Michael ! C'est formidable de te savoir de retour ! » Quelle joie inégalée de les entendre dire que j'étais en fait de retour chez moi.
J'avais été invité au Congrès de l'ANC, qui se tenait à Durban du 2 au 6 juillet. C'était un rassemblement historique puisqu'il s'agissait du premier congrès qui se tenait en Afrique du Sud depuis la levée de l'interdiction de l'ANC. Nelson Mandela, qui n'avait été libéré que quinze mois plus tôt, fut élu à sa présidence. Il y avait beaucoup de travail en vue, dans la mesure où l'ANC déployait des efforts considérables pour quitter, pratiquement du jour au lendemain, son statut de mouvement pour la libération et devenir un parti politique, prêt à gouverner. Si l'issue des négociations avec le régime de l'apartheid n'apparaissait pas encore clairement, ce congrès symbolisait le triomphe de la lutte pour la mise en place d'un régime démocratique. Pour tous ceux qui étaient présents, et pour de nombreux camarades qui ne l'étaient pas, il était difficile d'imaginer que l'ANC était sur le point de gouverner l'Afrique du Sud et que nous étions en train d'approuver des politiques qui façonneraient le nouvel État démocratique pour lequel nous avions lutté. Le poids immense des responsabilités n'éclipsa pas notre joie et beaucoup d'entre nous versèrent des larmes.
Je me rendis ensuite au Cap, où je fus invité à dîner par Desmond Tutu, qui était devenu entre-temps l'archevêque anglican. J'emmenai Cosmas avec moi et j'insistai pour qu'il porte une cravate lors de cette réception à la résidence de l'archevêque ; je me sentis donc un peu penaud lorsque nous sommes arrivés et que nous avons trouvé ce bon archevêque en survêtement. Je manipulais encore assez maladroitement mes prothèses et c'est également lors de ce dîner que j'ai renversé du café sur Tutu, qui réagit de façon très bienveillante. Il m'encouragea à revenir en Afrique du Sud et m'assura de son soutien. Il fut convenu que j'exercerais mon ministère dans le diocèse du Cap. Il y avait cependant une pierre d'achoppement : l'archevêque avait en effet instauré une nouvelle obligation, en vertu de laquelle ses prêtres ne pouvaient pas être membres d'un parti politique. Il fallait y voir un...