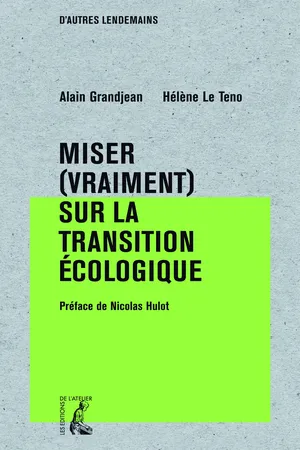![]()
Préface
par Nicolas Hulot{1}
Dans ces temps de difficultés économiques et sociales, et de pessimisme rampant, il est difficile de parler d'environnement et d'écologie. Ces sujets apparaissent comme des problèmes de plus et peut-être pas si urgents que cela ! Des problèmes de riches ! Et la tentation est forte de reporter leurs solutions à plus tard ou de faire l'autruche. Les progrès techniques et scientifiques nous permettront de faire face quand les choses deviendront vraiment graves, si elles le deviennent un jour !
Est-il possible d'aborder les enjeux de la transition écologique sous un tout autre angle, en la considérant comme un défi et une source d'enthousiasme et d'opportunités ? C'est le pari que font Alain Grandjean et Hélène Le Teno, bien qualifiés pourtant pour savoir que prendre le virage de la transition n'est pas une option pour bourgeois bohème en attente d'un supplément d'âme, mais bien une nécessité vitale chez nous comme dans les pays les plus pauvres.
À rebours d'une démonstration académique pesante, les auteurs nous montrent une transition en marche en France et dans de nombreux pays. Une transition qui part du territoire, de l'expérience, de l'implication et de l'engagement d'acteurs qui n'attendent ni le grand soir ni un plan de marche décidé d'en haut. Partant du terrain, ils nous dévoilent la multiplicité de ces petites révolutions silencieuses qui concernent nos besoins les plus immédiats : se nourrir, se déplacer, se chauffer... Comment faire mieux avec moins ? Comment satisfaire nos besoins en réduisant la consommation de ressources et les pollutions, notamment les émissions de gaz à effet de serre ? Les pistes données sont nombreuses et chacun comprend mieux comment il peut contribuer à cette transition en consommant autrement, en gérant son temps autrement, en épargnant autrement.
On comprend à la lecture de ce livre que la remise en cause de ce que notre système économique a mis au point depuis des décennies est profonde et concerne tous les domaines. La transition qui se joue en ce moment n'est pas qu'écologique. Elle est économique et sociétale ; elle nécessite l'acquisition de nouvelles compétences, elle remet en cause nos systèmes de formation et de parcours professionnels.
Les auteurs ne se contentent cependant pas d'un « small is beautiful » et ne nous laissent pas croire que la seule initiative individuelle suffira à transformer le monde. Ils concluent leur ouvrage par deux chapitres abordant des « sujets qui fâchent » : le financement de la transition, alors que l'heure est aux économies de tous poils, et la remise en cause de nos modes de gouvernance hiérarchiques et centralisés. Sur ces deux points, ils nous convainquent qu'il y a des solutions, dont des économistes comme Gaël Giraud ont montré le sérieux, et que la vie est bien trop complexe et les enjeux actuels bien trop enchevêtrés pour des modèles de gouvernance pyramidaux.
Nous devons réaliser que nous ne mobiliserons pas sur le constat seul, mais sur les solutions. Notre responsabilité est de faciliter la créativité et de mettre en valeur ce qui participe à résoudre l'équation du long terme et du court terme. Nous devons rendre le changement souhaitable et désirable. La vie politique est remise en cause par la transition écologique et, à nouveau, c'est une source d'enthousiasme et d'implication. À chacun de s'y engager.
![]()
Introduction
Notre machine économique mondiale est à bout de souffle : les pays de l'OCDE{2} ont le hoquet, les pays émergents voient leurs débouchés s'affaiblir, les pays exportateurs pétroliers traditionnels flirtent avec une manne qui diminue, les pays du Sud sont exposés à la voracité de tous pour leurs ressources supposées renouvelables...
Les médecins – politologues et économistes – appelés au chevet de la planète malade font chacun leur diagnostic et proposent des remèdes toujours plus raffinés pour résoudre la crise monétaire, pour réguler la finance internationale, pour maîtriser la dette des États, pour relancer l'économie par la consommation ou le bâtiment, pour la rendre plus compétitive par l'innovation...
L'actualité donne l'impression que cet acharnement thérapeutique est franchement inefficace : il est grand temps de penser le changement – et de le faire – plutôt que de changer le pansement.
Notre grande malade a comme point commun avec les dinosaures le gigantisme et la voracité.
En Europe, la machine économique dévore par exemple chaque année la bagatelle de 12 tonnes de matières par habitant pour bétonner (sable), rouler notamment en voiture (pétrole), manger (aliments pour bétail, engrais), produire des biens et des services{3}. Or, nous sommes toujours plus nombreux sur cette planète dont les ressources sont en quantités finies : nous voilà donc entrés dans un monde de ressources rares, dans un monde où la recherche du « toujours plus » a fait dire au secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon : « Nous avons le pied collé sur l'accélérateur et nous fonçons vers l'abîme. »
Le monde qui se forge aujourd'hui, c'est donc celui de la grande transition écologique vers une économie beaucoup plus sobre en ressources, capable de garantir une stabilité et une équité sociale minimale et qui pourrait nous épargner bien des conflits à venir.
C'est aussi un monde où le sens de l'action et le plaisir d'exister compenseront progressivement l'éventuel sentiment de sevrage ou de limitation matérielle ressenti par l'urbain moderne, dès lors qu'il sentira que le droit de faire et de s'accomplir ensemble génère autant sinon plus de plaisir que le seul droit de travailler pour consommer.
Enfin, c'est un monde où le territoire reprendra à terme sa place comme pourvoyeur indispensable de ressources : énergies, bois et biomasse, terres arables, dont il faudra d'autant plus de bras pour en tirer les fruits que les machines auront soif de pétrole rare et cher. Il faut donc s'occuper activement de l'avenir de nos territoires et de la façon dont nous souhaitons que ces biens communs* soient gouvernés demain.
Soyons clairs, dans ce livre nous renonçons en bloc au misérabilisme ambiant. Nous vivons une époque formidable qui va faire oublier celle tant vantée des baby-boomers et des Trente Glorieuses, nous sommes à bord d'une fusée qui nous emmène à pleine vitesse vers un futur excitant, nous avons mille talents qui vont s'exprimer avec toujours plus de force. La crise que nous traversons est la face apparente, émergée, du processus de transformation, voire de métamorphose en cours.
Nous tous, citoyens en pleine transition – et ce souvent sans le savoir – avons l'envie et la capacité de déployer un projet collectif qui rendra nos économies prospères, nos foyers heureux, offrira des emplois stimulants à chacun, dynamisera et équilibrera les territoires.
Nous ne savons pas encore bien reconnaître toutes les graines de la transition économique et écologique, mais il nous semble que de nombreuses petites histoires sont en train d'écrire un tournant de la grande histoire. Ce livre sera, nous l'espérons, à la fois un microscope qui manque à nos élus et dirigeants pour observer la mue de la chenille actuelle vers le papillon de demain, la boîte à outils contenant les actions et les moyens de financer la transition à leur offrir en cadeau, et une petite boussole pour aider chacun à trouver le nord et à tenir le cap tous ensemble. Nous espérons y montrer que l'avenir est plus que jamais notre affaire à tous.
Cet ouvrage propose de partager à la fois les motivations d'un tel grand changement et les divers chemins qui pourront nous y mener dans une relative sérénité. Après avoir précisé le contenu et l'ampleur des crises écologique et énergétique, nous poserons un premier diagnostic : pourquoi en sommes-nous arrivés là et qu'est-ce que la transition écologique ? Nous verrons ensuite que de multiples expériences en France et à l'étranger montrent qu'un mouvement se dessine. Nous donnerons quelques pistes, repères et outils pour les actions à mener tant au niveau collectif qu'individuel. Nous aborderons pour finir la question du financement, le nerf de la guerre, et celle de la gouvernance qui est à repenser en profondeur.
![]()
1. Crise écologique, crise énergétique
Citoyens ordinaires et élus, tous occupés à travailler, consommer, se distraire, nous voilà soudain jetés dans un océan de doutes. Le système auquel nous contribuons tous chaque jour, et qui nous fait vivre, s'effrite, les remèdes miracles pour la relance ne font plus effet, le pouvoir d'achat se contracte. Les perspectives pour nos enfants sont plutôt incertaines : l'espérance de vie en bonne santé semble se réduire{4}, la pauvreté et les inégalités augmentent{5}. Les maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires, obésité, diabète, cancers...) explosent. Il devient de plus en plus évident qu'elles sont dues à l'empoisonnement de notre environnement et de notre corps par les milliers de produits chimiques que nous ne cessons d'inventer{6}. Quoi de plus simple et de plus réconfortant alors que de fermer les yeux et d'attendre plein d'espoir que la tempête s'éloigne, ou bien qu'un capitaine, venu d'on ne sait où, nous sorte de ces parages dangereux ?
Si le déni est un des ressorts psychologiques les mieux connus pour ignorer l'arrivée d'une catastrophe imminente, il est bien sûr totalement inefficace pour traverser une crise de manière créative et en sortir par le haut.
Ouvrir grand les yeux sur cette crise, sur ses déterminants et ses manifestations à la surface de la planète, est un exercice sans doute un peu pénible mais salutaire. Nous proposons au lecteur de débuter ce voyage dans l'espace et dans notre histoire par un panorama de la crise écologique profonde dans laquelle nous sommes plongés.
Nombreux sont ceux qui pensent que l'environnement devient un luxe, ou tout au moins un sujet mineur, dès lors que nous affrontons au quotidien le chômage, la dette, les tensions géopolitiques.
Nous considérons au contraire que seule une lecture approfondie des déterminants de la crise écologique et de ce qu'elle révèle peut nous aider à bien comprendre ce qui nous empêche aujourd'hui de nous redresser. Rappelons que la crise écologique n'est pas qu'une « simple affaire » de pollutions locales gérables avec un peu de patience, ni de disparition de l'ours polaire. Notre relation à la planète est profonde et complexe, et elle est double : d'un côté, nous bénéficions pour l'instant – et souvent sans le savoir – de très nombreux « services gratuits » fournis par la nature ; de l'autre, nos activités produisent des effets toujours plus massifs nuisant au bon fonctionnement des écosystèmes, ce qui au final nous rend la vie moins facile.
Nous présenterons en premier quelques éléments qui devraient être de nature à nous alarmer. Nous détaillerons ensuite le principe qui nous pousse dans l'impasse et quelques raisons de notre cécité sur cette crise écologique majeure. Enfin, nous proposerons des éléments plus fournis relatifs à la question centrale des ressources énergétiques.
Un état d'équilibre initial reposant sur les services gratuits de la nature
Nous profitons chaque jour depuis la nuit des temps de « services » gratuits comme l'air pur, une eau à peu près potable grâce à l'épuration naturelle dans les cours d'eaux et les sols, un temps plus ou moins clément assorti de précipitations un peu aléatoires, des plantes comestibles et médicinales, du gibier, du poisson, du bois et des matériaux divers, du vent, du soleil...
En termes plus techniques, ces services écosystémiques* sont aujourd'hui rangés en quatre grandes catégories{7} : les services d'approvisionnement (ressources gratuites auxquelles on parvient à donner une valeur monétaire sur le marché, par exemple : bois, plantes, eau douce), les services de régulation (non monétarisés, tels que régulation du climat, contrôle de l'érosion évitant les glissements de terrain ou protégeant contre les tempêtes côtières, pollinisation, contrôle des ravageurs), les services culturels (beauté du paysage et intérêt touristique), et enfin les services d'appui (formation des sols, croissance des végétaux) qui conditionnent la base indispensable de tout l'ensemble.
Il est possible d'essayer de donner une « valeur » à ces services naturels. Un travail de recherche américain publié en 1997 dans la revue Nature{8} avait évalué à 33 000 milliards de dollars par an au minimum la valeur de dix-sept de ces services, soit l'ordre de grandeur du Produit intérieur brut (PIB*) mondial de l'époque. De telles évaluations sont entachées de fortes incertitudes et contestables au plan méthodologique, mais elles permettent de sentir qu'on a bien affaire à des services de grande valeur même s'ils n'apparaissent pas dans nos systèmes comptables.
Ces services et ressources gratuits fournis par la planète ont été pour les milliards d'humains qui nous ont précédés absolument vitaux, et ils le sont encore. Pour nos organismes vivants et notre santé, l'argent ou le pétrole ne servent à rien en tant que tels. Seul un écosystème abondant et en bon équilibre nous permet de manger correctement, respirer, nous abriter des intempéries.
Cette réalité toute simple a été quasiment effacée de nos esprits depuis la révolution industrielle par la découverte et l'emploi d'autres ressources incroyables de la planète. L'extraction des énergies fossiles (charbon, puis pétrole et gaz), suivie de la relative maîtrise de l'énergie nucléaire par certains nous ont permis de nous libérer (du moins en apparence) d'un mode de vie dépendant des ressources naturelles locales.
Les énergies fossiles : modernité ou démesure ?
Avec les hydrocarbures, nous avons découvert un gisement d'énergie concentrée – qui n'est autre que l'accumulation puis la transformation dans le sous-sol sur plusieurs millions d'années de végétaux produits par la photosynthèse{9}. Toujours plus nombreux, nous avons alors employé notre génie à mobiliser ce gisement et à déployer toute sa puissance à pleine vitesse, pour le meilleur et pour le pire.
Nous avons changé d'époque, développé et apprécié le confort de la modernité avec ses objets en plastique, la capacité à bâtir des constructions toujours plus hautes et des mégalopoles sans fin, le droit à la « mobilité pour tous », des flux de marchandises, des échanges toujours plus frénétiques d'informations numériques. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, baptisée anthropocène{10}. Une ère où l'homme exerce un pouvoir colossal de transformation de son environnement, par l'usage immodéré d'énergies abondantes et peu chères. Nous « produisons » plus de 12 milliards de tonnes-équivalent-pétrole d'énergie primaire par an{11}, dont plus de trois quarts par extraction de ressources fossiles, gracieusement mises à disposition par notre planète. Ceci équivaut à sortir de terre et brûler le contenu de 50 000 nouvelles piscines olympiques remplies d'hydrocarbures chaque jour ! Grâce à toutes ses machines, l'homme est devenu capable de déplacer autant de matériaux que la nature par les tremblements de terre et le volcanisme.
Cette nouvelle époque de « surpuissance » est aussi celle où l'homme devient incapable de réduire son appétit. Il semble victime d'une addiction tenace à la surconsommation. Sa gourmandise ne le rend d'ailleurs guère partageur : la croissance des inégalités se poursuit, et un bon milliard d'humains restent confinés dans des conditions de vie précaires, voire dans la pauvreté absolue.
Cette d...