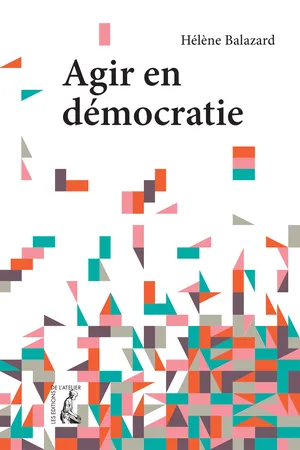![]()
Chapitre 1
Comment concilier justice sociale et autonomie de la société ?
« Participez ! », « Inscrivez-vous sur les listes électorales ! », « Organisez-vous ! » Face au déclin des formes de participation traditionnelle à la politique (vote aux élections, engagement dans un parti ou un syndicat) ou dans une optique de responsabilisation des individus, les injonctions à participer ne manquent pas. Mais elles ont tendance à augmenter les inégalités politiques, et donc socio-économiques, plus qu'à les réduire, car seuls ceux qui ont suffisamment de ressources (temps, argent, conscience de leur propre pouvoir, etc.) se mobilisent{21}.
Comment garantir, d'une part, que les institutions qui permettent de garantir la justice sociale ne remettent pas en cause l'autonomie de la société en étant dominées par une élite ? Et, d'autre part, comment s'assurer que l'autonomie de la société (étymologiquement une société qui se gouverne par ses propres lois) ne favorise pas les plus forts, minant ainsi la justice sociale ?
Alors, qu'il est illusoire d'envisager une participation spontanée et égale de tous, comment le plus grand nombre de personnes, et notamment celles qui en sont le plus éloignées, peuvent-elles participer à la politique ?
Autonomie de la société, dans quel but ?
Les expériences de community organizing font partie des initiatives qui cherchent à dynamiser et à soutenir la participation de ceux qui ne se mobilisent pas spontanément contre les injustices vécues. Elles visent l'émergence de collectifs intermédiaires entre l'individu d'un côté, et l'État et le marché de l'autre. Les habitants, soutenus par des organisateurs* (community organizers), façonnent leur propre agenda politique et demandent des comptes aux élites économiques et politiques du territoire sur lequel ils s'organisent afin d'obtenir des améliorations concrètes de leurs conditions de vie. Contrairement à des initiatives émanant de commanditaires institutionnels pour « faire participer les habitants{22} », ces organisateurs sont directement employés par les membres (les « habitants ») d'une community organization. Cependant ils ont bien un rôle d'accompagnement de cette participation ascendante*. Le chapitre 4 reviendra sur la tension entre accompagnement et émancipation.
De nombreux projets de participation des habitants (exemple : conseils de quartier et de développement, concertation autour de projets d'aménagement, etc.) rencontrent souvent une grande difficulté à mobiliser les habitants et à aboutir à des changements concrets. Face à ces limites, le community organizing représente un moyen innovant pour mobiliser un large nombre et une diversité d'individus et pour obtenir des changements sur des problématiques telles que le logement, l'alimentation, les salaires, l'emploi, la sécurité ou l'exclusion politique. En France comme dans d'autres pays, on observe un intérêt grandissant pour ce modèle d'émancipation de la société civile. Il est dû récemment à l'« effet Obama », qui fut lui-même community organizer à Chicago, mais aussi aux limites de la politique de la ville et aux frustrations exprimées par les professionnels de la participation comme du travail social. C'est souvent la capacité mobilisatrice de ces méthodes qui suscite l'engouement. Des représentants des collectivités locales ou des partis politiques s'y intéressent pour dynamiser la démocratie locale ou refonder la base d'un parti. Dans ces cas, l'essentiel est parfois mis de côté, à savoir le fait que le principe de base du community organizing est l'auto-organisation des personnes concernées par les problèmes traités. Ce n'est pas un dispositif de mobilisation descendant, institutionnel ou partisan. Les habitants s'organisent entre eux pour décider de la façon de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Ils s'émancipent politiquement.
Mais une fois ce principe énoncé, il n'en reste pas moins ambigu. En effet, que signifie résoudre soi-même les problèmes rencontrés ? Jusqu'à quel degré d'autonomie ? Comment ces initiatives s'inscrivent-elles dans le fonctionnement actuel de la société ? Quel type de « participation » est mis en avant par ces initiatives ? Comment trouver l'équilibre entre une approche descendante de l'organisation de la société et le laisser-faire pour atteindre la justice sociale et l'autonomie de la société ? Les différentes pratiques du community organizing sont au cœur de ce dilemme.
L'expression « community organizing » désigne une grande variété de formes d'auto-organisation collective à l'échelle locale visant l'amélioration des conditions de vie des habitants mobilisés et la justice sociale. Les différentes formes de community organizing qui se sont développées au cours du XXe siècle dépendent de ce qui est désigné par « communauté » – une zone géographique, un groupe ethnique ou une communauté d'intérêts – mais aussi des financements, du degré d'institutionnalisation et surtout de la nature de la participation de la « communauté ». Il y a ainsi un grand écart entre les missions du community organizer de la politique de la « Big Society{23} » lancée en 2010 par le Premier ministre du Royaume-Uni David Cameron – qui vise notamment le transfert de la gestion de services publics locaux vers des associations de citoyens – et celles d'un employé d'une community organization suivant le modèle initié par Saul Alinsky dans les années 1940. Saul Alinsky développa la première community organization à Chicago en mêlant, entre autres, les principes de l'enquête sociale avec ceux de l'organisation syndicale{24} pour créer un contre-pouvoir capable d'interpeller et de faire rendre des comptes aux élites politiques et économiques. Il est d'ailleurs souvent désigné comme le père du community organizing. Mais en réalité l'utilisation du terme peut renvoyer à des pratiques très différentes voire antérieures. Dans le domaine du travail social, le community organizing s'est développé en tant que discipline à part entière depuis les premières settlement houses de Jane Addams. Au début du XXe siècle, ces « maisons d'accueil » voyaient le jour dans les zones urbaines pauvres des grandes villes. Les femmes et les hommes issus des classes moyennes et aisées y vivaient en communauté, dans le but de partager leurs connaissances et culture avec leurs voisins, faiblement rémunérés et peu instruits{25}. On parle alors de « travail social communautaire », voire de « développement social local ». Dans le domaine du syndicalisme, les community unions et le travail de César Chavez au sein de l'United Farm Workers Organizing Committee se réfèrent au community organizing. La jeune ONG française ReAct{26} utilise ainsi les méthodes du community organizing pour construire des contre-pouvoirs citoyens aux entreprises multinationales (en alliant notamment les riverains et les travailleurs de ces firmes dans les différents pays concernés).
En considérant la nature de la participation des habitants visée par l'action d'une community organization, deux grandes tendances sont identifiables : les organisations indépendantes et radicales et le développement communautaire.
Les organisations indépendantes et radicales
Les organisations indépendantes et radicales peuvent réunir des individus (cf. Acorn{27} ou des mouvements autour de la défense des droits d'un groupe particulier, comme ce fut le cas pendant le mouvement des droits civiques – civil rights movement – aux États-Unis) ou bien divers groupes de la société civile préexistant sur un territoire (congrégations religieuses, associations, écoles, syndicats...), on parlera alors de broad-based community organizing (cf. les réseaux d'organisations tels l'Industrial Areas Foundation, le Pacific Institute of Community Organization, la Gamaliel Foundation et le Direct Action and Research Training Center). Ces différentes organisations{28} cherchent, par principe, à être indépendantes des pouvoirs locaux privés comme publics afin de pouvoir exercer un véritable contre-pouvoir en développant la capacité d'action des habitants mobilisés. Les administrateurs de ces organisations sont issus des membres et emploient des « organisateurs » professionnels pour soutenir le travail de mobilisation. Un des objectifs est la lutte pour la justice sociale via l'interpellation des pouvoirs en place, la réclamation de comptes (accountability) et la proposition de solutions. Ces organisations s'inspirent toutes du modèle mis en avant par Saul Alinsky, qui fonda une des premières community organizations dans le quartier populaire du Back of the Yard à Chicago en 1939 et plus tard l'Industrial Areas Foundation. Elles visent à démocratiser la gouvernance des villes où elles sont présentes et considèrent généralement leur processus de démocratie interne comme une étape nécessaire à l'avènement de cet objectif. À l'intérieur de cet ensemble, notons que les thématiques abordées et les publics mobilisés peuvent varier, tout comme les stratégies adoptées vis-à-vis de la politique partisane ou les objectifs en matière d'émancipation individuelle des participants. Les observateurs distinguent ainsi des organisations purement « alinskienne » de celles plus « freiriennes » (en référence à Paolo Freire{29}, autre inspirateur de ces mouvements d'émancipation des dominés), où le développement des compétences et de la reconnaissance individuelle est jugé plus important que la réussite des actions politiques.
Le développement communautaire
Les organisations de « développement communautaire » (exemple : les nombreuses community development corporations créées dans les quartiers populaires aux États-Unis depuis les années 1960, les settlement houses dans le domaine du travail social) proposent à la fois la construction d'un sens de la communauté (community building) et la gestion de service de proximité (logement, recherche d'emploi, accompagnement scolaire, assistance sociale, etc.). Une partie de la direction de ces organisations est assurée par les personnes concernées par ce « développement ». Par exemple, au moins un tiers du conseil d'administration d'une community development corporation est composé de résidents de la communauté. Les organisations de développement communautaire peuvent être liées aux expériences plus radicales de community organizing quand celles-ci évoluent vers la gestion d'un programme qu'elles auraient contribué à mettre en place. Elles peuvent également résulter d'une initiative citoyenne locale soutenue par des politiques publiques (exemple : The Social Security Act en 1935, le Community Action Program de 1964 ou les Empowerment Zone aux États-Unis, le New Deal For Communities ou le Big Society program au Royaume-Uni). Dans les politiques publiques des pays anglo-saxons comme dans les organisations internationales telle la Banque mondiale, le community organizing est souvent accolé à la notion d'empowerment, et est souvent mis en avant pour pallier le non-engagement des autorités publiques en matière de réduction de la pauvreté, de sécurité, de logement et de développement économique. Dans certains cas, ces politiques de promotion du développement communautaire visent le renforcement de l'intégration des habitants autour de projets reliés aux structures de pouvoir en place. Dans d'autres, c'est plus spécifiquement le développement d'entreprises ou de projets contrôlés par ceux et celles qui y travaillent ou qui en consomment les produits ou les services qui est recherché. En analysant ces différents types d'organisations de développement communautaire, Marie-Hélène Bacqué{30} souligne la « capacité d'innovation remarquable » de ces organisations qui constituent souvent une des seules forces de représentation des habitants. Mais elle déplore la marchandisation de la gestion urbaine et sociale qui met en concurrence différentes community organizations et laisse le marché véritable maître du jeu. Ces organisations dépensent en effet une partie de leurs ressources à se faire la compétition pour obtenir telle subvention ou tel marché de gestion de service, si bien que les finalités initiales d'amélioration des conditions de vie des habitants sont mises de côté.
Ces deux tendances illustrent les ambivalences de la rhétorique de la responsabilisation des individus que l'on retrouve d'ailleurs dans l'énoncé de la « règle d'or » du community organizing : « ne jamais faire pour les autres ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes{31} ». Mais de quoi les citoyens doivent-ils être responsables ? D'un côté, le community organizing dans sa version radicale prône avant tout l'exercice d'un contre-pouvoir et n'appelle pas au désengagement des institutions publiques et privées, mais plutôt à leur interpellation par une société civile organisée. C'est la responsabilité de la participation « politique » des membres de la cité qui est mise en avant. Pour envisager une transformation des rapports de force inégalitaires, il s'agit que le plus grand nombre s'insère dans les relations de pouvoir qui produisent l'ordre politique de la société. D'un autre côté, des politiques publiques ou des programmes des bailleurs internationaux utilisent cette même rhétorique de responsabilisation pour justifier la privatisation de l'action sociale et urbaine, tout en en gardant le contrôle politique. Le développement économique et social, plus que politique, permet à de nouvelles personnes d'accéder à plus de ressources et donc de pouvoir, mais a tendance à recréer des mécanismes de domination si les conditions ne sont pas réunies pour que tous défendent leurs droits et intérêts. Ce faisant, l'importance du rôle structurant des relations de pouvoir est nié et certaines personnes en viennent à accuser les pauvres d'en être là par leur faute. Autrement dit, dans le premier cas, les citoyens acquièrent le pouvoir de « faire faire », alors que dans le second cas il s'agit essentiellement du pouvoir de « faire » (gérer des logements, une crèche ou tout autre service, ou créer une entreprise, faire des études, etc.). Et ce sont les politiques ou programmes de développement communautaire qui ont le pouv...