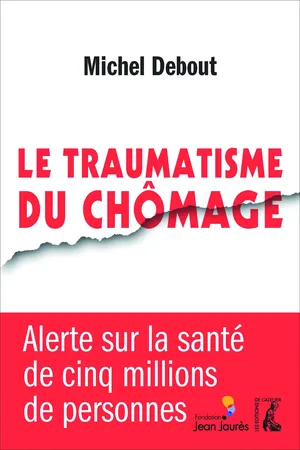![]()
Chapitre 1
Licenciements et pertes d'emploi.
Une atteinte au bien-être physique, psychologique et relationnel des travailleurs
Lorsqu'on aborde la question de l'effet du chômage sur la santé, jamais on n'évoque l'élément déclenchant : le moment de la perte de l'emploi, suite à un licenciement, dans le cas, par exemple, d'un plan social (notons toutefois que les plans sociaux ne représentent que 5 % environ de l'ensemble des licenciements), suite à un dépôt de bilan pour l'artisan et le commerçant, ou suite à la fermeture de l'exploitation pour l'agriculteur. Ce moment est en lui-même générateur de troubles qui peuvent être majeurs sur le plan psychologique et sur le plan de la santé globale, parce qu'il représente au sens plein du terme un événement traumatique. Il en a toutes les caractéristiques. Mais force est de constater que, dans la liste des événements considérés comme potentiellement traumatisants – agression, cambriolage, accidents –, la perte d'emploi n'est jamais mentionnée.
Cette lacune a une conséquence qui explique peut-être le silence que l'on observe à son sujet. Si la perte d'emploi était considérée comme un événement traumatique, il en résulterait que le fait de licencier une personne ou de la priver de son emploi constituerait un risque psychosocial dont la responsabilité reviendrait à l'instance qui est à l'origine de la fin du travail.
Le choc du licenciement ou de la perte d'emploi
L'annonce du licenciement est souvent brutale voire inattendue et peut être réalisée de façon violente. Les exemples ne manquent pas, malheureusement, de pratiques inacceptables comme celle d'un mail adressé à un salarié à son retour de vacances pour lui indiquer qu'il ne fait plus partie du personnel. À cet effet de surprise, qui empêche d'élaborer des défenses adaptées, s'ajoutent deux sentiments fréquemment ressentis :
– le premier est un sentiment de mort exprimé de diverses façons : « Le monde s'écroule », « La terre s'ouvre sous nos pieds », expressions qui traduisent un sentiment d'anéantissement personnel ; (« Je suis en deuil d'avoir perdu un travail que j'aimais, des collègues que j'aimais ; je ne retrouverai jamais cela ailleurs{13} ») ;
– le second est un sentiment d'humiliation, voire de déshumanisation : « On est moins que rien », « On est pris pour des déchets, des salariés kleenex » (« J'aime bien les choses justes, je n'aime pas que l'on me prenne pour un jambon{14} »).
Une fois cette épreuve de l'annonce passée, qui peut s'accompagner d'une sidération ou, à l'inverse, d'une hyperréaction émotionnelle, le salarié se retrouvera d'un instant à l'autre jeté hors de son lieu de travail. Après ce départ forcé, avec parfois quelques affaires personnelles qui ont été rassemblées par d'autres pour qu'il n'y ait pas de nouveaux contacts avec les anciens collègues, un sentiment de vide intérieur s'installe, l'impression soudaine de ne plus avoir de place dans le monde réel, qui nécessitera un temps plus ou moins long de récupération, de retour à l'ordinaire.
Dans les semaines qui suivent...
Les jours suivants pourront s'installer les symptômes de l'état de stress post-traumatique avec une série de manifestations anxieuses : perte d'appétit, sommeil difficile parfois accompagné de cauchemars, troubles émotifs, irritabilité, flashes intrusifs... Le licencié pourra être en proie à un sentiment de honte et de culpabilité, comme s'il avait perdu son travail par sa propre faute, comme si lui seul était en cause, et non la réalité économique ou une certaine gestion de l'entreprise. Une véritable rumination sur les derniers événements vécus dans l'entreprise, les relations avec les collègues et la hiérarchie, accompagnée d'une sensation d'échec et d'impuissance, pourra se transformer progressivement en une « perte d'estime de soi{15} », l'un des premiers symptômes de l'état dépressif.
À l'inverse, l'humiliation d'avoir été si violemment traité pourra se traduire chez le chômeur par un sentiment de colère à l'encontre de ses anciens employeurs, voire de la société tout entière. Le recours à des procédures nombreuses et variées nécessaires à la médiatisation de sa situation viendra assouvir un authentique besoin de vengeance.
Le chômeur, comme tout traumatisé, peut aussi chercher à échapper à ce climat de rupture, de perte et d'échec par la consommation de plus en plus marquée de substances psychotropes, au premier rang desquelles l'alcool, auquel il faut ajouter les médications (somnifères, anxiolytiques, antidépresseurs), souvent prescrites à petite dose au départ, pour faciliter le sommeil, stabiliser les humeurs, diminuer les angoisses, et que l'intéressé finit par transformer en véritable drogue. Les effets propres des produits absorbés, leur capacité à provoquer un état de manque neurophysiologique et psychologique vont entraîner le chômeur-consommateur dans la spirale d'une dégradation globale de son état de santé.
Quand la consommation d'alcool est une habitude ancienne, elle risque d'être ravivée par la situation de chômage. Cette consommation est aujourd'hui totalement banalisée. Les effets stimulants de l'alcool, en tout cas au début de la consommation, expliquent le recours qu'il représente pour les chômeurs. À cela s'ajoute le fait que cette consommation est facilitée par le nombre de bars, bistrots et autres cafés... qui représentent alors le dernier lieu de socialisation. C'est là que l'on retrouve d'anciens collègues. Ces lieux permettent de garder le lien avec d'autres personnes. L'un des signes de la gravité de l'intempérance alcoolique est la consommation solitaire qui peut aller jusqu'à l'usage de produits tels que l'alcool pharmaceutique à très haut degré alcoolique (comme l'eau de Cologne).
L'alcool consommé seul vient ajouter ses effets aux médicaments prescrits, voire à des produits illicites de consommation plus courante aujourd'hui (25 % de jeunes français auraient consommé au moins une fois du cannabis, 10 % d'une façon régulière), produits dont la consommation se banalise, ouvrant la porte à d'autres drogues plus nocives, habitude qui pourra alors faire le lit d'une véritable addiction.
Il faut mentionner enfin le tabagisme, qui pourra être réactivé ou augmenté de façon conséquente. Les nouvelles règles de consommation réduisent aujourd'hui dans l'espace familial et surtout public la consommation de tabac, dont les effets nocifs se ressentent surtout à moyen et long terme.
Les difficultés psychologiques des chômeurs peuvent affecter leurs capacités personnelles et faire obstacle à la recherche d'un nouvel emploi. Cette recherche devient souvent l'unique activité du chômeur, elle est même rendue obligatoire en contrepartie des allocations perçues ; cela peut lui donner une dimension obsédante. De nombreux chômeurs savent mobiliser tous les soutiens dont ils peuvent bénéficier et, parmi eux, le réseau associatif qui peut leur venir en aide, quand il ne s'agit pas de certaines « officines » spécialisées en techniques psychologisantes pour retrouver sa confiance en soi...
D'autres n'y croient plus et s'enferment peu à peu dans l'isolement. À la suite des CV envoyés au rythme de l'ordinateur, les quelques rares réponses positives (en période de chômage de masse, certains bassins d'emploi connaissent une véritable déshérence) ne signifieront pas pour autant l'embauche. Il faut, pour l'obtenir, franchir de nouvelles étapes, passer de nouveaux tests, justifier pour la énième fois de ses compétences et de ses projets professionnels. Cette obligation, qui peut être stimulante, voire qui peut conduire le chômeur à souhaiter faire un bilan de compétences – parfois vers une reconversion professionnelle –, sera vécue dans d'autres cas par le chômeur (qui se sent, lui, la victime d'une décision de licenciement dont il n'est pas responsable) comme l'obligation pressante de prouver sa bonne volonté et de se présenter sous son meilleur jour. Lorsque cette course d'obstacles arrive à son terme, à savoir l'entretien final qui déterminera l'embauche, il faudra répondre à une multitude de questions posées par des recruteurs parfois plus jeunes et plus inexpérimentés que le chômeur lui-même ! Cette situation déséquilibrée peut alors provoquer une réactivation du traumatisme psychologique subi lors du licenciement, car elle représente une remise en cause quasi identitaire des possibilités professionnelles du chercheur d'emploi. Elle peut ainsi assombrir un peu plus l'avenir si l'embauche n'est pas au rendez-vous. Ces difficultés vont retentir sur sa vie quotidienne, familiale et sociale, avec comme conséquence l'aggravation de son état.
Les effets du chômage sur l'entourage
Le 30 août 2013, le conseil des prud'hommes a invalidé le licenciement des 680 salariés de l'usine Continental pour défaut de motif économique et pour non-respect de l'engagement de reclassement. L'entreprise a été condamnée à verser en moyenne trente à trente-six mois d'indemnités à chaque salarié. « C'est quand même des sommes énormes. Pour nous, a déclaré Antonio Da Costa, ex-délégué de la CFTC, c'est quand même une victoire, mais malheureusement ça n'effacera pas le désastre social. Il y a eu plusieurs suicides, 250 divorces, des familles éclatées{16}. » En effet, presque un couple sur deux aurait divorcé dans les cinq ans qui ont suivi le plan social, sans compter les couples qui ont connu des périodes de conflit ou de désespoir qu'ils ont su surmonter.
L'état de chômage transforme le quotidien du couple et de la famille : celui ou celle qui partait chaque jour en même temps que les siens pour se rendre à son travail va se retrouver seul à son domicile, avec un emploi du temps totalement libre, de cette liberté synonyme d'inutilité, que le chômeur n'arrive pas toujours à compenser par des activités de recherche d'emploi ou d'autres occupations personnelles, voire associatives... Le chômeur peut alors avoir le sentiment de passer son temps à le perdre, et l'un des premiers signes de résignation dans ce vide qui s'installe est vestimentaire : le chômeur n'éprouve plus le besoin de changer de tenue après le réveil, et peut même faire preuve d'un certain laisser-aller corporel dans les cas extrêmes. C'est dans ces cas-là que le risque addictif est majeur, mais aussi le risque suicidaire... Les hommes sont plus exposés à cette dégradation parce qu'ils s'investissent moins dans les tâches ménagères (même si cette réalité évolue lentement), et que, surtout, la perte d'emploi constitue une atteinte symbolique à la mission traditionnelle qui est la leur : travailler pour assurer la subsistance des leurs. Les femmes comme les hommes éprouvent souvent un sentiment de dévalorisation personnelle et sociale qui peut les entraîner vers la perte d'estime de soi et jusqu'à la dépression.
Ce phénomène permet de comprendre ceux qui, notamment ex-cadres dirigeants mais pas seulement, cachent à leur famille qu'ils ont perdu leur travail et simulent un emploi du temps inchangé comme preuve du maintien de leur activité professionnelle. Cette attitude s'explique souvent par la volonté de p...