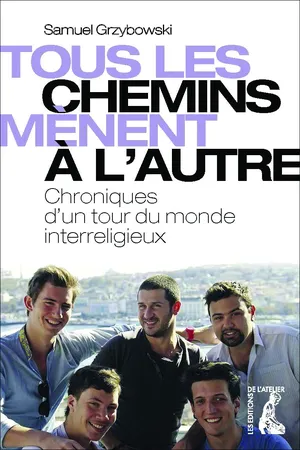![]()
Chapitre 1
Un voyage avant le voyage
Égypte
Comme chaque année depuis cinq ans, Coexister propose un voyage annuel pour permettre à des jeunes ne partageant pas les mêmes convictions religieuses de vivre une expérience de vie commune au quotidien. Cette année, c'est en partenariat avec Confrontations, une association d'intellectuels chrétiens, que nous proposons un voyage sur les traces de l'histoire islamo-chrétienne de l'Égypte. Nous sommes un groupe de quinze jeunes jumelés avec quinze universitaires.
Au moment où nous nous envolons vers ce pays millénaire, la situation politique est à peu près stable, même si les Égyptiens attendent une véritable transition après la révolution de 2011. Morsi est au pouvoir, porté par son parti islamiste, les Frères Musulmans. L'actualité récente a plutôt fait parler de l'Égypte pour illustrer les tensions entre chrétiens et musulmans. L'attaque d'une église d'Alexandrie a fait plus de trente morts chez les chrétiens le 1er janvier 2011. À première vue, la situation des chrétiens est désastreuse, on parle davantage de leur persécution par les musulmans que de leur cohabitation avec eux.
Ce 1er juin 2013, l'Égypte est en pleine ébullition. Depuis la chute du pouvoir militaire, les citoyens semblent croire à l'avenir. Les rues autrefois très organisées sont couvertes de monde dans un grand bazar autorisé. La place Tahrir, haut lieu de la révolution, accueille encore de façon quotidienne des rassemblements politiques qui encouragent à la poursuite des réformes. Lorsqu'on se trouve sur cette place, on est d'abord saisi par l'immensité du lieu. Elle peut contenir des dizaines de milliers de personnes. On remarque d'emblée la présence d'une église et d'une mosquée. Ces deux lieux de culte qui incarnent la partie la plus récente de l'histoire de l'Égypte ont servi d'hôpitaux de fortune aux révolutionnaires pendant les manifestations de 2009 à 2011. Ceux que nous rencontrons sur la place racontent comment, pendant les manifestations, les musulmans protégeaient les chrétiens pendant la prière, et inversement. Comme le dit Jean-Jacques Pérennes, dominicain présent au Caire, il est difficile d'admettre l'idée selon laquelle après le Printemps arabe est venu l'hiver islamiste. La situation est, selon lui, bien plus complexe que ce genre de raccourcis. Les Égyptiens que nous côtoyons témoignent de fait d'un engouement, d'une liberté, d'un enthousiasme et d'une joie urbaine. Impossible de parler « d'hiver » quand des citoyens privés de démocratie depuis cinquante ans retrouvent enfin des droits fondamentaux d'expression, de manifestation et de circulation.
Après avoir arpenté la place Tahrir, nous nous rendons à l'Institut dominicain des études orientales (IDÉO). Jean-Jacques Pérennes, présent au Caire depuis quatorze ans, est le responsable de cet institut unique au Moyen-Orient. L'IDÉO est en effet doté de la plus grande bibliothèque de théologie islamique et d'histoire de l'islam de toute la région. Même des chercheurs de la prestigieuse université al-Azhar s'y rendent pour faire avancer leurs thèses. En tant que centre chrétien, l'IDÉO, qui est spécialisé en islamologie, devient dans les faits un véritable espace de rencontres entre Égyptiens chrétiens et musulmans, mais aussi entre Arabes et Occidentaux qui viennent y étudier l'islam, son histoire, sa science. À l'heure où des fondamentalismes en défigurent le visage, l'islam et sa civilisation intéressent en effet de plus en plus d'érudits. Lorsqu'il nous reçoit, Jean-Jacques Pérennes nous expose la situation de l'Égypte et des chrétiens coptes. « Copte » en arabe signifie tout simplement « Égyptien ». Le Copte, en fait, c'est le chrétien d'Égypte. Cette Église orthodoxe, présente ici depuis deux millénaires, accueille le tombeau de saint Marc et de nombreux monastères. Combien compte-t-elle de fidèles ? 20 % de la population selon les autorités religieuses, 5 % selon le gouvernement... Ces chrétiens ont donné à leur patriarche le titre de pape. Celui-ci entretient des relations particulières avec le cheikh de la grande institution d'al-Azhar. Ainsi, dans l'une des principales églises du Caire, je suis étonné de découvrir, trônant au-dessus des portes et des couloirs, des photos de différents imams d'al-Azhar et des chefs d'État égyptiens aux côtés des portraits du pape Tawadros. Ici, les relations avec l'islam, ou plus précisément avec les musulmans, ne sont pas une option. C'est d'abord une réalité quotidienne que les croyants nous décrivent spontanément comme, la plupart du temps, fructueuse. Ce voisinage est parfois entaché d'un choc ou d'une souffrance comme après les attentats d'Alexandrie en 2011. Néanmoins, pas un seul des chrétiens que nous croisons ne témoigne d'une souffrance durable et d'une tension latente avec la majorité égyptienne. Pour eux, la menace est claire : les salafistes, petite minorité intégriste, veulent la fin de la présence chrétienne en Égypte. Les autres, les Égyptiens lambda, ceux qui pratiquent l'islam « du milieu », comme l'appelle al-Azhar, côtoient de façon plus ou moins chaleureuse les chrétiens d'Égypte. L'amitié n'est pas toujours grande, mais la tolérance, voire le respect réciproque, est souvent de mise.
Au milieu de cette grande cohabitation qui dure depuis quatorze siècles (l'islam étant arrivé en Égypte en 642 avant Jésus-Christ, dix ans après la mort du prophète Muhammad), certaines relations singulières se nouent et sont exemplaires. C'est le cas de Jean-Jacques, notre ami dominicain, et son camarade Amr. Tous les deux se rencontrent à l'IDÉO et commencent à se lier d'amitié. Ensemble, ils fondent une section de l'Arche{2} au Caire afin d'accueillir des personnes handicapées sans distinction de religions. Ainsi, grâce à eux, chrétiens et musulmans accueillent sous le même toit des individus en situation de handicap physique et mental. Dans les bureaux de l'IDÉO où nous les rencontrons, Amr et Jean-Jacques racontent l'histoire de leur amitié. Pas de doute dans leurs cas, l'un n'est pas moins chrétien et l'autre pas moins musulman. C'est en tant que croyants, enracinés dans leurs traditions respectives, qu'ils s'estiment et se découvrent. C'est ainsi que l'IDÉO s'enracine en tant que centre chrétien en terre d'islam.
Deux grandes rencontres ont culminé au sommet de ce séjour au Caire. La première à l'IDÉO, la deuxième à l'université d'al-Azhar, considérée comme la plus haute autorité de l'islam sunnite, qui concerne 83 % des musulmans dans le monde, c'est-à-dire 1,3 milliard de personnes. À quelques kilomètres, l'immense université d'al-Azhar accueille des étudiants venus du monde entier. C'est l'occasion de nous défaire de certains clichés. Même si nous sommes en Égypte, les musulmans des pays arabes, de la Syrie jusqu'au Maroc, ne représentent que 20 % de l'islam mondial. La première population musulmane au monde est indonésienne, c'est-à-dire asiatique. À eux seuls, les Indonésiens représentent 13 % des musulmans du monde. Lorsque l'on se promène dans al-Azhar, le caractère international et universel de l'islam est frappant. La majorité des étudiants sont donc asiatiques (Indonésiens, Malaisiens, Brunéiens, Chinois, Bangladais, Indiens) ; on y croise aussi de très nombreux étudiants africains (Somaliens, Tchadiens, Nigérians, Maliens) et arabes (Algériens, Marocains, Tunisiens, Palestiniens, Syriens, Irakiens). Notre périple sur la planète est à peine commencé que nous avons le sentiment de faire le tour du monde sans changer d'endroit. C'est la première fois que je côtoie ainsi des musulmans du monde entier. L'Église catholique qui revendique aussi l'universalité n'en a donc pas le monopole. À la vue de la diversité de ces étudiants musulmans, je ressens une émotion aussi intense que pendant les Journées mondiales de la jeunesse. La religion est différente mais la multitude de nations et de visages est la même. L'islam est pluriel et cette diversité interdit justement les amalgames et les généralités. Certains disent qu'il n'y a pas « un islam » mais « des islams ». Même si je peux comprendre que des musulmans n'apprécient pas ce pluriel, car la foi islamique est une, il y a tout de même une réalité sociologique difficilement niable : l'islam s'enracine dans des cultures et des géographies immensément diverses.
Ce jour-là, Ahmed el-Tayeb, par l'intermédiaire de son conseiller aux affaires interreligieuses, Mahmoud Azab{3}, nous reçoit au rectorat de l'université. Je connais bien ce dernier grâce à Christophe Roucou, directeur du service pour les relations avec l'islam de l'Église de France dont il est très proche. Mahmoud est un francophile et francophone dont les filles vivent à Paris. Nous nous sommes croisés récemment à Vienne lors d'un sommet international sur les relations interreligieuses et le rôle de la recherche universitaire dans l'enseignement du fait religieux. Mahmoud est un homme de dialogue dont le travail acharné vise au rapprochement entre al-Azhar et le Saint-Siège. Il s'agit d'un travail ardu, surtout depuis que les relations ont été rompues après le discours de Ratisbonne en 2007{4}. L'une de ses deux filles a fait partie de Coexister pendant deux ans où elle a pu mettre à profit ses compétences en tissant de nombreux partenariats avec la galaxie interreligieuse française, européenne et internationale. Ce 8 juin, Mahmoud nous emmène donc vers le vaste bureau du grand imam, qu'on appelle aussi le cheikh. Celui-ci se tient droit dans son vêtement traditionnel d'imam de la plus vieille université du monde. Elle précède de trois siècles l'université de Bologne, première université chrétienne et occidentale. Entouré de ses conseillers, le cheikh est tout sourire. Les femmes et les hommes du groupe peuvent aller lui adresser quelques mots, introduits par Mahmoud Azab. Ahmed el-Tayeb connaît parfaitement le français qu'il a étudié à la Sorbonne jusqu'en 1989 avant de revenir en Égypte à la faculté d'études islamiques en 1990.
Lors de notre rencontre, je souhaite poser une question qui me tient très à cœur. Militant pour l'égalité des droits avec les Français musulmans, souvent discriminés à l'embauche à cause du voile ou d'un nom arabophone, j'ai pris part à la lutte contre l'islamophobie française depuis plusieurs années. Je trouve scandaleux la façon dont le rejet de l'islam est souvent considéré comme une simple opinion, alors qu'il s'agit ni plus ni moins d'un délit dans le droit français. Je m'appuie pour cela sur l'article 9 de la Charte européenne des Droits de l'Homme : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. » Dans ce combat de destruction des préjugés à l'égard des musulmans, je suis surpris de trouver parfois des musulmans parmi les détracteurs. Ceux-ci estiment qu'ils n'ont pas besoin d'un Blanc et d'un chrétien pour se défendre. Je n'ai jamais su quoi répondre à cette objection. Je l'expose donc au cours de l'entretien. Mahmoud, en présence de Ahmed el-Tayeb, me répond : « Ceux qui vous incriminent parce que vous défendez les droits des Français musulmans alors que vous n'êtes pas musulmans vous-même n'ont rien compris aux principes du combat pour la justice. Si vos intentions sont pures et gratuites, Dieu le sait et vous rétribuera. Pour le reste, vous êtes chrétien, vous avez le Christ, alors mettez-le devant vous et marchez à sa suite. » Cette phrase venant d'un conseiller d'al-Azhar me cloue pendant de longues heures. Cette invitation de Mahmoud Azab est le signe d'une très grande estime à l'égard de ma foi. Il ne la partage pas mais il la respecte parce que c'est la mienne.
Après dix jours en Égypte, il est temps de rentrer en France pour préparer le grand départ vers Tel Aviv fixé au 1er juillet. Pendant ce séjour au pays des pharaons, l'un des pays les plus insalubres du monde, je ressens les premiers symptômes d'une infection que je crois passagère. Dans l'avion du retour, je pense à Josselin et Ilan restés en France. Je suis impatient de tirer des conclusions de cette première exploration pour préparer au mieux les séjours dans les trente-neuf autres pays qui nous attendent.
![]()
Chapitre 2
La Terre Sainte
Israël, Palestine
Nous sommes le 1er juillet 2013, il est 13 heures, je prépare mon sac en une petite heure que je filme avec notre nouvelle caméra acquise pour le projet. Cela me permettra de réaliser une vidéo en accéléré. Ce soir nous avons rendez-vous à 20 heures avec tous nos amis et famille à l'auberge de jeunesse Adveniat, rue François Ier dans le 8e arrondissement. Demain matin à l'aube, nous avons un avion pour Tel Aviv. Tout est prêt, enfin presque : il ne reste plus qu'à faire le grand saut. En cherchant dans mes souvenirs, c'est ce 1er juillet que j'ai rédigé un petit texte, « Mon sentiment avant de faire le tour du monde », dont voici un extrait :
« À la question, légitimement posée par mes amis, de savoir dans quel état d'esprit j'étais avant de faire le tour du monde, je n'ai pas su répondre grand-chose d'autre que “tout allait bien”. Tout bien réfléchi, avec quelques jours de plus et une propulsion plus effective dans cet avion supersonique qu'est un tour du monde, il me vient pêle-mêle les sentiments suivants : Une joie. Celle de constater la croissance de Coexister l'année avant mon départ. Une association qui compte aujourd'hui trois cents militants sur une dizaine de groupes au lieu de onze militants et un groupe il y a encore quatre ans. Un budget qui a été multiplié par dix, des salariés, des volontaires en service civique, des locaux dans cinq villes en France. Tout cela au prix d'une très grande fatigue, et parfois aussi d'une certaine usure, un réel épuisement. [...] Mais une croissance qui répond à un besoin. La conviction profonde de répondre à une vocation personnelle. La force de patienter, attendre des jours meilleurs pour voir que ces jours arrivent toujours à la fin. Coexister affiche une très belle croissance en quantité qu'il faudra à présent doubler d'une croissance en qualité. [...] Un soulagement. Celui de voir que le comité exécutif de Coexister, l'équipe nationale et les comités de pilotage gagnent constamment en autonomie. La transmission des savoirs et des compétences se développe avec beaucoup de talent dans notre mouvement qui a aussi encore tant à apprendre. Une récente rencontre. Celle d'Atef. La rencontre de l'année ! Un ami, un frère, un compagnon de lutte. Une amitié aussi improbable que celle de Paris et Marseille. Quelqu'un avec qui j'ai compris (et il était temps) qu'il y a des choses qui se vivent et qui ne se disent pas. De l'indicible qu'il vaut mieux parfois taire. Bref. Un « bienveillant » dans le sens le plus noble du terme. Une impatience. Celle de découvrir les alter ego de Coexister dans le monde entier, nos âmes sœurs associatives. Peut-être parfois des surprises inattendues. Des mouvements de jeunes agissant avec la même ferveur et les mêmes difficultés au fin fond du Viêt-nam ou du Burkina ? Une inquiétude. Une très grande inquiétude. Celle de la montée de l'islamophobie en France. C'est peut-être idiot mais c'est probablement la seule chose qui a failli me retenir à la maison. Ma famille, mes amis, mes frères, la vie en France m'attendent. Je compte les jours avant de les retrouver. Mais le racisme n'attend pas pour grandir et se répandre dans les esprits comme un poison qu'on ne peut plus arrêter. Le sentiment de peur qui se transforme à bien des égards en sentiment de haine vis-à-vis de nos concitoyens musulmans est une réalité extrêmement grave. Il faudra compter sur les énergies de tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté pour y faire face avec confiance et dignité. Derrière ce rejet apparemment naturel pour certains, ce sont des victimes croissantes. Quand ces victimes ne sont, grâce à Dieu, pas physiques, elles le sont psychologiquement et moralement. Il y a urgence. Une espérance. Celle de voir l'Observatoire de la laïcité, et son président Jean-Louis Bianco, travailler avec vigueur vers un respect toujours plus grand de la loi de 1905 et de ses fondements garantissant la liberté religieuse et la liberté de conscience. Un observatoire qui, malgré les doutes qu'il peut susciter quant à sa composition, vient de publier un rapport d'étape extrêmement positif. Il n'hésite pas à remettre en cause l'idée d'une loi. Loi qui serait inutilement stigmatisante une fois encore. Peut-être que dans le cadre de sa grande consultation, Jean-Louis Bianco enracinera ses convictions sur le terreau d'une laïcité ouverte et respectueuse. Enfin, un défi. Celui de partir avec une équipe de cinq jeunes et de revenir avec une équipe de cinq jeunes. Celui de retrouver Coexister en meilleur état encore que celui dans lequel je l'ai laissé. Celui de lâcher prise, surtout dans l'avion (mes amis comprendront pourquoi). Celui de remplir la mission que Sparknews{5} et Coexister ont confiée à InterFaith Tour : créer du lien entre les organisations interreligieuses, rapporter du contenu pédagogique, sensibiliser à l'urgence du vivre-ensemble sur Internet et dans les médias. Grâce à vous et grâce à Dieu, c'est surtout confiant et heureux que je pars réaliser cette première édition du tour du monde des initiatives interreligieuses par une équipe interreligieuse. J'emporte avec moi un petit bout de vos messages, textos, mails, inbox et sourires pour ceux qui étaient là au pot de départ ! Merci de ce que vous êtes pour moi. »
Ce 1er juillet, j'achève de remplir ceux qui seront mes deux plus fidèles compagnons : mon sac avant et mon sac arrière. Devant : un appareil photo Canon, faisant office de caméra, des tonnes de câbles, un ordinateur, un iPad, des disques durs, du matériel d'entretien informatique, un bloc-notes, de quoi écrire, ma Bible, mon chapelet. Derrière : des vêtements pour être en autonomie sans machine ni lessive jusqu'à quinze jours, le minimum de pharmacie, le minimum hygiénique pour se laver et se sécher, un set pour manger mais surtout aucun objet de valeur. Le sac avant reste avec moi en cabine et le sac arrière séjourne en soute. Demain, ce sera le grand plongeon, à la fois en Israël, en Palestine, en Terre sainte, en zone de conflit, en lieu de crispation. De nouveau au Moyen-Orient.
En Israël et en Palestine, comme en Égypte le mois dernier, nous sommes accompagnés par un groupe d'une vingtaine de jeunes. Ils sont avec nous du 3 au 13 juillet. En arrivant à Tel Aviv, nous nous donnons 48 heures pour repérer quelques points clés de la ville et les lieux de rendez-vous fixés avec nos interlocuteurs. À l'aéroport Ben-Gourion, nous passons tous la frontière sans encombre à l'exception d'Ismaël, que le nom et le faciès arabes conduisent à subir un interrogatoire de trois heures dans une salle en sous-sol. De mon côté, je suis attendu à la sortie de l'avion, devant la porte même de l'appareil, par trois agents de police qui tiennent à la main une feuille avec ma photo. « Quel est votre métier ? Où allez-vous en Israël ? Qui c...