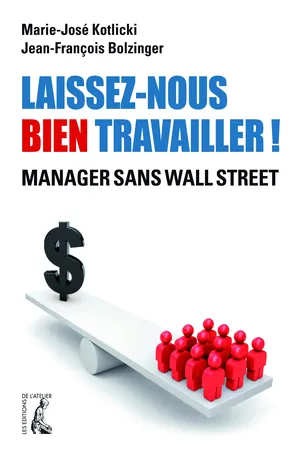![]()
Première partie
Les fondements d'un autre management
De la même façon que le travail réel est très différent du travail prescrit, nombre de pratiques prennent leurs distances avec le Wall Street management et démontrent leur efficacité. La crise nourrit ainsi également des réflexions, des recherches et des expériences qui plaident pour l'idée selon laquelle sortir du Wall Street management n'est plus utopique et devient même salutaire.
Ces expériences concernent les entreprises quel que soit leur statut et constituent des éléments de transformation en profondeur de l'ensemble de l'économie qu'on peut déceler aujourd'hui :
– des pratiques de management coopératif portent de nouvelles logiques de management aussi bien dans l'économie sociale que dans l'économie traditionnelle ;
– de nouvelles visions de l'entreprise émergent, mettant en cause la seule gouvernance actionnariale ;
– dans le travail même, l'évaluation et le bien-être au travail, questions souvent conflictuelles, amènent de plus en plus d'acteurs à intervenir ;
– au cœur des évolutions d'entreprises, de nouvelles appréhensions des restructurations tentent de voir le jour ;
– dans l'enseignement du management, certains dogmes établis sont ébranlés.
Les fondements d'un management alternatif existent bel et bien.
![]()
Chapitre I
Management coopératif : l'émergence de nouvelles logiques de management
Comment se dégager de la contrainte court-termiste à la source du Wall Street management ? L'une des issues porteuses d'alternatives réside dans le fait de se soustraire à la logique capitaliste de la société anonyme pour mettre en place d'autres formes de propriétés, telles celles que prône l'économie sociale : coopératives, mutuelles, Scop. Depuis 2008, des questions sur la résistance de ces formes d'entreprises à la crise sont régulièrement posées dans les médias économiques les plus sérieux. Toutes n'appartiennent pas à l'économie sociale{7}. Si les mutuelles se positionnent essentiellement sur ce tiers-secteur, comme la Macif, la Maif ou encore les CE, les coopératives sont présentes dans toutes les branches d'activité. On y trouve aussi bien la coopérative bio à vocation locale, le Crédit agricole, le puissant mais très discret groupe agroalimentaire coopératif Maïsadour, que les hypermarchés Leclerc. Quant aux Scop, elles constellent l'ensemble de l'économie : les biotechnologies, comme PARIS Anticorps ; la métallurgie spécialisée, comme les Aciéries de Ploërmel ; le conseil en insertion, comme Régat ; la fabrication d'isolateurs électriques à haute résistance, comme la célèbre CERALEP SN ; ou encore la Parisienne COPANAME, une coopérative d'activités et d'emplois, sans oublier le Groupe Chèque Déjeuner.
Certes, la forme de propriété n'induit pas forcément, comme nous le verrons, un management et une organisation spécifiques, mais force est de constater que la très grande majorité des Scop maintient certaines valeurs majeures du travail et résisterait mieux à la crise tout en appliquant un type de « management coopératif ». Leur poids économique n'est pas anecdotique. Fin 2011, la Confédération générale des Scop (CGSCOP) recensait 2 046 coopératives adhérentes, soit 42 000 salariés, et près de 200 avaient été créés en un an. Un chiffre conforme à la moyenne des années précédentes, mais nettement supérieur aux créations enregistrées avant 2007 (120 à 150). Leur chiffre d'affaires s'élève à 3,7 milliards d'euros.
Le regard amusé que portaient les politiques et les professionnels sur ce secteur de l'économie est en train de changer : on y cherche maintenant des réponses à la crise. L'épisode de la reprise de Sea France, société de transport transmanche filiale de la SNCF, avec la création d'une Scop et la préservation envisagée de 500 emplois, ne fait que confirmer le questionnement général sur les paradigmes de l'économie{8}. De folklorique, la reprise de l'entreprise par ses salariés rassemblés dans une Scop est devenue une hypothèse crédible et la Scop n'a pas été écartée du revers de la main, comme une utopie décalée.
Les sources d'un management alternatif
Les Scop ignorent, par leurs statuts, la priorité de la rentabilité immédiate due aux actionnaires. Elles privilégient la pérennité de l'emploi à long terme, souvent appuyée sur le développement d'un management participatif qui semble leur réussir. L'explication tient dans la spécificité de leur fonctionnement, dont la doctrine fondamentale peut se résumer ainsi : un homme égal une voix. Pour qu'une Scop existe, il faut qu'elle rassemble les salariés qui sont associés majoritaires et doivent détenir au moins 51 % du capital. Ils élisent leurs dirigeants directeur général, gérant, président du conseil d'administration. Ils peuvent aussi les révoquer. Les statuts d'une Scop prévoient que 16 % au minimum des bénéfices sont impartageables et réinvestis dans le développement, que 33 % des dividendes sont réservés aux associés (10 % dans la réalité en moyenne) et 25 % à tous les salariés. Les réserves sont définitives et vont consolider les fonds propres.
En fondant son existence sur l'association des salariés, une autre voie entrepreneuriale devient possible, avec pour point fort leur participation aux décisions portant sur la vie et la stratégie de l'entreprise. Si s'appuyer sur la participation des salariés aux décisions et l'éloignement de la notion de profit immédiat sont des atouts, alors pourquoi ce management coopératif ne s'est-il pas développé dans un certain secteur qui n'est pas, lui non plus, lié à la rentabilité : le secteur public avec ses entreprises et les trois versants de la fonction publique ? Pourquoi le Wall Street management y domine-t-il, si ce n'est que par volonté idéologique ?
Ces axes forts que sont l'association des salariés aux décisions et à la propriété de l'outil de travail et le lien social ont été travaillés dans le système des Scop et ont abouti à une certaine réussite sociale et économique. Mais la forme juridique n'est pas l'unique élément déterminant. Les innovations portées par les Scop peuvent également être à la source d'un management alternatif dans des entreprises qui ne procèdent pas de l'économie sociale et solidaire, avec des réponses adaptées au cas par cas.
Le développement d'un management coopératif pourrait déjà s'étendre au sein même de l'économie sociale, de plus en plus en concurrence avec l'économie traditionnelle, notamment dans le domaine des services. Trop souvent, sous prétexte d'être soumis à la concurrence et considérant plus l'économie sociale comme un alibi, des entreprises de ce secteur adoptent les modes de management les plus traditionnels. Cela ne va pas sans susciter la colère des salariés, qui voient se détricoter le sens même de leur travail. « Une entreprise de l'économie sociale est une entreprise avant tout, aimait à affirmer le secrétaire d'un grand CE national, et j'ai une armoire pleine de recours aux prud'hommes ! » Tristes trophées, car sous prétexte « qu'on est entre nous », la brutalité du management met les salariés en porte-à-faux. Ce constat n'est malheureusement pas marginal. Entre tentations libérales effrénées et invectives crypto-fourrieristes, l'échange tourne vite au dialogue de sourds dans les colloques et autres forums.
Les mutuelles doivent elles aussi affronter la concurrence des assurances. Celle-ci est d'autant plus féroce que les règles fiscales s'harmonisent ; au nom du dogme de la concurrence libre et non faussée, les conditions spécifiques dont bénéficiait ce secteur de l'économie sociale ont été supprimées par l'Union européenne. Cet alignement sur les règles néolibérales a été accentué par un phénomène générationnel. De jeunes diplômés formés aux meilleures écoles de marketing et de management ont été recrutés par les grandes institutions mutualistes, provoquant souvent au sein des services des tensions démotivantes et des conflits d'éthique essentiels. La mission de ces mutuelles est fondée sur la mise en commun de moyens en vue de répondre à des besoins humains sans but lucratif. Elle se voit percutée de plein fouet par les critères de rentabilité d'un Wall Street management confondant des notions aussi différentes que celles de client et de sociétaire.
Des spécificités garantes de la qualité
Devant ces mutations, l'économie sociale se retrouve face à un dilemme : résister et affirmer ses principes, au risque de réussir, ou se soumettre à la règle générale et tout y perdre. Avant la crise de 2008, l'économie sociale devait se fondre dans le modèle néolibéral dominant. Mais aujourd'hui, avec la montée du doute sur l'efficacité de cette économie hyperconcurrentielle, une opportunité se présente : jouer la spécificité, la qualité et le service n'est plus un pari perdu d'avance. La prise de risques de l'affirmation de l'identité est cohérente, même dans la bataille pour des parts de marché. La qualité se fonde aussi sur les atouts et pas forcément sur la marque. Voici que les lignes bougent là où, parfois, on ne s'y attendait pas...
Ainsi, l'initiative récente de mécénat interne du Groupe Matelson dépasse l'exercice de communication, bien que l'on manque encore de retour sur expérience de la part des salariés. Après avoir racheté la Camif et emménagé à Niort, il élabore une nouvelle stratégie industrielle et propose d'accueillir au sein du siège social une artiste en résidence. En travaillant sur l'espace et la matérialisation graphique, au sol, des déplacements des salariés, la jeune artiste Anne-Laure Maison{9} met au jour un élément décisif des relations de travail et contribue, par ce repère, à créer du lien entre les anciens de la Camif, avec leurs savoir-faire spécifiques, et les jeunes arrivants, dont beaucoup interviennent au sein du nouveau service informatique high-tech. D'après la direction, les résultats dépassent les espérances. En accueillant cette artiste, la direction pose la question inattendue des relations entre l'art et le travail, la culture et le management. En parallèle, la stratégie industrielle évolue. Le choix est fait de s'approvisionner auprès de fournisseurs de mobilier de qualité élaboré en France, une attention toute particulière est portée au respect des délais de livraison. Cette expérience au sein d'une entreprise qui a vécu une crise économique et sociale majeure procède de la recherche d'un modèle de développement durable, associée à la création d'une culture d'entreprise. Si le succès se confirme, la performance économique sera passée par une performance sociale.
Le rebond de Mauboussin : leçon de choses
De nouveaux modes de participation des salariés aux choix de la création collective existent aussi dans le privé. L'histoire de l'entreprise Mauboussin est singulière en ce qu'elle dessine le contenu d'un management alternatif articulant association des salariés, rupture avec des logiques court-termistes et rebond économique.
En 2005, l'entreprise de joaillerie de luxe est menacée de fermeture avec plus de 100 millions d'euros de déficit et une activité en déclin suite au départ de son plus gros client, le sultan de Brunei. L'arrivée d'Alain Némarq en tant que président-directeur général et d'un nouveau propriétaire, Dominique Frémont, change la donne.
Le premier acte de cette histoire ressemble au scénario de crise habituel : un plan de suppressions d'emplois s'annonce, ramenant les effectifs d'une centaine à une vingtaine. Jusque-là, rien de nouveau à l'horizon ; les salariés restent la variable d'ajustement. Le deuxième acte est plus original : une charte d'engagement sur les moyen et long termes est rédigée.
Malgré le déficit de 100 millions d'euros, un nouvel apport est demandé aux actionnaires. De plus, en échange d'une nouvelle stratégie créatrice de l'entreprise et d'un pari sur les moyen et long termes, il leur est demandé de renoncer à tous dividendes pendant cinq ans. Interrogé sur la réaction des actionnaires et sur cette nouvelle forme de rupture avec la financiarisation cour-termiste, Alain Némarq répond :
« J'ai eu face à moi des actionnaires qui sans être de la famille Mauboussin ont fait le choix de la prise de risque réelle, de la confiance dans l'innovation et la créativité, bref des actionnaires plus “passion” que financiers. »
La notion d'engagement de tous les acteurs de l'entreprise est d'ailleurs la condition nécessaire pour une réussite économique. Selon Alain Némarq :
« Dans une entreprise, l'imagination doit être au pouvoir et se décline en trois aspects : la capacité d'imaginer, l'innovation créatrice, l'audace ; le questionnement du métier et des ruptures dans une stratégie de reproduction ; l'engagement maximum de tous les acteurs de l'entreprise. Encore ne faut-il pas seulement adhérer aux valeurs créatrices de l'entreprise, mais y participer. »
C'est pourquoi les actionnaires doivent en premier lieu contribuer avec un engagement capitalistique mobilisé le temps des projets de l'entreprise. Les salariés, quant à eux, doivent pouvoir s'exprimer sur leur travail et oser le faire ; le management doit y être particulièrement attentif pour mobiliser les compétences.
Le troisième acte de l'histoire s'adresse aux salariés en les associant très étroitement aux choix d'innovation de l'entreprise. La charte tacite d'engagement « passion » des actionnaires s'accompagne ainsi de l'association des salariés aux choix stratégiques de l'entreprise à travers la prise en compte de leurs avis sur le lancement d'un nouveau produit. Alain Némarq déclare :
« Ce mode démocratique de la création dans la consultation, jusqu'au vote systématique des 193 salariés de Mauboussin sur chaque sortie d'un bijou, est le seul effet tamis sur ce que je crée. Un bijou qui ne recueille pas l'approbation des salariés n'est pas commercialisé. »
L'avis des salariés – en très grande majorité des femmes – fait loi dans la décision finale, et leur participation dans les boutiques de vente devient un atout essentiel dans la réussite commerciale de nouveaux bijoux. La connaissance du métier, le référent que ces salariés constituent par rapport à la clientèle est une richesse pour l'entreprise, à condition qu'elle puisse s'expr...