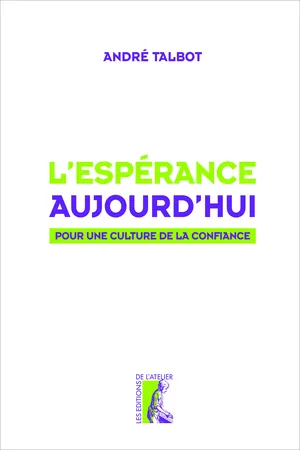![]()
Chapitre 1
Fragiles. De la naïveté à la confiance
Il peut paraître inconvenant d'évoquer d'entrée de jeu la condition humaine en parlant de fragilité. Une telle évocation provoque un malaise, d'une part parce qu'on attend de chacun qu'il affiche une image de réussite ou de bonheur, d'autre part parce que notre monde valorise d'abord la puissance et la force. Pourtant, la vie d'un être humain comprend toujours une expérience de limite, de faiblesse, et même de souffrance. On pense spontanément au handicap, à la maladie, à la pauvreté, aux difficultés psychiques. De tels rapports intimes à la fragilité, dans nos vies et dans celles de nos proches, se croisent avec la précarité de nos projets familiaux, sociaux, économiques, politiques... Les institutions elles-mêmes, des plus proches au plus larges, manifestent aujourd'hui des signes de faiblesse. Et, au bout du compte, il nous faut bien admettre que nous sommes mortels : voilà l'extrême limite avec laquelle nous ne pouvons tricher.
Or, le déni culturel de nos faiblesses vient souvent redoubler notre souffrance : nous avons l'impression d'altérer l'image de réussite qui est attendue de notre part, voire de projeter une onde négative dans un océan de bonheur obligatoire. Pourtant, il vaut mieux aborder notre vie humaine sous le signe de la lucidité : oui, nous sommes faillibles ; oui, nous sommes mortels. Ce regard clairvoyant comporte cependant une bonne nouvelle : nous pouvons trouver du sens à nous soutenir mutuellement dans la vie et à faire alliance avec les autres ! Mais, avant de montrer les couleurs de cette bonne nouvelle, interrogeons la culture dont nous héritons, notamment à propos de notre liberté de jugement, de notre rapport à la force et à la puissance.
Un principe de liberté et d'autonomie
Les idées « modernes », dont nous sommes les héritiers et qui ont pris corps à partir du XVIe siècle, mettent en avant l'individu et son autonomie de décision. À ce titre, les différentes formes de soumission, tant à l'égard de forces supérieures que d'autorités traditionnelles, se trouvent disqualifiées. L'individu ne reconnaît comme règle valide que celle qu'il se donne, à la manière de ce tout jeune enfant qui refuse de donner la main à l'adulte, mais qui s'impose à lui-même de marcher sur la ligne blanche de la rue. Le projet de favoriser l'autonomie d'autrui apparaît également comme une exigence morale de respect à l'égard de celui qui, d'une manière ou l'autre, se trouve effectivement dépendant de ses semblables. On veut ainsi permettre à chacun de maintenir ou de développer ses capacités de liberté et de responsabilité, même si l'âge ou d'autres difficultés constituent des obstacles. Mais le principe d'autonomie individuelle, considéré comme un absolu, risque de conduire à l'autosuffisance, au point que chacun n'attend plus rien de ses semblables.
L'époque moderne représente de toute évidence un temps de conquête de nouvelles libertés. Quant aux sociétés d'antan, elles sont qualifiées d'holistiques en ce sens que le collectif l'emportait à un point tel que l'individu était simplement considéré comme un rouage du grand ensemble. Aujourd'hui, la personne humaine revendique d'être reconnue comme telle, en sa singularité. Mais la liberté comprise comme autosuffisance peut être trompeuse si elle ignore la fragilité native de l'humain. Ne serait-ce pas le signe d'une naïveté qui ne prépare guère l'être humain à faire face aux inévitables difficultés de l'existence ? Cette naïveté devient coupable si elle prétend qu'il n'y a plus aujourd'hui aucune emprise ou domination sur les individus et que chacun peut déployer une liberté sans entrave. Elle devient perverse si elle suggère au chômeur ou à celui qui se trouve en marge de la société qu'il est lui-même la première cause de son échec. De plus, une telle mise en valeur – à juste titre – de la responsabilité personnelle, si elle ignore le contexte social du déploiement de la liberté humaine, légitime un monde de concurrence généralisée dans lequel l'alliance fraternelle n'a plus aucun sens.
La méconnaissance des fragilités, associée à la mésestime des solidarités, produit un monde dur qui épuise les personnes et disloque la société. La revendication de liberté devient trompeuse si elle conduit à mépriser le faible et à sacrifier la vie commune. Un regard sur l'histoire récente des libertés peut être instructif.
Une liberté conditionnelle
Comment ces notions de liberté et d'autonomie ont-elles influencé la vie concrète de la population dans la dernière moitié du XXe siècle ? À l'époque de l'après-guerre, les marges de liberté demeuraient réduites. Pour des raisons économiques, mais aussi idéologiques et culturelles, la voie d'avenir de nombreux jeunes était tracée d'avance. Les femmes, elles, portaient de multiples contraintes liées au travail, à l'entretien de la maison, aux maternités. Quant au lot habituel de l'homme adulte, c'était fréquemment une usure physique prématurée ; nombreux étaient ceux, parmi les ouvriers et les agriculteurs, qui décédaient avant l'âge de la retraite. Il y avait aussi une pression sociale, un regard prégnant sur la vie des autres, qui limitait fortement la liberté de choix personnel. Un signe tragique de cette surveillance mutuelle : durant la Seconde Guerre mondiale et l'Occupation, certains épiaient leurs voisins et leurs dénonciations, souvent anonymes, facilitaient le travail abominable des polices.
On ne peut ignorer les difficultés de la vie hier, même s'il est de bon ton d'organiser des « fêtes d'antan », à la manière d'un folklore nostalgique. Il se pourrait bien que ces moments festifs servent à exorciser ce temps ancien pourtant si proche et à recouvrir des souvenirs plus douloureux. Sans doute aussi dessine-t-on en creux les désillusions actuelles : les promesses modernes d'un mieux-vivre pour tous n'ont été que très partiellement tenues. Ceux qui ne voient en autrefois que le bon temps passé ne l'ont pas connu ou font preuve d'une belle faculté d'oubli. Mais ceux qui présentent la période actuelle sous les traits de la liberté et de la félicité se trouvent sûrement dans une bulle qui les isole de l'histoire concrète et des souffrances de leurs contemporains.
Certes, les évolutions de la dernière moitié du XXe siècle ont ouvert de nouveaux espaces de liberté. Mais il faut aujourd'hui travailler à décrypter les formes plus subtiles d'emprise et de soumission qui se sont installées. Dans le monde des médias et de la publicité, beaucoup s'intéressent à notre « part de cerveau disponible » pour mieux nous vendre des biens parfois peu utiles ou des slogans intéressés ; l'information ou la culture ne sont alors que des prétextes pour glisser de la « réclame », comme on disait autrefois. Quant au cercle en expansion des communicants, il s'emploie à nous coller des « éléments de langage » politiques ou institutionnels ; il est parfois risible – et fort triste – d'entendre des responsables réciter leur fiche avec plus ou moins d'élégance.
Le rapport de marchand à client tend à devenir le modèle type de l'ensemble des relations humaines ; les populations sont découpées en « cibles » que l'on va chercher à capter. Il faut considérer, pour ce qu'il est, ce discours qui révèle des stratégies d'emprise, même s'il le chante sur des airs de liberté : l'humain ne peut être intéressant que s'il représente un client potentiel, un électeur futur ou un relais d'opinion. En ce sens, il devient inquiétant de voir des organisations non gouvernementales (ONG) humanitaires chercher à capter notre générosité par des pratiques du même type : le slogan qui suscite l'émotion, la culpabilité qui provoque le don. Pour un esprit marchand, même notre altruisme devient une cible. Ces stratégies mercantiles oublient de nous informer, ne font pas grand cas de notre jugement moral, contournent notre liberté responsable.
La quête de liberté et d'autonomie peut servir le développement personnel, mais elle peut faire illusion si elle masque les contraintes d'aujourd'hui, si elle prétend en finir avec les fragilités. Or, la vie de l'homme moderne n'est pas de tout repos ; il doit demeurer en alerte pour déjouer les pièges de tous ceux qui prétendent faire son bien, mais qui cherchent avant tout à amplifier leur pouvoir et à élargir leur marché. Des sentiments humains fort nobles tels que la sensibilité, le goût du beau et le souci de soulager la misère peuvent être exploités comme autant de « faiblesses » qui permettent une emprise sur les choix d'une personne. Il nous faut sans cesse réapprendre la résistance si nous tenons à nos libertés et à notre jugement en conscience. Aujourd'hui, les maîtres d'opinion s'avancent masqués et osent même se présenter comme des bienfaiteurs ; ils prétendent connaître les désirs les plus profonds de ce qu'ils nomment « le public » et disposent toujours d'un sondage qui est censé apporter la caution « scientifique » à leurs dires.
Un monde d'images
La liberté personnelle s'inscrit dans une vie sociale qui tend à devenir une scène sur laquelle chacun doit jouer des rôles variés. Par exemple, pour des trentenaires, il faut apprendre à conjuguer des fonctions très différentes : le professionnel, le parent d'élève, l'animateur de sport et le citoyen ont parfois du mal à cohabiter dans la même personne et à faire bon ménage avec la vie de famille... Aussi la vie personnelle semble-t-elle éclatée entre des images contrastées et des contraintes variées, au point qu'on ne sait plus bien ce qui est le plus important. Comment investir sa liberté en donnant sens à sa vie lorsque l'on est écartelé entre des rôles sociaux disparates ? On peut s'épuiser à concilier des images publiques éclatées et à devoir faire bonne figure dans tous les cas, au point d'oublier les enjeux profonds de notre existence personnelle et commune. Dans un tel contexte, où, quand, et avec qui peut-on évoquer ses fragilités ?
La situation est d'autant plus délicate que, dans ce jeu théâtralisé, les institutions de référence et les religions elles-mêmes ne semblent guère apporter de soutien. Elles paraissent en décalage face aux attentes actuelles et on les soupçonne même de vouloir tirer profit des faiblesses humaines. En valorisant un salut transcendant, les religions ne viendraient-elles pas présenter le monde céleste comme une compensation de la misère terrestre ? En abaissant l'humain, elles s'imaginent parfois grandir le divin : querelle d'images ! Pourtant, elles disposent de ressources pour aider à discerner ce qui est porteur de vie et à promouvoir des solidarités fraternelles.
Les héritages religieux ont pu tirer argument de la fragilité pour disqualifier la responsabilité humaine. Dans la Bible, de manière imagée, les Psaumes dénoncent la vanité des idoles et l'illusion de se fier aux créatures. Une telle mise en garde demeure salutaire, sinon l'humain peut devenir esclave d'images trompeuses, de biens possédés, de dominations subies ou exercées. Mais on trouve aussi des Psaumes qui disent la grandeur de l'homme tout en s'adressant à Dieu : « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fis d'un homme, que tu en prennes souci ? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ; tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds » (Psaume VIII). Cette grandeur humaine n'est pourtant pas sans danger, notre mémoire collective porte le souvenir d'usages dévoyés de la force.
L'histoire du XXe siècle nous a montré combien une idolâtrie de la puissance peut être destructrice si elle laisse libre cours à la haine de l'autre et à la pulsion de mort. On profite alors de la faiblesse des individus pour mieux les écraser. Mais l'histoire humaine ne se réduit pas à un déferlement de violence, sinon nous ne serions pas là pour en débattre... Il y a bien aussi en l'homme une capacité à résister au mal, une volonté de promouvoir une éthique de la dignité humaine{9}. Cependant, l'édiction d'un principe n'en garantit pas la réalisation : la Charte commune pour l'ensemble de l'humanité que représente la Déclaration universelle des droits de l'Homme appelle un travail continu d'interprétation. Il faut sans cesse vérifier la manière dont les droits énoncés se trouvent mis en œuvre, tout particulièrement à l'égard des personnes les plus fragiles, celles que l'on oublie parce que leur vie ne semble pas avoir d'importance. L'idéologie qui valorise la seule force peut être porteuse de mort, tandis que la prise en charge commune de nos fragilités peut donner sens à notre aventure humaine, si nous apprenons à respecter notre prochain d'abord en sa faiblesse. Plutôt que prolonger des oppositions désuètes, il vaut mieux discerner ensemble les enjeux humains qui appellent une mobilisation commune, en portant d'abord notre attention sur nos semblables les plus exposés aux difficultés de la vie.
Des tensions stériles
Quelles sont les ressources dont nous disposons pour promouvoir la vie d'un monde et d'une humanité que nous savons fragiles ? Une histoire française quelque peu caricaturale tend toujours à opposer les forces du progrès aux tenants de la tradition. Un tel dualisme conflictuel risque d'empêcher un honnête recours à la raison pour fonder la vie commune. Nous disposons pourtant d'un bel héritage : des sagesses, y compris religieuses, qui constituent une source permanente tandis que la pensée moderne, née à partir du XVIe siècle, représente aussi un moment fécond de notre patrimoine. Cet héritage complexe vient secouer nos paresses idéologiques et provoquer des remises en question. Il serait donc erroné de réduire la « tradition » à un bloc immuable et la pensée des Lumières à quelques thématiques ressassées. Au contraire, il est intéressant de remarquer comment le questionnement demeure continu, même s'il rencontre des résistances.
Un exemple peut montrer comment la peur de toute critique peut altérer la raison la plus élémentaire : ceux qui posent de bonnes questions à propos de la sûreté nucléaire ou de la gestion des déchets se trouvent plus d'une fois suspectés de vouloir « revenir à la bougie » ! La question énergétique, qui est de plus en plus vive, mérite des arguments plus élaborés ! On voit ainsi qu'une idéologie sûre d'elle-même, et disposant d'une réelle puissance, en vient parfois à dénaturer le débat rationnel.
Or, le regard lucide porté sur la fragilité et la critique d'une certaine image de la force risquent d'être disqualifiés si on les enferme dans le schéma « progrès versus tradition ». La méfiance peut redoubler si cette question est portée en milieu chrétien. En effet, le conflit entre esprit moderne et religions conduit parfois l'Église catholique à une attitude défensive, au risque qu'elle s'identifie au reflet caricatural qui lui est renvoyé et qu'elle en rajoute dans la nostalgie, voire dans la dénonciation du monde réel. Mais cette image d'un catholicisme crispé peut devenir elle-même passéiste. Un gros travail a été accompli dans l'après-guerre{10} pour mettre en lumière les capacités de l'intelligence et de la raison humaine. Il y a cinquante ans, le concile Vatican II, notamment par la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, a rappelé la volonté d'un dialogue et d'une collaboration sincère avec tous ceux qui travaillent à l'avenir du monde et de l'humanité.
Paradoxalement, l'Église risquerait aujourd'hui d'accueillir trop favorablement des pans ambigus de notre commune modernité. Les recherches actuelles concernant la prise en compte des fragilités suscitent parfois des questionnements, voire des réticences, y compris dans les milieux chrétiens. Pourtant, l'héritage biblique ne triche pas avec cette face de notre expérience humaine ; mais comment la comprendre avec justesse ? Une mise en perspective des propositions stimulantes de Dietrich Bonhoeffer permet d'avancer dans cette réflexion sur la fragilité humaine.
Une fragilité qui n'est pas que faiblesse
Le monde chrétien d'après-guerre, notamment en sa part catholique, fut marqué par l'influence d'un pasteur luthérien, Dietrich Bonhoeffer, exécuté par les nazis en 1945. Dans ses lettres de prison, publiées en français sous le titre Résistance et soumission{11}, il s'interroge sur la manière de parler de Dieu dans un monde sécularisé. Il refuse de considérer Dieu comme un deus ex machina, une sorte de « bouche-trou » appelé à la rescousse pour résoudre les problèmes insolubles et compenser les impuissances humaines. Il récuse un discours pieux qui ne voit en l'homme que faille et faiblesse.
« J'aimerais parler de Dieu non aux limites, mais au centre, non dans les faiblesses, mais dans la force, et donc n...