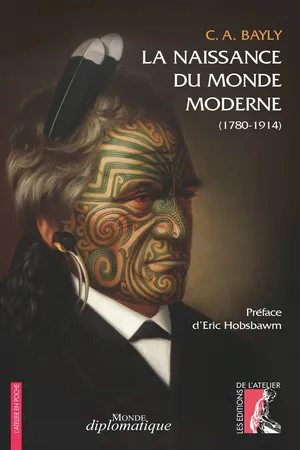![]()
Préface{1}
par Eric Hobsbawm{2}
Peu nombreux sont les ouvrages historiques qui font instantanément date. Dans le domaine en rapide expansion de l'histoire mondialisée c'est pourtant le cas du livre de Christopher Bayly, La Naissance du monde moderne, et ce depuis sa parution originale en langue anglaise en 2003. Il n'est pas excessif de prétendre qu'il a transformé la nature même de sa période – le « long dix-neuvième siècle », entre les révolutions de la fin du XVIIIe siècle et la Première Guerre mondiale – et de son sujet. Désormais, il constituera le point de départ obligé de tous les travaux sérieux et de tous les débats portant sur l'histoire du monde moderne.
L'essor, ou plutôt le retour d'une histoire du monde qui ne soit pas centrée sur la conquête du globe par les Européens (« l'expansion européenne » pour reprendre le titre des cours offerts par les universités britanniques sur la question) est un phénomène très récent. Il n'est pas antérieur aux années 1980, exception faite des efforts non aboutis consentis par l'UNESCO pour rédiger un ensemble de manuels historiques qui soient internationalement acceptables. La première revue savante, la seule jusqu'au XXIe siècle, couvrant ce domaine a été fondée en 1989. Trois changements survenus au cours de la deuxième moitié du XXe siècle peuvent contribuer à expliquer cet état de fait : l'effondrement généralisé des empires européens d'outre-mer durant les trente années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale ; la révolution des transports et des communications qui a accéléré la mondialisation dans les domaines intellectuels et économiques ; et, plus récemment, le spectaculaire déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale des États situés de chaque côté de l'Atlantique Nord vers les régions de civilisation ancienne de l'Asie du Sud et de l'Est. La montée en puissance des États-Unis en tant que superpuissance impériale possédant des intérêts dans toutes les parties du monde a également stimulé le développement d'une nouvelle histoire mondiale. En réalité, c'est d'abord aux États-Unis que le sujet a fait l'objet de travaux, par l'intermédiaire de chercheurs travaillant dans les universités de ce pays.
Le principal obstacle se dressant sur la voie d'une histoire mondialisée est l'idée bien ancrée d'une supériorité européenne (ou, pour parler comme les Américains, « occidentale ») due à la nature exceptionnelle des sociétés qui se sont développées en Europe depuis l'Antiquité classique. On partait avec l'idée que cela faisait de l'Europe la source unique de toute croissance historique dynamique, du changement et des progrès scientifiques et techniques, et par conséquent de valeurs morales et d'institutions supérieures, contrairement aux autres parties du monde qui étaient caractérisées par une stagnation permanente et des cycles voués à se répéter à l'infini, même dans le cas de celles dont le haut degré de civilisation ne pouvait être nié, comme par exemple la Chine. Cette supériorité, disait-on, avait permis aux Européens de dominer le monde, et grâce à leurs idées, à leur économie conquérante et à leurs institutions, de le transformer. Cela servait aussi d'alibi à leur domination. Cela leur donnait à coup sûr « le droit et le devoir unilatéralement proclamés de faire connaître et de répandre activement [leurs] propres normes et institutions parmi d'autres peuples et dans d'autres sociétés, avec la ferme conviction de la supériorité inhérente et du haut degré de légitimité{3} » du mode de vie occidental ; il s'agissait en somme d'une « destinée manifeste », ou d'une mission « civilisatrice », pouvant être imposée le cas échéant par la force armée et par une occupation militaire. Le concept de « civilisation » devint ainsi synonyme de « civilisation occidentale ». Ce sentiment de supériorité allait perdurer longtemps après le déclin de la puissance impériale des Européens, et pas seulement au Moyen-Orient{4}.
L'idéologie et la supériorité matérielle qui ont permis ensemble aux Européens de se considérer (à la fois dans leurs propres pays et à l'étranger) comme les « seigneurs de l'espèce humaine » (pour reprendre l'expression de V. G. Kiernan), sont d'origine relativement récente. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Européens ne disposaient pas des forces suffisantes pour occuper autre chose que quelques petites enclaves en lisière de la ceinture des civilisations anciennes allant des mers de Chine au Maghreb ; aussi l'Europe et l'Asie connaissaient-elles une sorte d'équilibre des forces au plan politique et culturel. Si l'on en croit les estimations proposées par Angus Maddison, en 1820 encore, le PIB total des économies occidentales, bien que comblant rapidement son retard, était toujours substantiellement inférieur à celui des économies asiatiques, tandis que le PIB de la Chine était encore supérieur à celui de l'Europe occidentale. Le PIB par habitant de l'Europe de l'Ouest avait commencé à dépasser celui des Chinois aux alentours du XIVe siècle, mais au XVIIIe siècle, l'écart restait comparativement limité. On pourrait ajouter qu'au XVIIIe siècle, un des éléments clef qui alimenta le racisme blanc, à savoir les phénomènes massifs d'immigration et de colonisation, était encore de faible ampleur, sauf en Amérique du Nord, et que les valeurs bourgeoises, une des composantes essentielles de la « mission civilisatrice », n'avaient pas encore acquis une dimension politique décisive. Les élites aristocratiques d'Ancien Régime ne voyaient aucune nécessité à civiliser des élites nobles et guerrières vaincues, socialement identifiables en tant que telles, et qui étaient les tenantes légitimes du pouvoir dans des sociétés hiérarchisées.
Il ne fait guère de doute qu'en l'espace d'une période relativement brève – plus brève que ce que l'on croit généralement – l'histoire du monde devint eurocentrée. Durant cette même période, qui est celle dont traite le livre de Christopher Bayly, La Naissance du monde moderne, la planète se trouva transformée. Tout ce qui depuis lors a fait que le monde d'aujourd'hui est différent du monde des Ming, de celui des empereurs moghols, ou encore de celui des Mamelouks, puise en partie son origine en Europe, que ce soit dans le domaine des sciences et de la technologie, celui de l'économie, de l'idéologie, de la politique, ou encore des institutions et des pratiques de la vie publique et privée. Mais le monde ne fut pas changé par des efforts unilatéraux. Il y a matière à plaider en faveur du caractère exceptionnel du développement historique de l'Europe en ce sens que le dynamisme européen, et non des développements inhérents aux autres sociétés, fut à l'origine de la transformation du monde. Il ne saurait par ailleurs être nié que la « modernité » fut, au sens propre comme au sens figuré, transmise au monde dans des habits occidentaux, dont l'adoption et l'adaptation généralisées par les élites mondiales sont analysées ici avec une très grande finesse.
La nouveauté de cette analyse d'ensemble magistrale tient dans trois thèses.
La première est que la domination exercée par les Européens sur le monde fut mise en place avant le moment (que l'on peut situer durant la deuxième moitié du XIXe siècle) où la supériorité occidentale en matière économique et technologique était devenue suffisamment avancée pour pouvoir l'expliquer. Avant 1850, la technologie n'avait pas encore apporté à l'Occident un avantage militaire décisif sur le reste du monde. L'auteur ne sous-estime pas l'avantage économique que le capitalisme occidental dynamique avait acquis au XVIIIe siècle à travers l'exploitation des ressources naturelles en Europe et en Amérique, et notamment grâce à la présence de charbon immédiatement utilisable ; pourtant, contrairement aux études pionnières, mais sinocentrées, de Pomeranz et Bin Wong, il se refuse à expliquer la « grande cassure » seulement en termes économiques{5}, préférant mettre en avant les spécificités sociales, institutionnelles et politiques qui permirent aux Européens d'accroître leur puissance dans l'arène mondiale, en particulier les formes d'organisation beaucoup plus efficaces dans la manière de faire la guerre. Selon ses propres termes, « les Européens devinrent rapidement les meilleurs dès lors qu'il s'agissait de tuer ». Dans la mesure où l'auteur est titulaire de la Chaire d'histoire impériale et navale à l'université de Cambridge, on ne sera pas surpris de voir qu'il met l'accent sur le rôle des différentes flottes, notamment celui joué par la force navale permanente et tournée vers le monde du pays qui allait devenir le plus grand empire de toute l'histoire.
La seconde thèse découle de la spécialisation personnelle de Bayly dans l'histoire de l'Inde. Il présente l'Inde du XVIIIe siècle non pas de la manière traditionnelle comme une société immuable au sein d'un empire moghol en déclin, prête à se laisser conquérir par une puissance étrangère, mais comme un sous-continent caractérisé par des innovations commerciales dynamiques, au sein duquel les intérêts commerciaux et urbains s'efforçaient de se forger des moyens propres pour faire face à l'instabilité politique de la région. Les Britanniques arrivèrent politiquement au pouvoir non pas en tant que conquérants venus d'outre-mer, mais plutôt au début comme partie intégrante de la tentative imaginée par certains Indiens de modifier le rapport des forces au niveau du sous-continent. Même après avoir été acceptée, la domination britannique dut continuer jusqu'à la fin de s'appuyer sur une combinaison de forces et de relais locaux, faisant que les Indiens acceptaient le raj {6} au nom de leurs intérêts propres. Plus généralement, la naissance du monde moderne ne fut pas quelque chose simplement imposé de l'extérieur par l'Occident, mais un processus complexe fait d'évolutions interagissant les unes avec les autres et émanant des deux côtés bien qu'à l'évidence dominé par la force des puissances impériales et par l'hégémonie du modèle occidental ; ce processus était également la seule manière de rendre les pays concernés suffisamment forts pour résister à la domination occidentale, avant finalement de s'en affranchir. Les peuples non européens s'approprièrent en les adaptant les outils politiques et idéologiques apportés par l'Occident. Bayly ne s'embarrasse pas avec les errements de l'histoire « postcoloniale ».
La troisième thèse, et en un sens la plus intéressante, est que durant la plus grande partie de la période allant de la moitié du XVIIIe siècle à la fin du XIXe, on vit se développer en Orient et Occident un cheminement étrangement similaire vers des formes transitoires de « modernisation ». Ainsi, l'auteur avance l'idée que durant cette période, la mondialisation d'ensembles cohérents de pratiques rituelles et idéologiques pour en faire des « religions universelles » à vocation missionnaire et extérieurement comparables fut aussi importante que la montée des sentiments nationalistes (déjà précédés par la formation d'identités collectives), ou encore du libéralisme. Après 1890 toutefois, la version moderne du capitalisme mondialisé (et, pourrait-on ajouter, l'essor et l'institutionnalisation de la politique de masse) condamna finalement ce qui avait subsisté de l'héritage des anciens régimes, tant en Europe que dans le reste du monde.
Indépendamment de la validité des thèses avancées par l'auteur, cet ouvrage apporte une démonstration brillante et convaincante de « la nature multipolaire du changement, même durant cette période de domination de l'Occident », mettant en évidence ses thèmes communs en Orient et en Occident, et par-dessus tout, le caractère interactif des événements et des évolutions survenus dans toutes les parties du monde. De ce fait, il sera dorénavant impossible d'écrire une histoire du monde moderne qui ne soit pas véritablement mondiale dans son dessein. Le fait que Bayly nous ait donné la première histoire qui réponde à ce critère donne la mesure de l'œuvre accomplie.
Londres, décembre 2006
![]()
Introduction
Ce livre se présente sous la forme d'une histoire thématique du monde qui couvre une période allant de 1780, début de l'Ère des révolutions, à 1914, date à laquelle éclate une Première Guerre mondiale qui va provoquer le démembrement du système contemporain des États et des empires. Il montre comment il est possible de rapprocher des évolutions historiques et des enchaînements d'événements traités indépendamment les uns des autres dans le cadre de travaux d'histoire nationale ou régionale. Ce faisant, il met en évidence l'existence à l'échelle planétaire de rapports et d'interdépendances relatifs à des changements politiques et sociaux qui ont très largement précédé le début d'une « mondialisation » dont on s'accorde à considérer qu'elle a débuté en 1945.
Non seulement les répercussions de certains événements décisifs, comme les révolutions européennes de 1789 ou de 1848, affectèrent d'autres sociétés un peu partout dans le monde, mais elles se conjuguèrent aux convulsions nées au sein même de ces sociétés. Par ailleurs, des événements survenus en dehors du centre embryonnaire d'une économie industrielle mondiale en Amérique et en Europe, comme par exemple les rébellions qui touchèrent la Chine et l'Inde au milieu du XIXe siècle, eurent un impact sur ce même centre, contribuant à façonner son idéologie et à dessiner de nouveaux conflits politiques et sociaux. À mesure que les événements mondiaux devenaient davantage interdépendants, les modes d'action des hommes et des femmes s'ajustèrent les uns par rapport aux autres, puis commencèrent à acquérir des traits communs partout dans le monde.
Ce livre décrit par conséquent l'émergence, à l'échelle planétaire, d'un phénomène d'uniformisation qui toucha les États, la religion, les idéologies politiques et la vie économique, à mesure de leur développement tout au long du XIXe siècle. L'apparition de cette uniformité ne fut pas seulement visible au niveau des grandes institutions comme les Églises, les cours royales ou les systèmes judiciaires. Elle devint également palpable dans ce que ce livre appelle « les usages relatifs au corps », à savoir la manière dont les gens s'habillent, s'expriment, mangent, ou gèrent leurs relations au sein de la famille.
Ces liens, qui se développèrent rapidement entre les différentes sociétés humaines durant le XIXe siècle, entraînèrent à l'échelle planétaire la création d'entités politiques hybrides, d'idéologies métissées et de formes complexes d'activité économique. Pourtant, ces liens étaient susceptibles de renforcer dans le même temps le sentiment de différence, voire d'antagonisme, qui existait entre les peuples de ces différentes sociétés, et en particulier entre leurs élites. Japonais, Indiens, ou Américains, par exemple, trouvèrent de plus en plus dans le sentiment d'identité culturelle, religieuse, ou nationale dont ils avaient hérité, la force nécessaire pour affronter les graves défis que leur posait une économie désormais mondialisée, et plus particulièrement ceux posés par l'impérialisme européen. Le paradoxe voulant que les forces planétaires et les forces locales se soient « cannibalisées » ou nourries mutuellement, pour reprendre un terme employé par le théoricien social Arjun Appadurai, est bien connu de tous ceux qui travaillent actuellement dans le domaine des sciences sociales{7}.
Cette relation ambivalente entre le mondial et le local, le général et le particulier ne date pourtant pas d'aujourd'hui, il s'en faut. Ainsi, au XIXe siècle, les États-nations et les empires territoriaux aux prises les uns avec les autres ont vu leurs traits distinctifs se préciser de plus en plus, et sont devenus peu à peu antagoniques au moment même où certaines similarités se manifestaient entre eux et que des liens et un système de relations se tissaient...