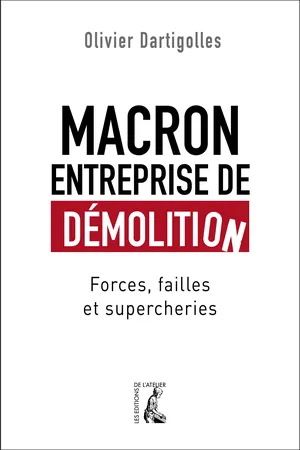![]()
Chapitre 1
La démolition en accéléré
Après les ordonnances sur le code du travail et le budget 2018, qui, à eux seuls, constituent déjà une offensive inédite par son rythme et son ampleur, le deuxième épisode du macronisme va consister à en finir définitivement avec le modèle social français, via la formation professionnelle, l’apprentissage, l’assurance-chômage puis les retraites. Pour l’exécutif, cette saison 2 du macronisme a aussi pour objectif d’adoucir la perception du « nouveau monde », avec une politique rééquilibrée, plus à gauche – après avoir tiré à droite –, plus favorable aux salariés.
Avec Nicolas Sarkozy, on avait un lapin Duracell bling-bling. Avec Macron, on a affaire à tout autre chose. C’est à la fois plus élaboré, plus cohérent, donc beaucoup plus dangereux, avec une politique au service des plus riches et du capital financier, sous les bravos d’un patronat vivant un rêve éveillé. Pour corriger l’image d’un « président des riches », la communication élyséenne et gouvernementale racontera l’histoire d’un président Macron voulant protéger après avoir libéré. Nous verrons dans un chapitre consacré à la casse du travail qu’il n’en est rien. Après cinq mois d’exercice du pouvoir, le macronisme est si fortement perçu par le plus grand nombre comme une politique de droite que l’exécutif et le parti présidentiel ont passé, à la mi-octobre, une annonce sur Le Bon Coin : « Cherchons personnalité gouvernementale ou parlementaire pour une incarnation de gauche. » Compliqué quand même...
Macron démasqué
L’objectif du nouveau pouvoir est de « rénover le modèle social français ». À première vue, cela peut sembler séduisant. Sur bien des aspects, le statu quo apparaît pour des millions de personnes comme insatisfaisant, incapable en tout cas de résoudre les difficultés du quotidien, de redonner un espoir. La vérité est qu’avec Macron, rien n’ira dans la direction permettant de vraies solutions : ni la destruction du code du travail, ni le basculement des cotisations salariales sur la CSG, une très vieille demande du patronat et de Bruxelles ; ni un renforcement sans précédent du contrôle des demandeurs d’emploi, accompagné d’une probable baisse des indemnités chômage ; ni une formation professionnelle entre les mains du grand patronat ne relevant en rien le formidable défi d’une véritable sécurisation des vies ; ni d’une réforme des retraites provoquant la fin d’un régime par répartition et d’une solidarité intergénérationnelle. Comme a pu l’affirmer la ministre Muriel Pénicaud, la réforme du code du travail n’est qu’une face du Rubik’s Cube de « la transformation de notre modèle social{1} ». En réalité, de sa démolition.
Ancien ou nouveau monde ? Ouverture ou repli ? Modernité ou archaïsme ? Conservatisme ou réformisme ? Optimisme ou « passions tristes » ? Le plus souvent, cette fausse alternative est présentée comme le chemin le plus court et le plus rapide pour « réparer » notre pays et lui permettre de prendre son envol dans la mondialisation, puisqu’il s’agit d’aggraver les orientations politiques passées.
Les choses sont aussi allées très vite dans la manière dont l’image du nouveau pouvoir a évolué dès les premiers mois du quinquennat. Cela a pu se mesurer dans la spectaculaire chute de popularité d’Emmanuel Macron, inédite sous la Ve République. Seul Jacques Chirac, en 1995, avait connu un tel décrochage. On est très vite passé d’une séquence où l’on pouvait entendre « laissons-lui sa chance, il vient juste d’arriver », à l’expression d’un doute sur la personnalité même du nouveau président, sur sa politique ; puis au constat d’une politique de droite conduite par un président narcissique et autoritaire.
Jupiter n’a pas fait long feu. On en oublierait presque la macromania de la dernière ligne droite de la campagne présidentielle jusqu’au sacre du Louvre. Au cours de cette période, les innombrables articles, éditoriaux, reportages, unanimement à la gloire de Macron, m’ont inspiré de l’inquiétude pour notre vie démocratique. L’admiration et l’adhésion ne peuvent à ce point dispenser d’un travail de discernement, d’analyse des faits, des processus à l’œuvre en France, en Europe et dans le monde, permettant de mieux comprendre les conditions de la victoire d’Emmanuel Macron.
S’inquiéter de ce qu’a pu produire la macromania n’est en rien une posture de mauvais perdant ou une contestation du verdict des urnes. Emmanuel Macron a gagné et il dispose aujourd’hui, si ce n’est des pleins pouvoirs, du moins des principaux leviers de commande du pays. C’est une réalité incontestable. Il s’agit ici de pointer ce climat de courtisanerie médiatique avec, en toile de fond, un présidentialisme renforcé, véritable poison pour notre vie démocratique.
J’exagère ? Laissons place à Franz-Olivier Giesbert, qui, dans l’entre-deux-tours des élections législatives, écrit : « Mais qu’est-ce qui nous arrive ? Longtemps, la France fut le pays le plus pessimiste et ronchon du monde. Elle est en passe de devenir l’un des plus optimistes, un laboratoire de l’avenir. [...] Il a suffi qu’Emmanuel Macron accède à l’Élysée pour que soudain tout change. Miracle de la politique, la France s’est mise à croire de nouveau en elle, quasi à s’aimer{2}. » Après avoir repris notre souffle, poursuivons : « Si les mots ont un sens, nous sommes en train de vivre une nouvelle Révolution française. En osant titrer son livre de campagne Révolution, Jupiter, qui n’a peur de rien, entendait se placer dans la lignée des Mirabeau, La Fayette, Danton, Robespierre. On croit rêver. » En effet, on ne peut pas si bien dire. De nombreux commentateurs ont fait un parallèle avec la majorité du général de Gaulle en 1958. D’autres, plus rares, avec Gambetta quand, au même âge que Macron, il recompose le paysage politique et accède au pouvoir avec la volonté de dépasser les clivages.
On pourrait ici multiplier les illustrations. À quoi bon ? C’est derrière nous. Depuis, le masque est tombé. Macron est apparu sous son vrai visage, celui d’un monarque arrogant et pressé, dirigeant la France comme on règle les affaires au sein du conseil d’administration d’une entreprise du CAC 40. Tout juste avant son interview au journal de 20 heures de TF1, dans un entretien publié à la mi-octobre dans le prestigieux hebdomadaire allemand Der Spiegel, Macron se défend d’être arrogant – ce qui donne dans le texte : « Ich bin nicht arrogant{3} » –, tout en s’attaquant aux « envieux » qui veulent paralyser le pays. Ah, cette habitude d’insulter et de stigmatiser une partie des Français depuis un pays étranger ! Mais quand, lors d’une conférence de presse, le président Macron est interrogé par un journaliste sur la situation politique, économique et sociale en France, il répond : « Je me suis fixé des règles, je n’évoque pas ces sujets lors de mes déplacements à l’étranger. »
Tout change ?
Puissamment soutenu par le système, Macron a été le candidat choisi par les forces coalisées de tous ceux qui voulaient tout maintenir en place. La levée de fonds réalisée en un temps record pour financer la campagne du candidat d’En Marche a été spectaculaire. À y regarder de près, nous retrouvons les principaux mécènes et les mêmes réseaux activés lors de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Autre record, celui des unes des magazines. Vous avez aimé « Emmanuel et Brigitte à la plage » ? La semaine prochaine, on vous racontera l’histoire de leur rencontre, puis, au prochain épisode, la manière dont le jeune candidat, inconnu des Français deux ans auparavant, prépare son prochain meeting avec un coach pour mieux maîtriser sa voix. Alors que 90 % des médias sont entre les mains de neuf milliardaires, ils ont tous alimenté une mise en récit, en forme de storytelling, à la gloire d’un jeune candidat, tout neuf, en marche pour sortir la France du hollandisme et la projeter dans un avenir plus positif. Incontestablement, ce souffle d’optimisme élaboré par les cerveaux de la start-up macroniste et relayé par des moyens médiatiques colossaux a été la révélation et la nouveauté de la dernière présidentielle.
Macron a aussi bénéficié d’un remarquable alignement des planètes avec le renoncement de François Hollande à se représenter, une première sous la Ve République. Un espace politique central s’est dégagé grâce à la victoire de Benoît Hamon à la primaire socialiste, l’alliance avec François Bayrou, et les tergiversations de la droite pulvérisée par l’affaire Fillon. Dans un climat de puissant rejet du système politique, Emmanuel Macron a suscité une curiosité bienveillante mais sans adhésion populaire à son programme. Le candidat et son équipe ont cultivé un clair-obscur tout au long de la campagne sur un très grand nombre de sujets, se contentant de répondre aux questions précises de journalistes par des formules creuses du type « il faut penser printemps », « changer le logiciel de la France », « libérer les énergies ». Tant et si bien qu’un mois avant le premier tour de la présidentielle, la seule proposition du candidat identifiée par l’opinion publique était l’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages. Et quasiment rien d’autre.
La « nouveauté » Macron rappelle terriblement l’Italie des années 1990 où Silvio Berlusconi a conquis le pouvoir après une campagne éclair reposant sur les médias, le rejet des partis traditionnels et la promesse de modernisation politique et économique du pays. Forza Italia avait alors fait du neuf en matière de communication politique autour de la figure du leader et d’un management issu directement de l’entreprise de Berlusconi, Fininvest. Au départ, Berlusconi avait fustigé les partis en place pour construire un nouveau parti où seul le chef décide. Comme Macron et la République en marche aujourd’hui.
Emmanuel Macron n’a pas fait irruption dans la vie politique avec la dernière élection présidentielle. Contrairement à la légende portée par le macronisme triomphant des premiers mois, Macron n’est en rien un homme neuf. Son programme a été élaboré dans les cercles patronaux et les milieux financiers. Il est le pur produit d’un système qui, voyant l’accélération de la crise politique et un niveau de colère pouvant tout emporter, a su surfer sur cette attente de changement tout en assurant la continuité sur l’essentiel : une domination de classe de ceux qui ont tout sur « ceux qui ne sont rien ». Lycéen à Henri-IV, étudiant à Sciences Po, à l’ENA, inspecteur des finances, banquier d’affaires chez Rothschild, membre de la Commission Attali sous la présidence Sarkozy, secrétaire général adjoint de l’Élysée, puis ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique sous celle de Hollande... Emmanuel Macron n’a pas le profil rêvé pour attaquer le système à l’arme lourde. Mais l’histoire officielle voudrait nous faire croire qu’en l’ayant observé de l’intérieur, Macron en aurait mesuré l’état de délabrement, la vacuité, et parfois même l’irresponsabilité.
Foutaises ! Tout juste après son élection, comme Hollande en 2012, le nouveau président est vite allé à Berlin. C’est devenu un exercice imposé dans notre vie politique. Sitôt la cérémonie d’investiture achevée, le nouveau locataire de l’Élysée va rencontrer Angela Merkel pour dire combien la France est bien décidée « à faire des efforts » pour suivre scrupuleusement le traité budgétaire européen. Promis, juré. Pour ma génération, le processus qui a nourri la défiance envers la politique jusqu’à provoquer une crise politique et démocratique majeure trouve son origine dans le passage en force après la victoire du non en 2005, lors du référendum sur le traité constitutionnel européen (TCE). J’ai souvenir de la couverture de Paris Match avec, côte à côte, Nicolas Sarkozy et François Hollande réunis pour dire oui. Douze ans après, on pourrait ajouter Macron au centre de la photo. Mais une chose change : pour imposer sa stratégie de « refondation européenne », Macron ne fait pas l’impasse sur le conflit démocratique né en 2005 du non-respect de l’expression de la souveraineté populaire.
En 2017, personne mieux que Macron n’a su tirer avantage du climat « dégagiste » de la derrière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a certes réalisé une belle campagne, partant en solo, se dédoublant en hologramme et arrivant en quatrième position (comme en 2012), avec un score frôlant les 20 % et un total des voix de gauche au plus bas. Marquée par le climat pestilentiel des affaires, par le renoncement de Hollande, et sur fond d’abstention record, la présidentielle 2017 est apparue pour beaucoup comme l’occasion de passer à autre chose. Pour des millions de citoyens, l’élection présidentielle permet mieux que toute autre de dire ce qu’on ne veut plus et de choisir le candidat qui semble le plus attrayant pour ouvrir un nouveau chapitre. Tous les principaux candidats ont joué ce rôle de prétendant à un présidentialisme renforcé, y compris celui qui, à l’élection précédente, défendait le projet collectif du Front de gauche pour une VIe République. Terrible piège qui, tous les cinq ans, se referme sur les aspirations populaires. Vous en avez assez de ces alternances qui ont toutes échoué à créer les conditions d’une amélioration concrète de vos conditions de vie ? Assez des promesses non tenues ? De l’indifférence et du mépris ? Qu’à cela ne tienne, l’élection présidentielle va vous permettre de le dire. Puis de regretter de l’avoir exprimé avec un bulletin de vote qui n’aura servi à rien, si ce n’est à aggraver les politiques dont vous ne vouliez plus. Ce processus se répète tous les cinq ans et aggrave très dangereusement la crise de notre vie démocratique.
Voilà le paradoxe le plus saisissant dans ce qui vient de se passer : le profond désir de changement devient le moteur de l’ascension au pouvoir d’un homme dont la mission première est d’assurer la continuité. Au lieu du renouvellement espéré, c’est le renforcement de l’ordre établi.
Le cri et le bordel
J’ai souvenir encore d’une phrase choc dans un livre de François Miquet-Marty, annonciateur du dégoût actuel pour la politique dans les milieux populaires et les classes moyennes. L’une des personnes qu’il interroge dit : « Je pousse un cri mais personne ne l’entend{4}. » Ce livre donne la parole à des femmes et des hommes frappés par le chômage et l’exclusion sociale. En vérité, ils n’ont pas de « sentiment de relégation » (cette expression me révulse) : ils vivent l’expérience du licenciement économique comme une mécanique implacable qui abîme les corps et les âmes, ronge les vies au quotidien. Leur cri dans le vide se transforme vite en colère.
Un ouvrier de GM&S, dans la Creuse, parle lui aussi de cette colère : « On s’endort avec elle, on se réveille avec... Le mépris, par contre, on ne s’y habitue pas. » Surnommé « petite main, gros bras », cet homme est un des opérateurs des immenses presses qui font l’identité ouvrière et industrielle de l’équipementier automobile creusois. S’il fallait un exemple, un seul, pour illustrer la belle formule de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, « il faut que tout change pour que rien ne change », ce serait d’ailleurs celui des GM&S. Nous sommes quatre mois après son élection, Emmanuel Macron est en déplacement à Égletons, en Corrèze. Les GM&S sont là pour rencontrer un président qui n’a pas prévu de les recevoir, et pour lui exprimer leur inquiétude. Le lexique macronien du mépris de classe, qui comportait déjà quelques épisodes fameux, s’enrichit alors d’une nouvelle tirade. Ciblant les manifestants, Emmanuel Macron s’agace : « Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, ils feraient mieux d’aller voir s’ils peuvent avoir des postes ailleurs. »
Le mépris encore et toujours. J’ai lu beaucoup de réactions des ouvriers de GM&S et j’ai retenu celle-ci à propos du président : « C’est un gosse avec une cuillère en or dans la bouche, qui fait des caprices, qui ne sait rien, mais alors absolument rien de la vie{5}. » Non, rien, en effet. Rien sur les productions industrielles : la fonderie qui se pratique à Ussel – dans l’entreprise où, selon Macron, les ouvriers creusois devraient aller – et l’emboutissage – réalisé à la Souterraine – sont deux choses bien distinctes. Rien sur la manière dont se passe un licenciement économique, ce qui est plus préoccupant à un tel niveau de responsabilité. Comment les GM&S pourraient-ils déposer un CV à Ussel alors qu’au moment où parle Macron le délai de réflexion sur le dispositif de reclassement est en cours ? Rien enfin sur les vies. Ussel, pour les 157 ouvriers creusois, c’est à 140 ou 200 kilomètres, selon les cas. Ceux qui sont propriétaires d’une maison, au mieux indexée sur le marché de l’immobilier dans le Haut-Viennois, au pire au prix creusois, ont tout à perdre en vendant leur seule richesse pour un « morceau de pain », comme l’observe un ouvrier dans un reportage, la gorge serrée par l’indignation. Il y a aussi les vies, les familles, le travail des conjoints, l’éducation des enfants. Une vie quoi.
Dans le monde merveilleux de Macron, inspiré des États-Unis, la mobilité est une belle aventure. Allez, les Creusois, montez dans vos pick-up, embarquez la famille, quelques meubles et zou... direction la Corrèze ! Dans de tels moments, où se situe la vraie violence, où sont le vrai désordre social ...