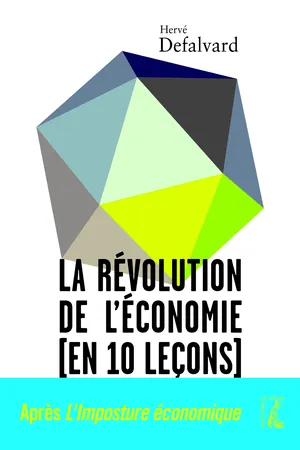![]()
Leçon 1. L'économie n'est pas une science naturelle
Sous prétexte de science, le débat en économie est aujourd'hui interdit. Ainsi le combat mené par l'Association française d'économie politique (Afep) pour le pluralisme en économie{21} est-il devenu, sous la plume de Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014, la promotion nuisible du « relativisme des connaissances, l'antichambre de l'obscurantisme{22} ». Comment en est-on arrivé là ? Par la lente et progressive évolution vers le scientisme qui confond l'économie avec une science naturelle. Ce scientisme efface la nature morale et politique que l'économie recouvre dans nos sociétés afin d'en faire l'égale d'une science naturelle. Cette dernière a été d'ailleurs qualifiée par le physicien et épistémologue Jean-Marc Lévy-Leblond, dans La Pierre de touche{23}, de « science inhumaine », afin de souligner le danger de la réduction des sciences humaines aux sciences naturelles. Or ce n'est qu'en restituant à l'économie sa nature morale et politique qu'il sera possible de retrouver le chemin du pluralisme critique et d'envisager une alternative au néolibéralisme, dont la suite de notre ouvrage déclinera les facettes en suivant la troisième voie de l'économie sociale et solidaire.
L'ère du scientisme
« Je suis un chercheur, j'essaye de rester neutre, si mes idées sont reprises tant mieux{24}. » Nous pourrions multiplier les déclarations d'économistes qui affirment qu'ils font de la science et non de l'idéologie. Certes, l'économie peut connaître un biais idéologique lorsque ses idées morales et politiques ne sont plus qu'une vulgate, comme le dénonçait déjà Karl Marx, en échappant aux exigences de la science. Mais le scientisme est une mauvaise réponse à ce biais idéologique, car il chasse le bébé avec l'eau du bain en rompant toute amarre avec la nature morale et politique de l'économie. Cette rupture s'est produite progressivement, avec deux générations successives de scientisme qui aujourd'hui coexistent : le scientisme des équations et le scientisme des données.
Le scientisme des équations
À partir du milieu du XXe siècle, dans le sillage de la définition formaliste de l'économie par Lionel Robbins l'assimilant à l'utilisation optimale de moyens rares pour des fins illimitées{25}, un premier scientisme des équations s'amorce. Il consiste pour les économistes à ne plus faire que des mathématiques, à se limiter aux démonstrations logiques et aux théorèmes, sans plus se référer à la nature morale et politique de l'objet économie. Lors d'une conférence donnée à l'université Paris-I en septembre 1999 dans le cadre du colloque Charles-Gide{26}, Gérard Debreu, figure emblématique de ce scientisme des équations, une fois la dernière étape de sa démonstration mathématique franchie, s'arrêta ainsi en disant qu'il dirait des bêtises s'il continuait. C'est-à-dire s'il parlait de l'économie en écrivant autre chose que des équations et des théorèmes. Bien sûr, l'usage des mathématiques en économie ne conduit pas nécessairement au scientisme. Mais cette dérive aura d'autant plus tendance à se produire chez l'économiste mathématicien que son objet ne pose plus à ses yeux un problème d'ordre moral et politique.
Une telle dérive scientiste n'est d'ailleurs pas la spécificité de l'économiste mathématicien. Elle est un danger contre lequel John von Neumann (1903-1957), sans doute le plus grand mathématicien du XXe siècle, avait mis en garde tous les mathématiciens dans son article de 1954{27}. Pour lui, ce danger arrive dès lors que le mathématicien fait perdre à sa science tout contact avec les problèmes réels, la condamnant à dépérir par atrophie. Tel est bien le cas du scientisme des équations en économie, contre lequel le mouvement initié par les étudiants des Écoles normales supérieures s'est élevé, au début des années 2000. En dénonçant « l'autisme de l'économie », ces derniers voulaient signifier sa perte de lien avec les problèmes réels qui, en économie, et depuis deux siècles, se posent à travers une matrice morale et politique, comme nous le verrons plus bas.
Le scientisme des données
Plus redoutable encore, le scientisme des données consiste à faire de l'économie en mimant les sciences de la nature. Sous l'impérialisme de l'économétrie, l'économie est ainsi devenue une science du seul traitement des données. Là encore, l'économétrie n'est pas en cause. Tant qu'elle reste à sa place, elle sert la science économique. Mais lorsqu'elle occupe par un nouvel usage toute la place, elle conduit les économistes à traiter indifféremment des données portant sur les tirs au but dans les matchs de football ou des séries de données sur le chômage. Devenue une technologie du traitement des données, l'économie est aujourd'hui ramenée à une « méthodologie d'analyse des faits humains et sociaux{28} ». Quand les économistes se trompent dans leurs analyses, c'est désormais la faute aux données. Ainsi, Augustin Landier (1974-), moqué pour avoir prédit, dans un article publié en 2007, que la crise n'aurait pas lieu, répondit que, certes, « cela [s'était] avéré inexact mais reflétait les données dont [on disposait] alors{29} ».
Derrière les chiffres traités, il n'y a plus d'idées qui font système ; c'est la fin des idéologies. Esther Duflo (1972-) est au scientisme des données ce que Gérard Debreu fut au scientisme des équations. Franco-Américaine honorée du titre de conseillère de Barack Obama, cette économiste spécialiste de la pauvreté revendique son approche empirique consistant à tester sur données l'efficacité de tel ou tel dispositif de lutte contre la pauvreté, par exemple le microcrédit aux Philippines, sur lequel ses conclusions sont mitigées : ni recette miracle ni désastre{30}. Interrogée sur les facteurs du développement économique récent des pays émergents, elle fit à ses interviewers cette réponse désarçonnante : « Je ne sais pas. » Ajoutant : « Je ne m'intéresse pas tellement au pourquoi les pays croissent{31}. » Le scientisme des données, sous sa critique des idéologies, laissa voir son grand vide théorique.
Scientisme des équations et scientisme des données sont tous deux le reflet du même processus : l'effacement recherché de la nature morale et politique de la science économique afin d'en garantir la neutralité. Pour sortir du scientisme, il est nécessaire de restituer la nature morale et politique de l'économie.
La nature morale et politique de l'économie
Les économistes n'ont pas toujours revendiqué la neutralité de leur science. Il suffit de penser aux premiers économistes libéraux, par exemple Adam Smith (1723-1790) et Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) qui, des deux côtés de la Manche, prirent tous deux le parti du régime de la liberté économique. Ces deux figures du Panthéon des économistes défendirent l'économie politique libérale contre les monopoles et les privilèges royaux en recourant aux moyens de la science, dont ils faisaient ainsi un allié de leurs idées et de leurs valeurs. Sur le plan historique, l'économie a d'abord été une science morale avant de devenir une économie politique.
L'économie, une science morale : le juste prix
Comme tout objet, l'économie est construite par des représentations qui n'ont pas toujours été les mêmes au cours de l'histoire. Elle a ainsi longtemps comporté une dimension morale qui la rattachait à des valeurs ou principes du bien. Ainsi, cinq siècles avant notre ère, dans son Éthique à Nicomaque, Aristote développa une pensée morale du juste prix, qui est le prix conforme à des principes du bien. Pour les échanges, Aristote pense le juste prix selon « une proportion arithmétique, car la loi n'a égard dans les transactions privées qu'au caractère distinctif du tort causé, traitant les parties à égalité, et se demandant seulement si l'une d'elles a été l'auteur et l'autre la victime d'un dommage{32} ». Pour le philosophe, l'homme vertueux dans l'échange est l'homme « libéral », dont la libéralité est sa vertu. Cette dernière le conduit « à ne pas regarder à ses propres intérêts{33} », à donner et acquérir « ce qu'on attend qu'il donne et acquiert selon l'unique étalon qui n'est autre en réalité que le besoin, qui est le lien universel{34} ». Tant que l'échange reste conforme aux besoins des personnes, définis dans le cadre communautaire de la cité, tant que son prix permet de les satisfaire, alors la justice dans l'échange (ou « justice commutative ») est réalisée.
La pensée aristotélicienne du juste prix appartient au registre de l'économie normative dans la mesure où elle se réfère à des principes du bien, où elle élabore une économie telle qu'elle doit être selon des principes moraux. Et – déjà – Aristote utilise la science de son époque, la géométrie, pour en établir le bien-fondé. Sur la base de son économie normative du juste prix, Aristote propose une analyse des échanges tels qu'ils sont dans la cité. Ce faisant, il change de registre et développe une économie appliquée, appelée encore positive. Il distingue alors deux cas de « mauvaise chrématistique », cet usage de l'argent qui, parce qu'il est animé par le désir d'argent, ne sert plus les besoins mais la recherche du gain monétaire pour lui-même et sans fin, éloignant les rapports d'échange de la justice.
Le premier correspond aux échanges monétaires du petit commerce, « pratiqués par ceux qui exercent des métiers dégradants, qui endurent pour l'amour du gain, au surplus médiocre, les pires avanies{35} ». Si l'amour du gain monétaire détourne ici les échanges du juste prix, leur écart par rapport à ce dernier reste faible puisque leurs gains se révèlent médiocres. Aristote n'en propose pas de régulation, car ils ne contrarient pas la justice dans la cité. Il n'en va pas de même pour les échanges relevant du second cas de mauvaise chrématistique. Fondés sur le pouvoir d'argent, ils ne s'observent plus dans les bas-fonds de la cité mais plutôt sur ses hauteurs. Aristote prend ainsi l'exemple d'un marchand qui, s'appuyant sur un capital élevé, acheta tous les pressoirs à huile de Sicile afin d'en retirer un large profit grâce au prix de location élevé qu'il va pouvoir imposer aux agriculteurs de l'île du fait de son monopole. Ce monopole lui assura un enrichissement si considérable que le roi, Denys l'Ancien, décide de le chasser de l'île afin d'y maintenir l'ordre. De cet exemple, Aristote tire une leçon d'économie appliquée : seuls les cités et leurs citoyens peuvent utiliser des techniques qui assurent de grands profits, comme celle du monopole, car c'est alors au bénéfice de l'intérêt public. Il ne convient donc pas de laisser faire l'enrichissement privé animé par le désir d'argent, car il ne peut en résulter que démesure et désordre dans la cité.
L'économie politique
La dimension politique de l'économie, beaucoup plus récente, fait son apparition avec le terme même d'« économie politique » qu'Antoine de Montchrestien est le premier à utiliser dans son Traité d'économie politique publié en 1615. Il explique très bien qu'avant son époque, se référant précisément à Aristote, l'économie était conçue comme une affaire domestique et non politique. La gestion de l'économie se limitait à celle du domaine familial, elle recouvrait les pratiques du chef de famille et de ses membres. À partir du XVIIe siècle, elle devient l'affaire du royaume ou de la nation, dont elle va composer le lien social central. Dans ce « tiers ordre » – comme l'appelle Montchrestien – composé de laboureurs, d'artisans et de marchands, ces derniers deviennent le modèle à suivre car leur quête de profit leur fait apporter un grand soin à leur travail tout en leur faisant utiliser l'art du calcul. Sans cet esprit du commerce, conclut-il, « il n'y aurait point de bons laboureurs, de bons artisans, car cela même est un trait de leur art{36} ». Dans son traité, Antoine de Montchrestien avance l'idée selon laquelle l'économie politique doit être organisée sur le modèle du libre commerce généralisé car, ainsi, elle sert le bonheur de tous et la puissance du royaume. Bien sûr, quand il passe à l'économie appliquée, il montre que, dans certains cas, il ne faut pas laisser jouer la libre concurrence dont les résultats n'iraient pas dans le sens souhaité. Ainsi, afin de favoriser le travail nombreux, le gouvernement limitera les importations de biens ouvrés et les exportations de bien non ouvrés. Par ailleurs, selon lui, si avec l'Espagne, puissance plus faible que la France, le libre commerce s'impose, c'est le protectionnisme qu'il convient d'adopter avec l'Angleterre, en raison de sa puissance supérieure à celle de la France.
Le traité d'Antoine de Montchrestien est véritablement pionnier car il ouvre l'ère de l'économie politique, dont la conception de l'homme en société repose sur des valeurs (la libre recherche du bonheur par son travail) et sur une forme de lien social (le marché généralisé). Dès lors, elle constitue une science morale et politique et, pendant plus de trois siècles, jusqu'à son tournant formaliste au milieu du XXe siècle, les économistes se rangeront sous sa bannière, leurs débats se dérouleront en son sein. Par exemple, au XIXe siècle, Karl Marx y opposera l'économie politique du capital à l'économie politique du travail.
À partir du milieu du XXe siècle, une évolution se produit avec la mathématisation du savoir économique. Si cette dernière ne se confond pas avec le scientisme, elle le contient comme l'une de ses dérives, qui advient dès que les équations perdent leur lien avec les problèmes réels. La substitution en anglais du terme « economics » à celui de « political economy » qui accompagna ce mouvement de mathématisation signale la réalité de ce danger, puisqu'elle fait perdre le sens politique des problèmes économiques qui bientôt ne seront plus que des probl...