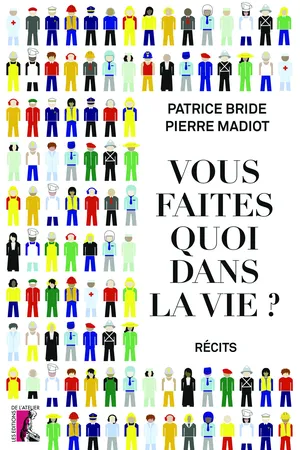![]() Dans la nature
Dans la nature![]()
On ne prend pas de gants avec les pommes
Au début, lorsque j'ai commencé à travailler, j'étais dans les radis : les ramasser, faire les bottes. J'ai fait aussi les framboises, les champignons, les fleurs. Je viens de faire les pommes : pas que des récoltes, du conditionnement aussi, et même des livraisons.
Au bout de quatre ans, j'ai enfin compris la Tentation. Une sacrée variété. Cette pomme n'est pas jaune, elle n'est pas orange, elle est entre les deux. Au moment où on la ramasse, il faut qu'il y ait un petit peu d'orange, mais pas trop. Le technicien de la coopérative vient avec sa barrette, et c'est celle-ci et pas celle-là. Si elles sont déclassées en Golden à la coopérative, ce n'est pas le même prix. Quand on a le soleil dans la figure, on la voit d'une certaine couleur, mais dans le palox on la voit autrement, ce n'est vraiment pas facile.
Le palox, c'est une cinquantaine de caisses, 450 kilogrammes au total. Quand on remplit bien une caisse, on y met une cinquantaine de pommes. Trois palox par jour, ça fait 7 500 pommes. Il ne faut surtout pas jeter les pommes dans la caisse, il faut les déposer, pour ne pas les abîmer. Sur le fond, il faut mettre la pomme avec la queue en bas pour qu'elle ne roule pas. On commence sur les côtés, puis on complète progressivement vers le milieu. On regarde où il y a un trou, et on pose la pomme juste là. C'est une habitude à prendre.
Il y a le bon geste. On la prend sur l'arbre, et on la retourne pour la poser dans le palox. Il ne faut pas la serrer avec les doigts, on la prend par en dessous avec la paume. Normalement, il ne faut pas ramasser les pommes avec des gants. On ne sent pas la pomme si on a des gants. Si on appuie trop quand on prend la pomme, ça fait un petit bruit, et là, on sait que la pomme est foutue. Quand je regarde dans les magasins, je vois celles qui ont des doigts ; je me demande comment elles arrivent dans cet état alors qu'elles ont été triées. C'est qu'elles font tout un circuit : elles vont à la coopérative, elles sont trempées dans un produit pour les conserver, elles vont dans un frigo. Quand ils ont une grosse commande, ils les calibrent, les mettent en palette et ça part au magasin. Moi je fais de mon mieux toute la journée, mais ensuite, tout au long de la chaîne, elles peuvent être abîmées.
Nous sommes debout sur une machine, on appelle ça une plateforme à pommes. C'est comme un grand plateau sur roues. Nous sommes quatre dessus, deux de chaque côté. Il faut s'entendre. Quand ce sont de jeunes pommiers, il y a moins de pommes, on ne s'y met qu'à deux. Quand il y a un côté plus exposé au soleil, il y a toujours plus de pommes, donc plus de travail que du côté ombre, on sait que ça va carburer. On commence toujours par ramasser celles du bas. Et on remonte. Le plateau monte et descend, et il y a des manettes pour accélérer ou aller moins vite. On essaie de mettre la machine au minimum pour qu'elle avance toute seule. Quand on va tout doucement, c'est plus régulier. Si ça ne va pas assez vite, comme c'est moi qui conduis, j'accélère. Je n'ai pas le choix ! Normalement j'aurais dû être payée, en tant que chauffeur, quatre centimes de l'heure en plus.
Nous sommes en plein air dans la nature, mais aussi dans les produits chimiques... Il y a des traitements pour tout. Il y a même un produit pour coller les pommes et éviter qu'elles ne tombent, quand la météo annonce un coup de grand vent. Il y a aussi des produits pour qu'elles colorent plus vite. Moi, quand je ramène des pommes, j'enlève les peaux et je les fais cuire... Quand le patron fait traiter une parcelle, ça doit être marqué. D'après les règles de la coopérative, c'est un seul traitement par an. Mais cette année, le patron a fait deux passages, en utilisant des produits restant des années précédentes, parce qu'il y avait eu du gel. Il y a bien parfois des contrôles, mais c'est un beau cinéma. Ce jour-là, le patron range bien tout comme il faut, et on nous fait passer le mot : « Si vous voyez quelqu'un arriver à l'improviste, voilà ce qu'il faut dire. » Une année, il y a eu trois camions de gendarmes qui ont débarqué. Le patron était au courant. Dans les champs, il est censé y avoir des toilettes : en fait, rien du tout, même pas de points d'eau. Normalement, il devrait y avoir une cuve pour se laver les mains. On a les mains toutes blanches de produits, à cause des traitements. On le voit sur la Granny, la pomme qui est toute verte, c'est là qu'on voit le mieux le traitement. On sait bien que ça nous empoisonne. C'est obligé. On va mourir d'un cancer, tous. Une fois, je travaillais dans une serre au moment d'un traitement, sans masque ni combinaison. Normalement c'est obligatoire, mais le patron ne va pas s'amuser à acheter ça pour tout le monde. On n'a pas le choix, on reste, sinon ils prennent quelqu'un d'autre. Il y a plein d'autres trucs comme ça qui ne sont pas logiques. On se tait, on subit.
D'une année sur l'autre, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Cette année, nous étions entre vingt et vingt-cinq sur le chantier. Moi je ne veux pas n'importe qui sur la plateforme, mais on a de tout dans les champs. Il y en a qui ne sont là que pour gagner des sous, qui ont juste besoin d'un mois pour compléter le chômage. On se décarcasse pour travailler bien, et l'autre, à côté, s'en fiche. Je me souviens d'un bonhomme à qui je répétais dix fois de ramasser les pommes par le bas et de faire attention. Rien à faire, il ramassait par le haut, et les pommes tombaient. Il avait ses écouteurs dans les oreilles, ses lunettes de soleil et sa capuche. Au bout d'un moment, j'ai dit à la patronne d'aller le voir. Il faisait du sale boulot, ça gênait tout le monde. Au bout de deux jours, si ça ne fait pas l'affaire, on le voit tout de suite.
Mais on fait aussi de belles rencontres. Cette année, on a eu des gens, mon Dieu, je les appelle des hippies. Ils ont des grandes tresses, on se demande où ils ont été choper ça. Ils ont une espèce de camion tas de ferraille qui tient à peine debout. Ils sont venus faire des pommes pendant deux mois, puis ils sont partis au Maroc. Ils ont atterri chez le patron comme ça, par hasard. Ils sont passés devant, ils ont vu qu'il y avait des pommes, ils ont demandé s'il cherchait du monde. On leur a dit « oui, on prend tout le monde ». Le patron n'est pas raciste, il prend tout le monde ; ça, c'est bien.
Au début de la récolte, il fait bon et il y a beaucoup de monde. Quand il fait bien froid, c'est rude. Ce n'est pas la rosée qui me fait peur, c'est la gelée sur les pommes. On a froid aux mains. Au magasin de sport, ils font des chauffeuses pour les mains. Ça se trempe dans l'eau chaude, et on garde ça pour se frotter les mains. On cueille dix minutes, et on se réchauffe les mains. Celui qui n'a pas de bonnet ou de bottes, c'est qu'il n'a pas envie de travailler. L'automne, on ne tient pas dans les champs si on n'est pas habillé correctement. La patronne dit : « Si vous n'avez pas de tenue de pluie, demain vous ne revenez pas. » Normalement, les patrons devraient en avoir de secours pour les ouvriers, mais ils ne les fournissent pas. Ça coûte tellement cher une bonne tenue : 110 €. Moi, je ne paye pas une tenue de pluie à ce prix-là. Mais si tu prends les tenues les moins chères, ça tient deux jours.
Moi, je n'aime pas être enfermée. Je préfère être dans les champs plutôt que dans une usine. Vu mon caractère, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de monde avec moi pour travailler. J'ai fait une saison dans une usine de coussins, ça m'a suffi. Aux pommes, on est autonome. Je sais ce qu'il y a à faire, ils ne sont pas derrière moi. On y va à notre allure. En tout cas chez ce patron-là, il préfère qu'on y aille doucement pour que ce soit bien fait.
Il y a des patrons qui sont gentils. Comme ils savent que j'accepte tous les boulots, pour deux ou trois heures, ils m'appellent, et comme je n'ai pas le permis de conduire, si je n'ai personne pour m'emmener, ils viennent me chercher, et ils me ramènent. Une fois, ils nous ont demandé de monter des serres avec eux, et hop, le midi, tout le monde au restaurant. On n'a pas à se plaindre. Quand on a fini de travailler, ils nous appellent pour venir chercher notre paye, on a droit au jus de pommes et aux petits gâteaux, c'est sympa. Là où je suis actuellement, on peut demander son après-midi pour un rendez-vous médical. Moi aussi je suis arrangeante : ils me demandent de travailler le samedi matin, j'y vais. J'ai eu d'autres patrons, chez qui il fallait se bagarrer, même pour aller à une sépulture. J'y étais allée quand même : le contrat n'a pas été renouvelé alors que la patronne l'avait promis. Le lundi matin, j'y vais, elle me donne le chèque en me disant : « Tiens, voilà ta fiche de paye, tu peux rentrer chez toi. » Pas grave, j'ai trouvé ailleurs.
Le salaire, c'est à l'heure, au Smic, pas un centime de plus. Là, ce sont de bons patrons. Parfois, ils nous donnent des pommes. Il y en a qui sont vraiment radins, ils ne donneront même pas un poireau. Les contrats, on ne sait pas. On ne signe rien, ils appellent ça des contrats Tesa{15}. Tu sais quand tu commences, tu ne sais jamais quand tu finis. L'autre fois, elle m'a appelée et dit qu'il y aurait deux semaines de travail. En fait j'ai fait une semaine et deux jours. On te dit : « On te rappellera, ce sera après les vacances. »
Je n'aime pas quand ça s'arrête. On a le bourdon après. Je suis bien dans mes champs, moi. C'est dur des fois, mais ce n'est pas grave. C'est toujours mieux que de toucher le chômage ou le RSA. Au boulot, je fais comme si la plantation était à moi en fin de compte. Cette année j'ai arrêté fin novembre, puis j'ai repris un peu courant décembre. Je ne suis pas restée longtemps sans rien faire. Ensuite, c'était l'arrachage de l'herbe dans les serres pour les semences de poireaux, mettre le tapis par terre pour éviter que l'herbe pousse dans les allées, les arceaux par-dessus les choux pour éviter qu'ils gèlent. Normalement, en janvier, je vais faire la taille des arbres. Je ne sais pas trop comment ça se fait, je ne l'ai jamais fait. Il faut recouper les branches pour qu'elles tombent comme il faut. On va faire une petite formation d'une semaine, avec les sécateurs à main ou hydrauliques. J'en ai jusqu'au mois de mars. En mars-avril, quand c'est en fleurs, ils les traitent et tout ce qui s'ensuit. Fin juin-début juillet, quand les pommes commencent à pousser, il faut enlever les plus petites, celles qui sont en paquet, en ne les laissant que par deux, ou trois selon les variétés, pour qu'il n'y ait plus qu'une cinquantaine de pommes sur le pommier. On les laisse en quinconce, pour qu'elles puissent grossir. Ensuite, la récolte se fait en septembre, jusqu'à fin novembre-début décembre. Mais c'est la dernière année, ensuite les patrons partiront à la retraite. On verra bien...
Véronica Charrier
![]()
L'éleveur et son troupeau : une question d'équilibres
Quand Céline et moi nous sommes installés ici il y a six ans, pour faire de l'élevage « bio », nous avions de grandes idées. La réalité, ce sont bien des problèmes concrets à résoudre... Par exemple, la première année, j'ai implanté six hectares de céréales que j'ai ensilées{16}. Peu de temps après, j'ai semé un trèfle, qui s'est mal développé. L'hiver est passé et, au printemps, j'ai retravaillé le sol pour planter un maïs. Au bout du compte, toute la plante s'est fait manger par un petit ver, le taupin, et je n'ai rien récolté. En l'occurrence, j'ai trop demandé à la terre : trois labours en quelques mois, ça a bouleversé l'équilibre du sol. La sentence a été sans appel. Il aurait fallu que je me contente de ma récolte de céréales, que je replante une prairie, que je la laisse se reposer pendant quatre ou cinq ans, avec des animaux qui vont pâturer. Et, après tout ce temps, j'aurais pu replanter un maïs.
La solution conventionnelle aurait été de compenser avec des engrais, du désherbant et des pesticides. Pas possible. Quand on a fait le choix du bio, on ne peut compter que sur un maître mot, « équilibre » : une situation qu'il faut maintenir ou rétablir quitte à faire des erreurs en agronomie et en tirer un apprentissage.
Je réalise ainsi qu'il faut donner du temps au temps, que le sol n'est pas qu'un support : il y a de nombreux organismes qui y travaillent et qui le rendent fécond, à condition de ne pas demander plus que ce que ce milieu vivant peut nous offrir. À l'école d'agriculture que j'ai fréquentée, on ne nous a parlé que d'agriculture industrielle, jamais on ne m'a expliqué le fonctionnement d'un sol, sa biologie, l'influence de la roche qui est en dessous. On peut retrouver ce savoir-là chez les paysans qui sont de la génération d'avant, celle de nos parents, celle qui a travaillé la terre avant que les produits en tout genre ne se généralisent. Alors, on se documente. Personnellement j'ai lu les livres de Rudolf Steiner, nous nous formons auprès des confrères qui se sont regroupés au sein du Groupe des agriculteurs biologiques (GAB).
Il faut trouver un équilibre dans ce que je cultive et dans la manière de le cultiver. C'est ça, en fait, le plus gros problème que j'ai à résoudre puisque tout ce que mangent mes animaux est produit dans mon exploitation. Notre volonté est d'être autonomes. Le lait produit par nos cinquante vaches laitières correspond aux capacités fourragères que nos cent hectares de terre peuvent nous apporter. Nous ne souhaitons pas acheter d'autres aliments pour produire plus de lait. On a un type d'élevage qui fonctionne dans un cercle vertueux : notre troupeau est sain, il donne un fumier sain qu'on va apporter sur les terres qui vont être saines et où va pousser un fourrage de qualité.
Mais il n'a pas été simple d'adapter nos vaches laitières à ce système. Elles étaient habituées à consommer une ration constituée de maïs et de tourteaux de soja que nous avons remplacée en donnant une importance majeure au pâturage. Quelques vaches se sont mises à maigrir, à avoir des problèmes de pieds, à donner moins de lait, à être davantage malades. Nous avons donc sélectionné celles qui se sont le mieux adaptées. Celles-ci ont un gabarit plus petit, plus râblé, elles ont de bonnes pattes, elles sont capables de valoriser au mieux leur ration. Ensuite, on a sélectionné les génisses qu'elles nous ont données pour arriver à des animaux qui se comportent bien.
Au bout de six ans, je pense qu'on commence à avoir un troupeau qui correspond à notre mode d'élevage. C'est un troupeau de cinquante vaches laitières de race Prim'Holstein qui nous connaissent bien et qu'on connaît toutes, une par une. Il faut dire qu'on passe beaucoup de temps avec elles ! On a chacun nos animaux fétiches, certains vont chercher le contact, n'ont pas peur de nous. Moi, j'ai ma vache préférée, Céline a la sienne. En fait, nous aimons toutes nos vaches. Elles ont plus ou moins de caractère et on fait tout ce qu'on peut pour qu'elles soient bien. Certains éleveurs mettent de la musique dans les bâtiments d'élevage.
L'équilibre est aussi à trouver au sein du troupeau qui vit comme une petite société très hiérarchisée. Il y a la chef, les dominantes et les vaches qui restent à l'écart. C'est un problème parce que le troupeau est appelé à changer continuellement. Régulièrement, je dois faire entrer une génisse qui vient de vêler{17}, ou faire sortir des vaches qui ont fini la lactation et que je mets au repos. Chaque fois, il faut que la hiérarchie se rétablisse. Quand c'est la chef que je fais sortir, on voit la sous-chef, qui attendait depuis trois mois, en profiter pour prendre la tête du troupeau. Dans le même temps, les affinités s'affirment ou se recomposent et il peut y avoir des conflits qui sont parfois violents. Elles peuvent se faire mal. Mais il est difficile d'éviter les accidents dans la mesure où notre mode d'élevage nous oblige à maintenir un grand nombre de bêtes dans un certain confinement.
Tout ça est en harmonie et c'est le résultat d'un travail quotidien. Ce que je fais aujourd'hui, je vais en subir les conséquences ou en avoir les bénéfices dans sept ou huit mois. Il faut toujours voir loin, il faut toujours anticiper. Ce que les animaux mangent aujourd'hui, c'est l'herbe que j'ai récoltée il y a un an. Il n'y a pas de repos possible, nous devons toujours rester humbles face à une nature souveraine. On est donc perpétuellement en train de préparer une prochaine échéance. Par exemple, je vais faire les premières fauches d'ici quinze jours, quand la météo va le permettre. Ensuite, je vais préparer les semis de maïs et les choses vont s'enchaîner comme ça sans répit pour aller au bout de mes choix. Je pourrais par exemple laisser toute mon exploitation en prairie naturelle, ce ne serait pas aberrant. Mais vu mes charges liées à mes investissements, je suis dans l'obligation de produire un certain volume de lait, et donc de ne pas nourrir les bêtes seulement d'herbe.
Et puis il peut arriver qu'une vache soit malade, qu'elle tombe, qu'elle se blesse, qu'elle ingère une plante toxique. C'est ainsi que l'an dernier, j'ai perdu une vache au pâturage : elle avait mangé de la ciguë sur le bas-côté. Je l'avais envoyée à l'herbe à 10 heures 30, je suis repassé voir à 11 heures 30, elle était toute tremblante, elle bavait. À midi, elle était morte.
Enfin, au milieu du troupeau, il y a le taureau. C'est un jeune sujet qu'on ne laisse pas jouer son rôle de reproducteur plus d'un an. Au-delà, il risque de s'installer, de devenir susceptible et d'être dangereux. Après une année de vie de cocagne, il est vendu comme viande de boucherie de la même façon que les vaches qu'on « réforme » parce qu'elles sont arrivées au bout de leur carrière de laitières, et de la même façon que les quelques vaches de race Highland Cattle qui paissent de l'autre côté du chemin et dont nous vendons la viande en vente directe.
Il peut paraître contradictoire d'aimer ses vaches et, à la fin, de les envoyer à l'abattoir, mais c'est ainsi. Les bâtiments de notre ferme sont le centre d'un microcosme où tout se tient. C'est pourquoi j'ai apporté tant de soin à concevoir et à construire ma maison, avec ses murs en paille, dans un ancien hangar.
Ici, nous sommes bien. Des fenêtres, qui donnent sur le vallon, je vois paître mon troupeau et, dans le pré à côté, les quatre chevaux que j'élève pour le plaisir.
C'est ainsi que l'équilibre que j'essaie d'atteindre dans mon exploitation se répercute sur notre mode de vie. Respecter l'équilibre des bêtes, l'équilibre de la terre, c'est respecter aussi notre équilibre à nous.
Guillaume Elléouët
![]()
Cultiver les jardins publics
À l'origine, je suis un homme issu de la terre. Mes parents étaient maraîchers, mes grands-parents agriculteurs. J'ai travaillé jusqu'à l'âge de 27 ans sur l'exploitation de mes parents. J'y ai pris mon pied. Puis j'ai été jardinier municipal à Guérande. Maintenant, je suis ...