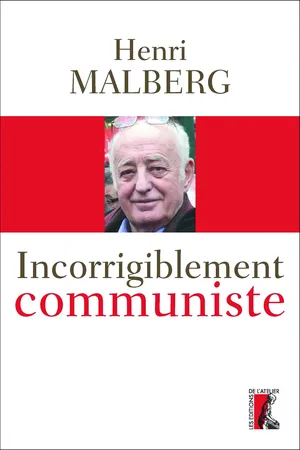![]()
Chapitre 1
Génération Libération
Comment avez-vous rencontré le communisme ? Comment êtes-vous devenu militant ?
Je suis de la génération Libération.
C'est une belle histoire. Je l'appellerai, comme le titrait le programme du Conseil national de la Résistance, « les jours heureux ». Je sortais de l'enfance, je n'avais pas quinze ans.
C'était à l'automne 1944. Chaque famille, chaque individu était concerné et retenait son souffle.
Le nazisme, l'Allemagne de Hitler, l'horreur et la honte du XXe siècle s'écroulaient sous les coups des armées alliées. De l'armée soviétique d'abord, l'Armée rouge comme on l'appelait, qui marchait sur Berlin. Les armées américaines, canadiennes, anglaises, qui avaient débarqué en Normandie en juin 1944, rejointes par la division Leclerc, franchissaient le Rhin. En Provence, l'armée française de De Lattre fonçait vers l'Allemagne. Nous avions tous souffert de l'occupation allemande, de la honte et de l'écroulement en quelques semaines de l'armée française en 1940, de la collaboration de Vichy et de Pétain. De la faim, la vraie faim. Des fusillades de résistants que l'on connaissait. De l'horreur de la déportation des juifs. Et voici que venait la Libération.
La Libération, les Français, d'instinct, ne la voulaient pas venue seulement de l'extérieur. À quatorze ans, j'ai vécu dans un village de Touraine une insurrection nationale, le soulèvement d'un peuple. Parce que s'il y a eu en France des gens qui ont collaboré, la masse du peuple français a subi, rongé son frein, puis grondé avant de se soulever, comme cela arrive de temps en temps dans notre histoire. Les chefs des armées alliées ne s'y attendaient pas et même de Gaulle ne le souhaitait pas. Selon eux, la guerre était l'affaire des militaires mais la France profonde n'en avait cure. Les armes apparaissaient de partout, même le gamin de quatorze ans que j'étais en avait une, comme d'autres enfants du village. Après les grands chocs frontaux, les armées alliées entraient dans les villes et les villages qui s'étaient libérés eux-mêmes. Et ce fut ainsi à Paris, « Paris par lui-même libéré ». La formule est du général de Gaulle arrivant en 1944 à l'Hôtel de Ville.
Je revins à Paris avec mes parents. Nous avions faim mais je crois que je me sentais bien, libre et vivant. Rue de Belleville, je passais devant une boutique en face des marches où Édith Piaf avait été trouvée bébé. Elle avait été le siège d'un groupe fasciste, je ne sais plus lequel, et occupée à la Libération par les Jeunesses communistes. Quelqu'un m'a reconnu et m'a demandé : « Henri, tu viens ? » Il m'a tendu un bulletin d'adhésion. J'ai dit oui sans hésiter. Cela me semblait aller de soi. À la maison, pour mes parents, ce n'était pas le cas. Non pas par hostilité aux communistes. Mais ma mère avait peur que les Allemands reviennent et tuent son fils. Ils ont d'ailleurs failli revenir, lors de l'offensive de von Rundstedt en Belgique. Elle a mis en difficulté les Alliés et aurait pu les rejeter à la mer. Cela aurait été un nouveau Dunkerque. Lorsque ma mère a vu tout ça, elle a brûlé ma toute récente carte des Jeunesses communistes. Puis ma mère et mon père se sont rassurés. Ils n'ont pas eu une vieillesse très heureuse, relativement pauvre. J'ai parfois regretté, non pas de les avoir laissés tomber, mais de ne pas les avoir assez aidés. Mais cela n'est pas réparable. Jeune, on ne fait pas assez attention à cela. On le regrette, bien sûr, mais il est trop tard.
À ce moment-là, beaucoup de jeunes adhéraient à la Jeunesse communiste et rejoignaient ce que l'on appelait un « cercle ». Des adhérents, dont certains avaient participé à la libération de Paris, venaient aux réunions avec leur pistolet dans la poche arrière. À Belleville, le cercle de la Jeunesse communiste portait le nom de Jacques Sornet, un jeune de la rue Vincent qui avait été tué sur les barricades. Entassés sur des bancs, garçons et filles écoutaient des rapports politiques, des conférences éducatives. Des responsabilités étaient confiées aux uns et aux autres. Sans oublier les sorties, le ciné, le bal, le théâtre, le camping. Rien que dans le XIXe arrondissement, il y avait dix ou quinze cercles et pas loin de mille adhérents.
La Jeunesse communiste a été mon université à moi... Une université populaire. Il n'y avait dans ce cercle qu'un seul bachelier. Tous les autres étaient des écoliers, des jeunes ouvriers, des employés de quinze, seize, vingt ans. C'était à la fois une organisation politique et une organisation de jeunesse. La fierté d'appartenir à cet élan initial ne m'a plus jamais quitté.
Vos parents étaient-ils engagés politiquement ?
Ils étaient étrangers et ne pouvaient pas voter. Ma mère parlait mal le français, mon père moyennement. Il lisait deux journaux par jour en yiddish, le journal socialiste Unzer Worth (« Notre Parole »), et le journal communiste, Naïe Presse (« La Presse nouvelle »).
Ils étaient donc de gauche, et absolument pas religieux. Ils n'ont d'ailleurs jamais pratiqué, n'ont jamais été sionistes. Ils aimaient la France et ils étaient contents d'être venus y vivre. C'étaient des gens simples, foncièrement honnêtes. Mon père considérait comme un devoir de travailler, de payer ses impôts, de ne pas avoir de dettes... Quand j'y repense, je me dis qu'il était un citoyen sans le savoir. Ils avaient subi la guerre et vu l'arrivée au pouvoir de Hitler. Ils suivaient la politique mais la subissaient. Tous deux ont été très fiers lorsque j'ai été élu conseiller de Paris. Ils n'en ont tiré aucun profit mais bon... ils étaient fiers. Tout en se demandant durant des années comment se terminerait mon engagement. La crainte, toujours la crainte, si forte chez les étrangers.
La leçon de vie de mon père était : « Sois un bon petit Français et apprends bien à l'école. » J'ai fait les deux, avant de quitter l'école à douze ans. J'aime la France, je la trouve belle. J'aime ce peuple qui de temps en temps pointe son nez, et alors tout bouge.
J'aime la politique dans ce pays, l'un des pays les plus politisés du monde où les partis politiques existent réellement, même avec leurs limites. Il y a vraiment des partis de droite, et même d'extrême droite hélas, un parti socialiste, un parti communiste, une extrême gauche... Tout cela me passionne.
J'y reviendrai, je ne crois ni à la réalité de la République, ni à la démocratie sans vrais partis politiques représentant le peuple dans sa diversité. Et j'aime comprendre le fond des choses, c'est-à-dire ce qui est en question lors des luttes politiques, l'intérêt des classes sociales et les conceptions de la société.
Vous avez adhéré à la Libération. La puissance de l'Armée rouge a-t-elle influencé votre choix ?
Bien sûr. La très grande majorité des Français savaient que c'était l'Armée rouge qui avait subi le choc principal de l'Allemagne de Hitler. À Stalingrad, en 1943, Hitler, qui volait depuis dix ans de victoire en victoire, avait subi une cinglante défaite. Deux cent cinquante mille soldats allemands tués, des colonnes de prisonniers, tout un état-major détruit et le maréchal Paulus capturé. Ce signal a retenti comme une promesse, un véritable espoir. Le rôle de l'Union soviétique a été décisif pour vaincre Hitler. L'historien britannique Antony Beevor le confirme dans son livre Stalingrad{1}. Même François Hollande l'a reconnu explicitement lors des cérémonies du soixante-dixième anniversaire du débarquement du 6 juin 1944.
D'ailleurs, jamais personne, ni à droite ni à gauche, n'a débaptisé la station de métro parisienne qui porte ce nom. Curieusement, le triptyque des stations qui se succèdent sur la ligne 2, c'est Colonel-Fabien (Pierre Georges, résistant communiste), Jean-Jaurès et Stalingrad.
À la sortie de la guerre, il n'y avait pas d'hostilité envers l'Union soviétique mais au contraire une immense admiration. De Gaulle lui-même, en décembre 1944, signa à Moscou ce qu'il appelait « la belle et bonne alliance avec l'Union soviétique ». Ce sont ses mots. Il désirait être soutenu par l'URSS pour participer aux négociations à la table des « quatre grands » car ni les Anglais ni les Américains ne souhaitaient y voir la France à ce niveau.
L'admiration pour l'URSS portait sur son rôle, son courage et son armée. Une reconnaissance massive et populaire qui allait de pair avec l'accueil superbe fait aux soldats de la France libre, aux Américains et Anglais entrant dans Paris libéré. L'idée selon laquelle cette alliance comportait des méchants et des gentils n'existait pas. Pour le peuple, et pour le jeune homme que j'étais, il n'y avait pas de conflit. Je dirais même qu'à l'époque, pour moi, Thorez et de Gaulle, c'était la même chose. Communistes et gaullistes, alliés dans la résistance...
Votre adhésion au communisme est-elle alors le fruit du hasard ? Auriez-vous pu devenir gaulliste ?
Je ne le crois pas, même si gaullistes et communistes partageaient un même amour de la France. J'étais déjà passionné par la compréhension du monde et je ne suis pas sûr que les conceptions véhiculées par le RPF et de Gaulle m'auraient séduit.
L'homme m'impressionnait, c'est tout.
Vous évoquiez la souffrance de l'Occupation, les fusillades, la faim... L'enfant que vous étiez a-t-il été fortement marqué par ces souffrances ou est-ce seulement avec le recul qu'elles ont été intériorisées ?
Je suis un enfant de juifs polonais, né en France. Nous avons tout vu, nous sommes passés au travers de la rafle du Vel d'Hiv mais mon père avait été interné au camp de Drancy. Il a failli partir à Auschwitz. En 1941, quelques centaines de personnes ont été libérées, il en était. Tous les hasards de cette époque et l'aide formidable du peuple français font que les trois quarts des juifs en France ont survécu. La mort de 75 000 à 90 000 personnes, les convois vers la mort, les chambres à gaz et les crématoires, c'est l'horreur de la Shoah. Il y avait avant-guerre 320 000 juifs en France. Nous sommes l'un des deux pays, avec les Pays-Bas, où les trois quarts des juifs ont été sauvés. Je ne supporte pas d'entendre dire que la France était un pays de collabos et de pourris ! Ce n'est pas vrai ! Si la France avait été ce pays, je ne serais pas là aujourd'hui.
Quant à ma famille, nous étions neuf à Paris. J'ai perdu un oncle, une tante et une cousine dans les chambres à gaz. Je ne parle pas des familles de mes parents en Pologne, plus de dix frères et sœurs de chaque côté. Tous ont péri. Le ghetto de Varsovie a été l'antichambre de leur mort. Vous vous rendez compte, plus de 400 000 êtres humains emmurés, morts de faim ou gazés presque jusqu'au dernier. Je pense avec émotion à l'héroïque insurrection du ghetto.
Pour revenir à la rafle du Vel d'Hiv, ma mère, ce matin de juillet 1942, accompagnait mon père au travail parce qu'elle avait peur. Mes parents étaient de braves gens, hors des réseaux résistants et ignoraient que c'était vers la mort qu'on allait les conduire. Ils étaient persuadés qu'il s'agissait de camps de travail. Ma mère a vu des juifs du quartier monter dans des bus. Elle a caché mon père, puis elle est venue me chercher, en me disant qu'il fallait fuir. Nous sommes alors entrés dans l'illégalité et avons vécu des aventures invraisemblables. Très souvent, c'est la solidarité des gens qui nous a sauvés.
Après la rafle du Vel d'Hiv, à laquelle vous avez échappé, qu'êtes-vous devenu ?
1942, 1943, 1944... trente mois qui allaient décider de ma vie et de celle de mes parents.
Nous nous cachions dans le minuscule atelier de mon père au 55 rue de Belleville, en sous-sol. C'est moi qui faisais les courses. J'avais retiré l'étoile jaune qui était cousue sur mes vêtements. Mon ami d'école Joseph Litera faisait de même dans une rue voisine. Il fut repéré par des policiers et suivi. Il finit dans les chambres à gaz avec ses parents. Lili, la petite fille qui était mon premier amour, mourut elle aussi à Auschwitz.
Vers la fin du mois de juillet, nous nous sommes regroupés avec la famille de la sœur de maman, cachée rue du Faubourg-Saint-Denis. Nous traversions Paris à pied, avec nos valises, pour éviter le métro et ses rafles. Ah ! Ces traversées de Paris à pied au milieu des gens, des policiers et des Allemands ! Je le redis : je n'oublie jamais que si le peuple français n'avait été composé que de ces dénonciateurs dont on nous parle parfois, nous ne serions pas vivants.
Un peu plus tard mes parents ont trouvé, je ne sais comment, un « passeur », nouveau métier très rémunérateur, pour nous aider à fuir vers le sud de la France non encore occupé par l'Allemagne à cette époque. Encore une fois, ce fut la traversée de Paris, la gare, le train. Je pense encore aux contrôleurs de la SNCF, qui, complices, ont fait semblant de ne pas voir ces étranges passagers. Nous étions dix familles dans cette aventure. Arrivés dans une petite gare dont j'ai oublié le nom, nous avons attendu et, le soir tombé, nous nous sommes mis en marche. Cette crapule de passeur nous a abandonnés en pleine nuit au milieu des champs labourés, avec notre peur et notre angoisse. Au petit matin, un paysan nous a repérés. Il a tout compris, nous a hébergés dans sa ferme et nous a nourris. Quelques jours plus tard, il nous a fait passer de nuit ce que l'on appelait « la ligne de démarcation ». Cet homme est une des si nombreuses personnes qui nous ont aidés et sauvés.
Au petit matin, sur une route de Touraine, des gendarmes nous ont contrôlés et nous ont dirigés vers Châteauroux où, par dizaines, et peut-être même par centaines, des juifs fuyant la France occupée dépensaient leurs derniers sous.
Mon père, complètement désargenté, a cherché du travail. Un comte et une comtesse cherchaient une cuisinière et un jardinier. Nous avons rejoint leur château. Le maître et la maîtresse étaient durs. Maman, qui n'en pouvait plus, faisait la cuisine et servait à table. Il y avait six enfants dont le dernier s'appelait Philippe, en hommage au maréchal Pétain. Madame pesait les pommes de terre avant que maman ne les épluche et pesait le tout après, des fois qu'un précieux tubercule ait disparu. Maman se vengeait en me faisant lever à six heures du matin, avec elle, pour que je puisse boire une partie du précieux lait à la Blédine destiné aux enfants des maîtres. Elle remplaçait une partie du lait par de l'eau. C'était sa vengeance.
Ces gens étaient durs mais eux aussi nous ont sauvé la vie.
Dans un village voisin nommé Francueil, une famille de viticulteurs, les Blondeau, ont repéré maman et lui ont proposé gratuitement une petite maison pour échapper à ce servage. Nous y avons été aidés, comme si nous étions de la famille, par ces gens merveilleux.
Sans doute dénoncés, nous avons vu les gendarmes arriver un matin. « Madame, Monsieur, vous n'avez rien à faire ici. Voici un commandement pour partir au camp de Douadic dans l'Indre près de la ville du Blanc. »
Mes parents s'y rendirent et moi avec eux. Français, je n'étais pas assigné à résidence, mais que faire d'autre ? Inconscience.
Le camp de Douadic n'était pas un camp de concentration, mais officiellement un « centre de regroupement » des étrangers, juifs, réfugiés allemands qui avaient fui Hitler, et des prostituées. Sur un terrain de plusieurs hectares, des baraques avec des bat-flancs, des matelas en paille, un réfectoire et des cuisines. Il était entouré de barbelés non électrifiés. C'était en vérité un espace d'attente, une réserve pour la déportation, qui avait déjà été utilisée pour des rafles en direction de Paris vers le camp de Drancy. En quelque sorte une antichambre pour la Solution finale. La Libération est venue à temps...
Je suis revenu à Paris en octobre 1944, dès que les transports ont été rétablis. J'avais quinze ans. Encore enfants, nous étions déj...