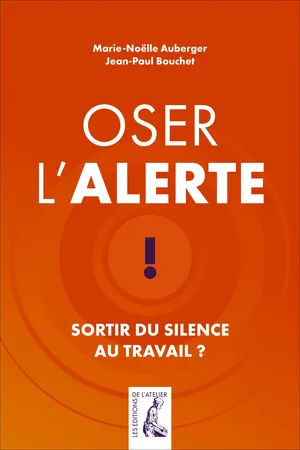![]()
Partie II
La parole à ceux qui ont osé
Les cas que nous présentons ici ne sont pas tous, tant s’en faut, des cas de lanceurs d’alerte au sens de la loi Sapin 2. Parfois, il est question d’alerteurs au sens du code du travail, parfois aussi d’alerteurs au sens donné à ce terme dans le langage courant. Dans leur majorité, ils sont des réponses à un appel à témoignages lancé par la CFDT Cadres à l’automne 2017.
Ces cas, tous authentiques, nous ont paru significatifs. Le fait que nombre d’entre eux ne correspondent pas strictement à la définition de la loi nous conforte dans l’idée qu’il convient d’élargir celle-ci afin de mieux soutenir ceux qui osent parler au quotidien.
Nous n’avons pas pu publier tous les cas qui nous ont été soumis et nous avons dû résumer, parfois drastiquement, ces témoignages. Le lecteur intéressé trouvera les versions complètes sur le site www.gestion-attentive.com/alerteauquotidien.
Pour des raisons de confidentialité, ils sont, sauf exception, anonymisés. Nous les avons regroupés dans trois catégories, peut-être arbitraires : engager sa responsabilité professionnelle (chapitre 4), signaler un dysfonctionnement (chapitre 5) et exercer son droit d’alerte et de retrait (chapitre 6). Ils sont suivis de quelques éléments d’analyse (chapitre 7).
![]()
Engager sa responsabilité professionnelle
Cette première série de cas d’alerte renvoie à la question de la responsabilité professionnelle. Quelle que soit cette responsabilité, quel que soit le statut ou le grade de la personne dans son environnement de travail, c’est dans le cadre de son travail, de son activité que celle-ci peut être confrontée à un problème, un dysfonctionnement, un manque de respect de règles internes ou de métier, de normes, bref à une situation qui représente un risque pour elle-même, pour ses collègues ou pour son environnement au sens large. Le choix de parler, d’informer, de signaler, d’alerter, ou au contraire de ne rien dire, de taire, de contourner parfois, appartient à chaque individu et dépend de très nombreux facteurs liés à la fonction, au rôle, à la responsabilité dans l’organisation mais aussi de son propre rapport aux règles, que ces dernières soient d’ordre réglementaire, déontologique ou éthique. La réglementation est du domaine du légal, la déontologie renvoie à des règles de métier, l’éthique à des valeurs personnelles, elles-mêmes liées à l’histoire personnelle et professionnelle de l’individu. Mais quels que soient le statut, le grade, la fonction, c’est bien au titre d’une responsabilité professionnelle que s’exerce ce choix d’alerter ou non. De nombreuses études mettent en évidence que les salariés ou agents les plus exposés aux questions de mal-être ou de souffrance au travail sont celles et ceux qui sont le plus attachés à bien faire leur travail, à la qualité du produit ou du service. Ce sont souvent les mêmes qui ne s’accommoderont pas de mauvaises conditions du « bien faire son travail » et seront plus enclins à alerter. Les quatre cas ci-après en apportent une illustration. Même s’il est difficile de parler de « profil type » du lanceur l’alerte, force est de constater que les personnes les plus attachées à la qualité de leur travail et du produit de leur travail (bien ou service) sont à la fois les plus exposées aux risques psycho-sociaux et les plus prompts à ou désireux de signaler et alerter.
Démarche qualité et alerte
Jacques Poirier est embauché en 1980 chez Rhône-Poulenc (qui deviendra au fil des années et des fusions Sanofi-Aventis) et y poursuit une carrière ascendante, devenant ingénieur assurance qualité avec rang de manager.
L’entreprise fabrique un médicament anticoagulant (plus précisément une héparine) nommé Lovenox, dont l’autorisation de mise sur le marché précise que la matière première utilisée doit être constituée uniquement de boyaux pur porc. L’essentiel des approvisionnements étant en provenance de Chine, Jacques Poirier, qui a des doutes sur le respect des normes sanitaires par ce pays, porte une attention particulière à ces achats. De possibles irrégularités dans les chaînes d’approvisionnement lui laissent penser qu’il pourrait y avoir des matières premières d’origine bovine dans le circuit. À cette date, la « maladie de la vache folle » n’est pas encore apparue dans les médias grand public mais la littérature scientifique met en garde contre les risques de maladie de Creutzfeldt-Jacob véhiculée par les ruminants. Jacques Poirier alerte sa hiérarchie à partir de 1991. Il insiste pour une traçabilité irréprochable en ce qui concerne tant l’origine d’espèce que l’origine géographique, la mise au point de méthodes pour déceler d’éventuelles fraudes ainsi que la validation du processus de fabrication. Ses avertissements sont d’abord bien reçus par la hiérarchie, puis les responsables qualité s’en irritent et l’alerteur a le sentiment d’être harcelé.
Il devient élu du personnel en 1997, en partie pour bénéficier d’une protection légale, car il a trois enfants à charge et il se sent pris entre son poste et sa conscience. « Je ne me suis pas tu mais je n’ai pas joué les chevaliers blancs », explique-t-il. Néanmoins, son salaire est quasiment bloqué, il n’a plus les mêmes relations avec sa hiérarchie, il se sent marginalisé. Épuisé, il prend acte de la rupture de son contrat de travail{34} en 2003, au moment où il trouve une offre d’emploi dans une ville de taille moyenne à un salaire bien inférieur. La société met alors en œuvre une procédure de licenciement mais ne motive pas celui-ci. Une guérilla juridique s’en suivra, et le tribunal des prud’hommes, saisi en 2003, rendra en 2011 un avis favorable à l’entreprise. Jacques Poirier – 51 ans lors de la rupture du contrat de travail et qui n’a entre-temps jamais retrouvé de travail stable – interjette appel. En avril 2015, la cour d’appel de Paris lui donne largement raison. Elle reconnaît le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le harcèlement moral mais, au grand regret de l’intéressé, ne lui attribue pas la qualité de lanceur d’alerte.
Jacques Poirier considère qu’il n’a fait que son travail et que le médicament en question peut être une bombe à retardement.
Il analyse le lien entre la démarche qualité et le lancement d’alerte. La démarche qualité, c’est « j’écris ce que je dois faire, je fais ce que j’ai écrit, je vérifie que j’ai bien fait ce que j’ai écrit ». Cette démarche a pour objectif d’aboutir à un cercle vertueux dans lequel le traitement des anomalies – erreurs, imprécisions – conduit à une amélioration progressive.
Si la démarche qualité d’une entreprise fonctionne bien, il n’y a pas de raison qu’il y ait alerte en direction de l’extérieur : celle-ci ne peut apparaître que lorsqu’une anomalie, volontaire ou non, se produit et qu’il y a une défaillance de la démarche qualité.
Refus de fraude aux Assedic
L’histoire se passe dans les années 1990. Jean-Luc est embauché comme responsable administratif et financier par une association qui dispense des formations en banlieue parisienne, avec une dizaine de salariés. L’association elle-même ne comporte que deux membres, la présidente et le trésorier. Ces deux personnes sont aussi les deux co-directeurs de l’entreprise, la directrice pédagogique et le directeur commercial. Dès son arrivée, Jean-Luc constate que les fiches de paie comprennent des cotisations Assedic pour toutes les personnes qui travaillent, y compris les deux dirigeants. Il prévient immédiatement que c’est contraire à la loi et qu’en cas de problème, ces deux personnes ne recevraient pas d’allocations-chômage. Le problème est exposé aux Assedic, qui demandent le montant des cotisations versées, certifié par les commissaires aux comptes. En l’absence de commissaire aux comptes du fait de la faiblesse du chiffre d’affaires, c’est Jean-Luc qui engage sa responsabilité personnelle sur le montant des cotisations. Les Assedic remboursent les cotisations, la part patronale revient dans les comptes de l’association, la part salariale à chacune des personnes concernées.
Deux ans après, un conflit entre les deux dirigeants conduit au départ du trésorier directeur commercial. La présidente directrice pédagogique vient trouver Jean-Luc et lui dit oralement qu’elle n’est plus présidente de l’association, cette fonction étant désormais assurée par sa nièce, jusqu’alors formatrice salariée, sans d’ailleurs fournir de procès-verbal d’assemblée générale. Elle lui demande alors de rétablir les cotisations Assedic sur son propre salaire mais pour autant de ne pas les enlever à la nouvelle présidente.
Jean-Luc refuse, la nièce étant dirigeante sur le papier et la tante dirigeante de fait, avec la signature sur les comptes bancaires. Du fait du départ du directeur commercial, l’association a du mal à trouver des contrats et la question de la cessation d’activité se pose, ce qui explique l’empressement des deux personnes en question à vouloir être, dans cette éventualité, couvertes par l’assurance-chômage. Jean-Luc argumente qu’en tant que cadre il doit connaître et respecter la loi et rappelle qu’il a engagé sa responsabilité vis-à-vis des Assedic deux ans auparavant. Il demande un ordre écrit, qui est signé par la directrice pédagogique, ce qui confirme l’état de dirigeant de fait de celle-ci, mais il ne l’exécute pas pour autant. Il est alors en butte à ce qu’on n’appelait pas encore du harcèlement moral : la clé de son meuble de bureau lui a été retirée, si bien qu’il n’a pas accès à ses dossiers en l’absence de la directrice et ne peut donc pas travailler avant l’arrivée de celle-ci, vers 11 heures. Les deux heures solitaires passées à lire le journal lui pèsent et l’atmosphère devient de plus en plus irrespirable. Il prend alors acte de la rupture du contrat de travail et porte l’affaire aux prud’hommes.
La directrice refuse la conciliation, fait traîner le dossier. Jean-Luc gagne en première instance ; l’employeur interjette immédiatement appel, avec le même résultat : un cadre ne doit pas obéir à un ordre qui lui ferait commettre un acte illégal, sa responsabilité professionnelle le lui interdit. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’assimile donc bien à un licenciement. La cour de cassation confirmera le jugement.
Entre-temps, Jean-Luc, qui approche de la cinquantaine et est très stressé par l’affaire qui a duré cinq ans, a eu du mal à retrouver un emploi.
Quand on lui demande pourquoi il n’a pas averti les Assedic de cette tentative de fraude, il répond que la dénonciation n’est pas son style et que par ailleurs aucune indemnité n’a été effectivement versée : « Ce n’était qu’une possibilité, puisque l’entreprise n’a pas cessé son activité. Les Assedic ont un service juridique, ils devraient se tenir au courant des procès qui les concernent et aller vérifier ce qui se passe dans les entreprises condamnées. »
Licenciement pour divergence stratégique
Nous sommes en 1995. Jean-Paul est directeur des systèmes d’information (SI) d’une banque dont la maison mère se trouve à Barcelone. Il est le seul Français parmi les six membres du comité directeur.
Le système d’information de la banque doit être renouvelé, un nouveau système est présenté par la maison mère, pour lequel la filiale de Monaco a réalisé un chiffrage du coût et des délais de l’adaptation. Après avoir examiné la solution monégasque, qui lui paraît irréaliste, Jean-Paul en parle à son équipe – il aime jouer collectif même s’il sait décider seul en bout de course – tant sur les aspects techniques que « politiques », à savoir l’injonction de la maison mère qui limite les marges de manœuvre. Il demande de faire appel à un expert extérieur, un spécialiste neutre. La direction parisienne hésite puis finit par accepter. La conclusion de l’expert est la même que celle de l’équipe interne : la solution prévue ne peut pas être mise en place dans les délais et les coûts affichés, et elle présente des risques. En conséquence, il faut chercher une autre solution.
Jean-Paul alerte à diverses reprises le comité de direction sur le grand écart entre les chiffrages ainsi que sur les risques encourus par l’entreprise en matière de non-qualité de service client. Il insiste pour explorer d’autres scénarios, mais cette demande est rejetée par la direction générale à Paris et celle du groupe à Barcelone. Cela le préoccupe beaucoup.
Certains collègues lui conseillent de parler discrètement de la situation avec les élus du comité d’entreprise. Il les rencontre secrètement à l’extérieur des locaux et attire leur attention sur les risques que le nouveau système fait courir à l’entreprise. Dans le cadre de leurs attributions économiques, ceux-ci demandent à la direction de les informer sur le projet de refonte du système informatique. À la demande de cette dernière, Jean-Paul apporte des informations en séance plénière. Les élus interviennent, débattent et conviennent que l’information devra être continuée, même si la direction ne demande pas de consultation au sens strict du terme. Mais Jean-Paul ne reviendra jamais devant le CE.
Un comité de direction extraordinaire est convoqué dans des délais très brefs et sans ordre du jour. Celui-ci, communiqué en début de séance par le directeur général, tient en un seul point : le futur système d’information de la banque. Il est demandé au directeur des systèmes d’information « un engagement ferme et définitif » sur le budget et le délai de mise en œuvre de la solution retenue par la maison mère et chiffrée par la filiale monégasque. Le directeur des SI refuse d’engager sa responsabilité sur un projet qu’il juge irréaliste. C’est pour lui une question de déontologie et de responsabilité professionnelle. Il considère que la décision de la maison mère va à l’encontre des intérêts de l’entreprise et donc de ses salariés et ne veut pas la mettre en œuvre. Il ne joue ni la loyauté aveugle ni l’hypocrisie – s’engager puis voir venir en arguant des impondérables quand les délais et les coûts exploseront. Les autres membres du Codir ne pipent mot et la réunion se termine très vite. Le directeur général se rend à la maison mère dans les jours qui suivent et en revient avec la décision de Barcelone : la rupture.
Les compétences professionnelles de Jean-Paul ne sont pas mises en doute mais la « divergence stratégique » entre la tête du groupe et le directeur des SI conduit le groupe à se séparer de celui-ci. En l’absence de faute et donc de motif justifiant le licenciement, l’entreprise est ouverte à une transaction. Après trois ans de bons et loyaux services, Jean-Paul doit partir immédiatement, il est « dispensé » de présence physique dans l’entreprise pendant les trois mois du préavis. Quand il passe, comme prévu, à son bureau le lendemain matin pour récupérer ses affaires personnelles, il a la surprise de trouver son successeur déjà assis dans son fauteuil, ce qui semble indiquer que son éjection était prévue depuis quelque temps.
Par la suite, ses ex-collègues lui ont donné régulièrement des nouvelles de l’entreprise : ni le délai ni le budget n’ont été tenus, comme il l’avait prévu.
Le choix imposé par Barcelone a coûté très cher budgétairement à la filiale française et a été à l’origine de la perte de nombreux clients insatisfaits de la qualité de service, conformément à l’analyse de Jean-Paul. Celui-ci apprendra par la suite que la solution monégasque relevait d’un arrangement entre amis, le directeur de Monaco et le numéro deux de Barcelone. La qualité des expertises ne comptait pas, tout était joué d’avance.
Les surcoûts dus à ce système inadapté ont conduit la direction à procéder à une réduction drastique des autres frais, en premier lieu en jouant sur la classique variable d’ajustement qu’est la masse salariale. Externalisation et plan social : l’emploi a été réduit de 20 %.
Les élus du comité d’entreprise ont à plusieurs reprises pointé la corrélation entre les choix opérés et les conséquences sur l’entreprise, la clientèle et les salariés. Mais cela n’a pas permis de sauvegarder les emplois concernés.
Jean-Paul a retrouvé un emploi dans les semaines qui ont suivi son éviction. Il a reçu plusieurs propositions, y compris en provenance d’entreprises prestataires ou partenaires de la banque, qui ont salué le courage dont il avait fait preuve en refusant de mettre en place une mauvaise solution.
« Qu’en aurait-il été, en cas contraire, deux ou trois ans plus tard, après un échec cuisant ? La profession ne me l’aurait sans doute pas pardonné » dit Jean-Paul, qui conclut : « Il est des refus au titre de sa responsabilité professionnelle qui préservent la suite d’une carrière, et c’est tant mieux. »
L’auditeur interne, un empêcheur de frauder en rond
On ne trouvera ici qu’une partie du témoignage de Marie-Claude Roinel, d’autres épisodes et la fin de l’histoire sont sur le site www.gestion-attentive.com/alerteauquotidien.
« En 1995, la Caiss...