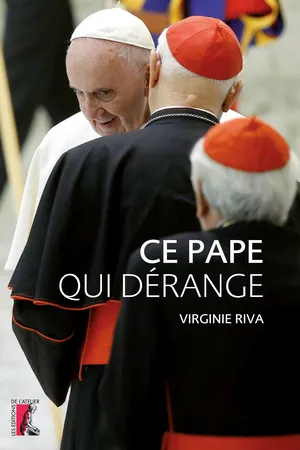![]()
Chapitre 1
La famille, ou comment François a provoqué un séisme dans l'Église
« Je préfère une famille blessée qui essaie tous les jours de vivre l'amour, à une société malade de l'enfermement et de la facilité de la peur d'aimer. Je préfère une famille qui essaie sans cesse de recommencer, à une société narcissique et obnubilée par le luxe et le confort. Je préfère une famille au visage épuisé par le don de soi, aux visages maquillés qui ne connaissent ni tendresse ni compassion. »
C'est ainsi que le pape défend une nouvelle fois le modèle de la famille, lors de son voyage au Chiapas en février 2016. Ses prédications, que ce soit avant ou après son élection au trône de Pierre, ont toujours fait une place très importante à la famille, qu'il défend également en tant que membre du comité de présidence du Conseil pontifical pour la famille au Vatican. Le pape n'est pas qu'un pasteur qui ouvre ses bras à tous, comme voudraient le faire croire un certain nombre de ses détracteurs. Il a également une vision très claire du modèle familial, fondée théologiquement, issue de la prédication franciscaine. Cette famille, comme le rappelle Mgr Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical en question, est pour Bergoglio le lieu de l'amour comme don de soi pour l'autre, au sens chrétien de l'agapê, loin de la culture du provisoire. En ce sens, elle est le lieu de développement de la personne humaine, et celui de l'évangélisation : c'est là que la foi est reçue, puis vécue{12}.
Le pape a bien conscience de la crise que subit la famille, et de la crise de transmission des enseignements de l'Église sur ce sujet. La plupart des familles chrétiennes n'écoutent plus ses prescriptions, qu'il s'agisse de la contraception par exemple, ou de la cohabitation. Combien de jeunes couples catholiques vivent ensemble avant le mariage ? Dans cette perspective, l'idée de convoquer un synode sur ce thème est aussi celle de sauver la famille, et surtout de faire entendre le message de l'Église, qui, de ce point de vue, a l'impression de prêcher dans le désert depuis des décennies...
Cette réflexion s'articule avec une vision de la famille incarnée, réaliste, intergénérationnelle, qui prend aussi acte de ses épreuves, de ses difficultés. En regardant la famille comme elle est, le pape demande aussi que la miséricorde passe avant la morale : voilà le grand défi du pontificat de François. Et s'il est un terrain sur lequel ce changement de priorité provoque bien des résistances, c'est bien celui de la famille. Le pape, qui accorde plus d'importance aux blessés qu'aux héros, s'est assez logiquement attaqué aux évolutions contemporaines de la famille, à ses échecs, à ses recompositions. Il sait combien les personnes divorcées, les personnes homosexuelles et celles qui ont avorté peuvent s'éloigner de leur Église, parce qu'elles se sentent condamnées. Voilà l'Église qu'il défend, comme il le rappelait dans son discours de fin du premier synode : « L'Église qui a les portes ouvertes pour recevoir ceux qui sont dans le besoin, les repentis, et pas seulement les justes ou ceux qui croient être parfaits ! L'Église qui n'a pas honte du frère qui a chuté, et qui ne fait pas semblant de ne pas le voir{13}. »
Mais en convoquant deux synodes sur la famille en octobre 2014 et 2015, le pape a ouvert une boîte de Pandore...
La grande bataille du synode
Retour en 2014
Impossible de comprendre le rapport final du 24 octobre 2015 sans se remémorer le premier épisode du synode, un an plus tôt. Cette année-là, l'Église découvre le thème éminemment complexe et clivant que le pape François a choisi de soumettre à la réflexion des évêques du monde entier, dans le but de produire ensuite un document, une exhortation apostolique. Une exhortation à resituer dans le contexte d'une insistance récente et nette sur les thématiques de la sexualité, de la contraception et du mariage. Depuis l'encyclique Humanae Vitae sur la contraception (1968), suivie des pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI, la critique est toujours plus forte contre les dangers du « relativisme éthique ».
En parallèle de cette focalisation des papes sur le dogme, les laïcs catholiques, partout en Europe, sont descendus dans la rue pour s'opposer à la laïcisation des mœurs. De nouveaux droits sont apparus, portant en premier lieu sur le divorce et l'IVG, qui remettent en cause la morale traditionnelle défendue par l'Église. Ce n'est qu'en 1984 que l'Église italienne s'interdit de remettre en débat le divorce. À la fin des années quatre-vingt apparaissent les questions de la reconnaissance de droits aux couples homosexuels. Dans les pays traditionnellement catholiques – Espagne, Italie, Belgique, et... France – la mobilisation s'organise en « marches pour la famille ». En juin 2005, en Espagne, 600 000 personnes défilent contre le projet de loi du gouvernement Zapatero pour le mariage gay et l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Une vingtaine d'évêques participe au cortège. La même année, en Belgique, 4 000 personnes se réunissent à Bruxelles à l'appel du collectif « Marche pour la famille », soutenu par les évêques sans qu'aucun pourtant, à l'exception du conservateur Mgr Léonard, n'y participe. En Italie, le « Family Day » bloque en 2007 l'adoption d'un projet d'union civile entre personnes de même sexe, et fait tomber le gouvernement Prodi. Le projet de loi sur les unions civiles n'est finalement voté qu'en 2016, grâce à la force et à la manœuvre politique de Matteo Renzi, qui doit cependant de nouveau faire face à la mobilisation de cette opposition. Mais aussi grâce à la nouvelle doctrine de non-ingérence de la Conférence épiscopale italienne promue par le pape François. Rappelons simplement à titre d'exemple qu'en 2005, lors du débat en Italie sur le référendum abrogatif de la loi très restrictive sur la procréation assistée, Benoît XVI avait appuyé de manière indirecte, dans un discours prononcé lors du Congrès sur la famille, la position de la Conférence épiscopale italienne en réaffirmant le caractère sacré de la vie humaine{14}. Le président de la Conférence, le cardinal Ruini, avait de son côté appelé les Italiens à s'abstenir. Partout, avec l'appui du discours papal, les initiatives politiques menées par les laïcs catholiques se développent autour de ce que Benoît XVI a appelé les « principes non négociables ». En France, la mobilisation contre le Pacs en 1999 est déjà forte. Mais lorsque le gouvernement touche au mariage, les oppositions deviennent nettes, et massives, comme le montre l'exemple de la Manif pour tous en 2013{15}.
Du côté du Vatican, le pape François, dans la ligne directe de ses prédécesseurs et notamment de Paul VI, s'est montré très inquiet quant à l'effondrement de la démographie européenne, liée en partie à la libéralisation de la pilule et de l'avortement, et il l'a fait savoir, allant jusqu'à conseiller un nombre d'enfants juste et nécessaire pour le bien commun, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays riches{16}. Mais le discours du pape a entre-temps bien changé sur les thèmes défendus par le militantisme chrétien, encouragé par les papes depuis Jean-Paul II. « Nous ne pouvons pas insister seulement sur les questions liées à l'avortement, au mariage homosexuel et à l'usage des contraceptifs. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas beaucoup parlé de ces choses, et on me l'a reproché. Mais lorsqu'on en parle, il faut le faire dans un contexte précis. La pensée de l'Église, nous la connaissons, et je suis fils de l'Église, mais il n'est pas nécessaire d'en parler en permanence. Les enseignements, tant dogmatiques que moraux, ne sont pas tous équivalents. Une pastorale missionnaire n'est pas obsédée par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines à imposer avec insistance. L'annonce de type missionnaire se concentre sur l'essentiel, sur le nécessaire, qui est aussi ce qui passionne et attire le plus, ce qui rend le cœur tout brûlant, comme l'eurent les disciples d'Emmaüs. Nous devons donc trouver un nouvel équilibre, autrement l'édifice moral de l'Église risque lui aussi de s'écrouler comme un château de cartes, de perdre la fraîcheur et le parfum de l'Évangile. L'annonce évangélique doit être plus simple, profonde, irradiante. C'est à partir de cette annonce que viennent ensuite les conséquences morales », lance-t-il dans son premier grand entretien à la revue jésuite Civiltà cattolica en 2013{17}. C'est à la « hiérarchie des vérités » de la foi selon la théologie de l'Église que François se réfère ici. Comme l'explique Victor Manuel Fernández, recteur de l'université pontificale de Buenos Aires et ami du pape François, c'est un thème central pour ce dernier : « Les vérités ne sont pas toutes importantes de la même façon, précisément “en raison de leur rapport différent avec le fondement de la foi chrétienneᾹ. Ceci est valable autant pour les dogmes de la foi que pour l'ensemble des enseignements de l'Église, y compris la morale [...]. Dans la prédication, l'accent doit être mis davantage sur les vérités qui expriment directement le cœur de l'Évangile. Cette juste proportion dépend aussi de la fréquence avec laquelle les thèmes sont abordés{18}. »
Le pape François est un fervent défenseur de la vie, du mariage et de la famille catholique. Mais il ne souhaite pas que ces vérités prennent la forme d'un discours moral, ou idéologique, qui se révèle souvent bien plus excluant que miséricordieux. En témoigne cette formule exceptionnelle, prononcée dans l'avion qui le ramène de son voyage en Amérique latine en juillet 2013, en réponse à une question sur l'existence d'un lobby gay au Vatican – question que le pape élargit à l'attitude d'un chrétien envers toute personne homosexuelle : « Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour juger ? » Une phrase qui, ridiculisée dans certains milieux conservateurs, devient : « Qui suis-je pour juger ? Eh bien, le pape ! » Des conservateurs qui ne supportent pas l'attention portée aux vies accidentées, aux situations qui se détournent de la plus pure doctrine de l'Église. L'accent mis sur la « pastorale », soit l'accueil dans l'Église, entraîne à leurs yeux l'affaiblissement certain de la doctrine de l'Église, et de son fondement central, le mariage. Ils critiquent ouvertement le pape lorsqu'il ne va pas dans le sens d'une défense aveugle de ces principes. Une critique presque immorale chez ces défenseurs à tout crin de l'institution, comme le souligne encore Victor Manuel Fernández : « Jusqu'à il y a deux ans, certaines personnes n'auraient jamais accepté que les paroles du pape soient discutées, alors que, maintenant, ils se mettent à critiquer le pape François de bien des façons. Ils ne portent pas un regard de foi, ils mènent une bataille idéologique : “Je défends le pape s'il défend mon point de vue.Ᾱ De fait, ils profitent de la liberté que ce pape nous accorde à tous{19}. »
Dans ce contexte, le pape sait en octobre 2014 qu'ouvrir un synode sur la famille est très certainement nécessaire pour l'Église, mais également périlleux. Il connaît parfaitement les divisions théologiques, les clivages géographiques sur les questions du mariage, de l'homosexualité, du divorce... L'Europe est de ce point de vue un continent à part. Peut-être espère-t-il, lors de la première session du synode de 2014, faire éclater ces divisions au grand jour, en encourageant, dans chacun de ses discours, la « libre discussion ».
De leur côté, les journalistes sont rapidement accusés de plaquer les catégories du jeu politique pour analyser l'événement (d'un côté, les progressistes, de l'autre, les conservateurs) et de se focaliser uniquement sur la question de l'accès au sacrement pour les divorcés remariés civilement. C'est pourtant bien ce sujet qui divise à Rome en cette année 2014, comme le prouve l'exemple du cardinal et théologien allemand Walter Kasper, « progressiste », qui demande, lors du Consistoire des cardinaux de février 2014 consacré au thème de la famille, un « changement de paradigme » nécessaire. Il rappelle à cette occasion que la doctrine n'est pas une « lagune stagnante », mais qu'elle a vocation à être approfondie, mise en congruence avec les « signes des temps ». Il ouvre également la voie à une réflexion sur le problème particulier des divorcés remariés. Il propose la solution d'une « pratique pénitentielle » pour ramener ces derniers vers le sacrement de l'eucharistie, une pratique qui existait pour les chrétiens des premiers siècles qui avaient abdiqué leur foi en raison des persécutions, et qui souhaitaient ensuite être réintégrés dans la communauté pour un second baptême.
Une véritable « bombe » huit mois avant le synode. D'autant que le pape François décide de le remercier très chaleureusement pour son intervention : « Hier [...] j'ai relu le travail du cardinal Kasper et je voudrais le remercier, parce que j'y ai trouvé une profonde théologie, et une pensée sereine dans sa théologie. C'est agréable de lire une théologie sereine. Et j'y ai trouvé aussi ce que saint Ignace disait : ce “sensus EcclesiaeᾹ, l'amour de notre mère l'Église. Ça m'a fait du bien, et il m'est venu [...] l'idée que cela s'appelle faire de la théologie à genoux. Merci{20}. » Des encouragements du pape qui provoquent en retour la réaction des « conservateurs » comme le cardinal australien Pell, préfet du secrétariat pour l'Économie, ou le cardinal Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui ne souhaitent aucun affaiblissement du dogme sur l'indissolubilité du mariage. Ces discussions, avant même le début du synode, font rage à Rome dans les conférences organisées par les différentes universités pontificales – qu'elles soient « progressistes » comme la grégorienne ou « conservatrices » comme l'université de la Sainte-Croix, fondée par l'Opus Dei, ou l'Institut Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille à l'université pontificale du Latran –, et même jusque dans les librairies. Peu après le Consistoire, Walter Kasper sort son livre, L'Évangile de la famille{21}, auquel répond le livre-entretien du cardinal Müller, L'Espoir de la famille{22}, ou encore celui du cardinal Pell, au titre très clair : L'Évangile de la famille : pour aller au-delà de la proposition du cardinal Kasper sur le débat du mariage, du remariage civil et de la communion dans l'Église{23}. Sans parler de Demeurer dans la vérité du Christ, mariage et communion dans l'Église catholique{24}, compilation d'essais de cinq cardinaux de la curie romaine dont le cardinal Müller.
La question de l'accès au sacrement des divorcés remariés civilement – minoritaires numériquement – n'est certes pas l'unique question que doit affronter le synode, mais elle cristallise en elle-même tous les enjeux. Elle touche à la fois à la doctrine sur le mariage et à la doctrine sur l'eucharistie, deux piliers centraux de l'Église.
La méthode synodale
Le synode, instrument inauguré par Paul VI en 1965, a été mis en place pour renforcer la collégialité dans l'Église universelle : « odos » signifie le chemin, et « syn » ensemble. Mais plusieurs d'entre eux ont été conflictuels. Nicolas Senèze, journaliste à La Croix, rappelle ainsi celui de 1971, consacré au délicat thème du célibat sacerdotal, ou même celui consacré à l'évangélisation, quatre années plus tard{25}, qui connaissent déjà l'un comme l'autre un certain nombre de tensions.
La ...