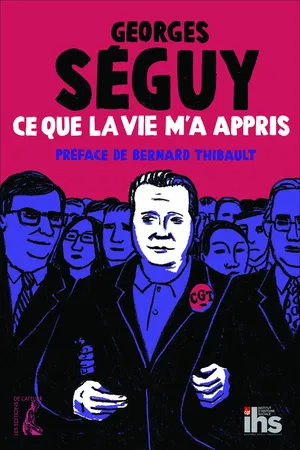![]()
Chapitre 1
« J’ai opté pour la bicyclette »
Je suis né le 16 mars 1927 à Toulouse. Mon père était cheminot ; ma mère, sans profession, un peu lingère. Nous étions une famille nombreuse ; j’ai deux sœurs aînées. J’ai vécu mon enfance dans cette ville de Toulouse, dans une famille, tout de même, dont le père était engagé, syndicalement et politiquement. Il avait adhéré au Parti socialiste en 1919 et s’était retrouvé dans la mouvance communiste après le congrès de Tours{6}. J’ai donc passé ma plus prime enfance dans une famille où les questions syndicales et politiques occupaient une certaine place.
Peu après ma naissance, mes parents ont fait construire une maison dans la banlieue de Toulouse, avec un emprunt « loi Loucheur » comme on disait à l’époque ; et toute la famille s’est retrouvée dans un habitat un peu dans la nature, de sorte que j’ai passé mon enfance de petit Toulousain dans la banlieue de Toulouse.
J’ai donc appris à apprécier la nature, l’écologie, les animaux. J’allais à l’école communale. J’ai eu, lorsque j’avais 7 ans, un instituteur qui s’appelait Georges Fournial, et qui était aussi un militant communiste. D’ailleurs, c’est dans sa classe que j’ai fait ma première grève ! Il avait été arrêté par la police au moment des manifestations antifascistes en 1934 à Toulouse, et les parents d’élèves avaient décidé que leurs enfants n’iraient pas à l’école tant que notre instituteur ne serait pas libéré (sourire). Quand Georges Fournial – que j’ai retrouvé après dans ma vie militante, à Paris – a été libéré, il y a eu un moment d’émotion dans cette classe d’enfants de 7 à 8 ans, et qui a marqué, sûrement, la mémoire de tous.
Tout cela pour dire que mon enfance s’est passée dans un cadre familial dont on peut dire aujourd’hui qu’il était assez engagé, syndicalement et politiquement. C’est à cette période que nous avons traversé la lutte contre les manifestations fascistes du colonel de La Rocque{7} – on en parlait souvent dans la famille – et que nous nous sommes trouvés, enfants, engagés dans la solidarité envers le peuple espagnol au moment de la guerre d’Espagne. Je me souviens encore des collectes que nous faisions, parmi la population, pour aider les républicains espagnols. Je me souviens aussi de certains amis, plus jeunes que mon père, qui s’étaient engagés dans les Brigades internationales... Tout cela a créé un climat particulier qui nous prédisposait, sans doute, à nous trouver du côté de ceux qui bannissaient le fascisme et tout ce qui engendre le racisme, la xénophobie, etc.
La période était celle qui suivait les luttes antifascistes, et qui précédait la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu, à ce moment-là, à Toulouse, un événement auquel mon père a participé activement, avec ses camarades du syndicat des cheminots CGT de Toulouse : c’est le congrès entre la CGT-U et la CGT confédérée (les « unitaires » et les « confédérés »{8}, comme on disait alors), qui a scellé l’unification syndicale de la CGT au mois de mars 1936. Cet événement, qui est resté d’une très grande importance pour l’histoire syndicale de notre pays, nous l’avons vécu, en quelque sorte, « en direct », puisque beaucoup de délégués des cheminots participaient au congrès – et parmi eux, un homme dont le nom est resté aussi dans l’histoire, Pierre Semard. Il venait passer quelques instants à la maison, à Toulouse, boire l’apéritif, ou prendre le repas du soir. J’ai donc connu nombre de ces militants, dont les noms ont ensuite pris beaucoup de notoriété, dans ces réunions familiales.
Je me souviens aussi qu’après ce congrès de l’unité, au moment du Front populaire, pour la première fois de notre vie, nous sommes allés en vacances : toute la famille réunie, sur la côte basque, à Bidart. Mon père avait loué un petit appartement ; nous ne disposions pas d’un grand espace vital (rire) mais c’était bien agréable, dans la mesure où nous avions la mer, que nous voyions pour la première fois (enfin, sinon mes parents, au moins les enfants). En 1938, nous avons séjourné à deux reprises sur cette côte basque. C’était la guerre d’Espagne et je me souviens que mon père nous faisait écouter les bruits des canons que l’on entendait de l’autre côté des Pyrénées. Il nous disait : « Si la France ne fait pas tout ce qui est de son devoir pour venir en aide aux républicains espagnols, nous risquons de connaître des situations difficiles, non seulement en Espagne, mais peut-être aussi dans notre propre pays. » Tout ça est resté dans ma mémoire.
Toujours en 1938, et comme mon père était réticent à l’idée de me faire faire ma première communion (alors que ma mère – croyante mais pas pratiquante – et ma grand-mère le souhaitaient), il m’avait promis, si je m’abstenais d’aller au catéchisme et de faire ma première communion, de m’acheter une bicyclette, tandis que ma grand-mère m’avait promis une montre ! Moi, j’ai opté pour la bicyclette ! (rire) Le curé de mon quartier, à Toulouse, est venu demander à ma mère pourquoi je n’allais pas au catéchisme, pourquoi je n’étais pas inscrit pour faire ma première communion. Elle lui a dit : « Son père lui a promis une bicyclette ! » Et ce curé, qui avait de l’esprit, lui a répondu : « Mais vous savez, madame, ce n’est pas à bicyclette que l’on monte au ciel ! » (rire) Ça n’avait pas suffi à me convaincre, et je n’ai donc pas fait cette première communion. Mais j’ai continué à travailler à l’école de mon mieux, sans être un élève particulièrement brillant, jusqu’à mon certificat d’études que j’ai passé à 11 ans en 1938. Je sais que cette période du Front populaire, avec les avancées sociales qui avaient été obtenues par les cheminots, avait un peu adouci la vie dans notre famille, au sens matériel du terme.
J’ai passé mon certificat d’études primaires en 1938, à la fin du Front populaire, et cette période a marqué ma mémoire dans la mesure où mon père, qui était cheminot, militant syndical, s’est trouvé engagé très vite dans les négociations avec le gouvernement et la SNCF – qui venait d’être créée par la nationalisation des chemins de fer en France en 1937. Je me souviens qu’il « montait » – comme on dit à Toulouse – régulièrement à Paris pour participer à la commission qui discutait de l’élaboration, pour les cheminots, de la semaine de quarante heures. Ma vie n’avait rien d’extraordinaire si ce n’est que nous étions une famille de condition modeste, mais toujours avec le nécessaire pour vivre normalement. Et disons que, de par nos relations familiales, du côté de mon père surtout, c’est dans la mouvance syndicale CGT et communiste que, sans doute, une influence s’est exercée pour l’enfant que j’étais, et qui se trouvait, au moment de l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, déjà au fait d’un certain nombre de choses particulières, qui ont marqué par la suite les principaux événements que notre pays a traversés.
Mais dans les années 1938 et 1939, le climat s’est sérieusement alourdi, avec la dégradation de la situation, le fascisme qui pointait dangereusement en Allemagne, après ce qui s’était passé en Espagne, et auparavant, en Italie, et nous vivions – je me souviens très bien de cette époque-là – un peu dans l’inquiétude, et même l’angoisse, je dirai, de l’évolution de la situation. C’est à ce moment-là qu’est intervenu le Pacte germano-soviétique{9} qui n’a pas été sans provoquer beaucoup de préoccupations dans notre propre famille.
Mon père, qui était un militant communiste né aux idées révolutionnaires avec la révolution d’Octobre, était un profond admirateur de l’Union soviétique – « le premier pays socialiste », « la première révolution prolétarienne » (sourire), comme on disait à l’époque – et par conséquent, il était resté de tout temps un fidèle partisan de l’Union soviétique. De sorte que, lorsque le Pacte germano-soviétique est intervenu, son analyse a été la suivante : « Je ne comprends pas très bien les raisons de Staline, mais je suis sûr qu’elles justifient qu’une telle décision ait été prise, et qu’un tel pacte ait été conclu. » Et je me souviens qu’à ses camarades, qui venaient le voir pour lui demander son sentiment, il disait : « Je ne comprends pas bien, mais si tu me dis du mal de Staline, on ne pourra pas être d’accord, j’ai confiance en lui. » Il ne comprenait pas, mais il pensait qu’il fallait faire ça, que c’était inévitable.
Pour ce qui me concerne, je me suis longtemps posé des questions avec les éléments qui ont été à notre disposition par la suite. Sans doute, on ne peut pas analyser ce « pacte », et la signification qu’il avait au moment où il est intervenu, indépendamment de tout ce qui l’a précédé. Notamment les propositions de l’Union soviétique au moment de la guerre d’Espagne pour intervenir de concert contre la menace fasciste en Espagne. Ensuite, les propositions d’alliance de l’Union soviétique aux gouvernements français et anglais, pour essayer de faire un front commun face à la menace de l’hitlérisme... Enfin, les Accords de Munich{10}, l’abandon de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, tout ça ! C’est difficile d’isoler le Pacte de tous ces autres événements qui ont été marquants pour cette période de l’histoire. Mais finalement, avec le recul et le temps, j’en suis arrivé à penser qu’il aurait mieux valu faire l’économie du Pacte germano-soviétique. Et je pense que les conséquences – pour le mouvement ouvrier français, en premier lieu – ont été très néfastes car, sans doute, beaucoup de ceux qui étaient engagés dans cette mouvance politique, non seulement n’ont pas compris les raisons profondes du parti (c’était le cas de mon père), mais beaucoup sont allés jusqu’à désapprouver, désavouer, et ont adopté une attitude qui a été, pour beaucoup d’entre eux, une rupture avec leurs affinités syndicales et politiques.
![]()
Chapitre 2
« Je n’ai jamais perdu la raison... »
Dans le camp de Compiègne{11}, j’ai rencontré beaucoup de personnes que je ne connaissais pas auparavant, que je n’avais pas rencontrées dans la Résistance. Il y avait des résistants, de différentes sensibilités d’ailleurs, et beaucoup de personnes qui avaient été arrêtées, au hasard des rafles, ou qui avaient été prises comme otages. Et quelques-unes, même, qui avaient été condamnées à mort, et qui en avaient réchappé dans des conditions particulières.
La répression féroce dont les résistants étaient victimes a été, sans doute, une des motivations principales de mon engagement dans la Résistance. J’étais évidemment dans l’état d’esprit d’une partie de ma famille, comme je l’ai dit, et sensibilisé à l’idée qu’il ne fallait pas s’incliner devant le fascisme et les occupants hitlériens. Mais de là à vouloir à tout prix entrer dans la lutte armée (sourire), il y avait de la marge, surtout à 15 ans !
Châteaubriant{12} avait causé, dans notre famille, un choc terrible. Et lorsque j’ai appris que Pierre Semard – proche ami de mon père, qui m’avait tenu sur ses genoux quand j’étais petit (sourire), au moment du Front populaire, et que je connaissais comme un membre de la famille – avait été fusillé, le 7 mars 1942, par les nazis, j’ai absolument voulu m’engager dans la Résistance. Et c’est ce qui, sans doute, a déterminé ma volonté d’arrêter mon activité scolaire, pour participer, pour faire quelque chose avec les autres, pour... me battre (sourire), me battre contre cet ennemi implacable qui était devenu une obsession.
À Compiègne, j’ai rencontré des jeunes qui avaient été arrêtés dans nos maquis (du Lot, de la Haute-Garonne, de l’Ariège) et qui m’avaient expliqué que, bien qu’ils n’aient pas eu de motivation particulière pour faire de la résistance, ils avaient accepté de prendre le maquis comme nous le leur proposions pour échapper au Service du travail obligatoire en Allemagne (STO). Il faut dire que, depuis 1942, nous faisions beaucoup d’activité de propagande pour dissuader les jeunes de partir à la conscription obligatoire puis au STO, pour ne pas servir la machine de guerre allemande par un travail de cette nature. Et c’est à partir de février 1943, après la bataille de Stalingrad{13}, que nous avons trouvé chez ces jeunes un écho plus large à nos appels (sourire). Car je crois que la bataille de Stalingrad a mis un terme au mythe de l’invincibilité de l’armée allemande, de la Wehrmacht de Hitler. Et c’est à partir de ce moment-là que beaucoup de gens ont compris que quelque chose venait de basculer, qu’il y avait un tournant, que Hitler ne s’en sortirait pas, et que, par conséquent, l’avenir appartenait à ceux qui se trouvaient du côté du combat contre le fascisme, l’hitlérisme. C’est un fait historique, la Résistance a pris une dimension un peu plus importante à partir de 1942. Et ça a continué en 1943, jusqu’en 1944.
C’est un peu ce climat de refus qui régnait au début de l’année 1944, au camp de Compiègne-Royallieu, où je me trouvais, avec tous ceux qui avaient été arrêtés, comme moi, dans notre affaire de Toulouse{14}, et aussi avec beaucoup d’autres résistants. Nous y sommes restés deux à trois semaines environ. Sans occupation particulière, soumis à aucune contrainte de travail, avec quelques petites corvées par-ci par-là. C’est à l’occasion de telles corvées que certains ont pu se sauver, s’échapper... mais cette occasion-là ne s’est pas présentée pour moi, donc je me suis trouvé jusqu’au bout à Compiègne. Il y avait des conférences, on se réunissait pour parler de choses et d’autres, pas trop compromettantes, on se racontait des histoires, on chantait des chansons... Mais c’était la grande incertitude, au fond. Qu’allions-nous devenir ? Nous savions que nous ne serions pas libérés, qu’à Compiègne ce n’était pas la fin. Mais qu’allait-on faire de nous ? Nous l’ignorions. Bien entendu, nous avions parlé de ce qui se passait en Allemagne, de la manière dont les antifascistes allemands avaient été persécutés, mis dans des camps de concentration, mais, à vrai dire nous ne connaissions pas l’univers concentrationnaire nazi : les camps de la mort et les camps d’extermination tels qu’on les a découverts par la suite, vers la fin, et tout à fait après la Seconde Guerre mondiale.
C’est dans ces conditions qu’un beau jour – un 22 mars, je crois –, nous nous sommes retrouvés tous appelés, mis en colonne. Direction la gare de Compiègne. Et là, par ordre alphabétique, on nous a mis dans des wagons à bestiaux (portant l’inscription : « chevaux : 8, hommes : 60 »). Avec nos petits bagages (parce que nous n’avions pas beaucoup de bagages, évidemment). Et, entassés à cent par wagons, nous sommes expédiés dans un train... à destination inconnue.
Nous ne nous connaissions pas tellement les uns les autres, à part quelques-uns. C’était des convois, des wagons métalliques, à plancher de bois. Au milieu du train, il y avait un wagon plateforme avec des SS derrière une mitrailleuse. En queue du train aussi. Embarqués vers 14 heures, nous avons voyagé à petite vitesse pratiquement tout l’après-midi. La nuit tombait vers 18-19 heures.
Un certain nombre d’occupants se sont mis à scier les planches du wagon où nous nous trouvions, avec des moyens qu’ils avaient réussi à dissimuler. Au bout d’un certain moment, ils ont réussi à scier suffisamment de planches du wagon pour faire passer un corps. Trois ou quatre personnes ont pu sauter. Mais le train s’est arrêté immédiatement, des phares balayant le convoi de bas en haut et de haut en bas, et tout le long du wagon. Les SS sont arrivés en hurlant, en vociférant je ne sais quoi. Nous avons dû tous nous déshabiller, nous mettre à poil dans le wagon, puis nous avons sauté sur le ballast, tous nus intégralement. Et ils ont mis deux wagons dans le même : c’est-à-dire que nous nous sommes retrouvés deux cents personnes, deux cents détenus, à poil, complètement nus, dans le même wagon. Les premiers qui ont sauté du wagon une fois dévêtus ont essuyé une rafale de mitrailleuse, de sorte que nous avons rembarqué quatre personnes blessées par balle.
Ce fut un moment pénible et difficile pour nous, car il y eut tout de suite, parmi ces pauvres bougres qui se trouvaient là-dedans, ceux qui se sont mis à critiquer la tentative d’évasion, parce que, disaient-ils, « s’il n’y avait pas eu ça, ces représailles n’auraient pas eu lieu ». D’autre disaient : « Ils ont bien fait ! Si on peut, on va recommencer, parce qu’il ne faut pas accepter de se laisser conduire comme du bétail on ne sait où... Et que peut-il nous arriver ? » Il y a eu un déchaînement de contradictions, de discussions, de désaccords profonds et sérieux, mais dans une situation très difficile. Et les SS avaient prévenu : « S’il y a une nouvelle tentative d’évasion, nous ferons descendre tout le monde, et nous tirerons avec nos mitrailleuses pendant un quart d’heure, sans arrêt, sur tout le groupe. » Il y avait donc la hantise de nouvelles évasions. En vérité, il n’y en eut pas mais, dès la première nuit, les relations entre les détenus ont commencé à se détériorer, parce qu’il n’y avait aucune possibilité de boire et encore moins de manger, aucune possibilité d’assouvir ses besoins personnels, pas de tinette, rien. Les besoins les plus pressants ne pouvaient s’assouvir que debout, puisqu’il n’y avai...