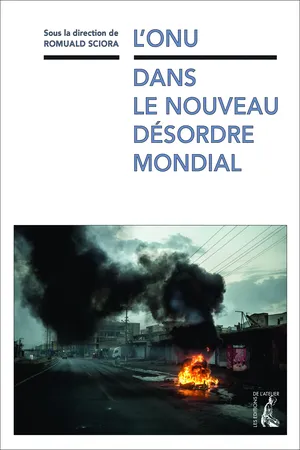![]() I
I
Dans le nouveau désordre mondial![]()
Une organisation centrale
Par Anne-Cécile Robert, journaliste française, directrice des éditions et des relations internationales du Monde diplomatique
L'un des quatre buts assignés aux Nations unies (ONU) en 1945 semble aujourd'hui disparaître des mémoires : « Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers [l]es fins communes » énoncées par la charte de San Francisco (article 1 alinéa 4). Il est à rapprocher des trois autres alinéas qui attribuent à l'ONU le mandat le plus large : outre le maintien de « la paix et [de] la sécurité internationale », l'Organisation doit « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ».
Or le développement des relations internationales depuis une trentaine d'années fait courir à l'ONU un véritable risque de marginalisation. Elle n'est pas le point de mire prévu en 1945. Si le Conseil de sécurité continue de trôner au sommet des dispositifs de maintien de la paix, une sorte de répartition des tâches semble se dessiner à l'échelle mondiale : les États sollicitent les agences techniques de l'ONU pour clarifier ou réguler des enjeux pratiques ou réaliser des actions de terrain (développement, coopération technique...) ; pour les grandes questions politiques, ils se montrent plus enclins à mobiliser les organisations régionales (Union européenne par exemple) ou des groupes de puissances, comme le G8 ou le G20. La première attitude avait été prévue par la charte de San Francisco qui permet aux États de se regrouper dans des structures plus petites ou plus limitées dans leurs objectifs à condition que la primauté de l'ONU soit reconnue et assurée. Les traités fondateurs de l'Union européenne reconnaissent d'ailleurs la supériorité de l'organisation universelle.
Le cas des « G » se révèle plus délicat. Le premier « G » est né après le premier choc pétrolier en 1973 afin de coordonner la riposte des pays industrialisés face à l'augmentation inopinée des prix du pétrole. Les « G » se sont perpétués et se sont renforcés à la faveur de la crise économique et financière jusqu'à occuper aujourd'hui une place centrale dans la régulation mondiale. Ils n'ont certes pas de pouvoir coercitif mais l'hégémonie politique de facto de ce club de pays riches est visible au travers d'une sorte de chaîne de commandement non écrite. Celle-ci aboutit aux organes décisionnaires des institutions financières internationales (IFI) où les mêmes pays riches détiennent le pouvoir. À la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, les droits de vote sont répartis en fonction du produit intérieur brut. Créés de manière informelle par les pays les plus industrialisés, ces organismes fonctionnent comme des directoires de fait. Ils permettent notamment aux gouvernements de s'affranchir des procédures et des règles de représentation fixées par l'ONU pour édicter des règles sans la moindre légitimité.
Pourtant, le système des Nations unies comporte lui aussi des organes économiques auxquels les États auraient pu s'adresser : la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ou l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), par exemple. Certes, les IFI coordonnent de plus en plus en plus leurs actions avec les organes de l'ONU mais il s'agit surtout d'une sorte de courtoisie, pas d'un partage du pouvoir de décision. Les « G » se drapent dans leur statut de conférence diplomatique pour, finalement, ne rendre de comptes à personne et surtout pas à l'ONU. Depuis quelques années, les pays participants cooptent des États du Sud, comme l'Afrique du Sud ou le Brésil, afin d'accroître leur représentativité. Cependant, le rapport de forces ne change pas : les pays industrialisés conservent la main. Depuis une dizaine d'années, on évoque une réforme des IFI permettant une meilleure représentation des pays émergents mais celle-ci demeure pour l'instant dans les limbes.
De leur côté, les instances de l'ONU semblent dépassées par la vague de « centres » concurrents de la décision mondiale, vague à laquelle s'est jointe l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1994. L'ONU « a raté le coche de la crise financière », estiment certains fonctionnaires internationaux qui déplorent le manque d'initiatives de l'Organisation. Les temps ont en effet changé depuis les années 1970 au cours desquelles s'étaient multipliées les propositions pour un Nouvel ordre économique international (NOEI) au centre duquel figuraient les Nations unies. À l'époque, la croissance était forte et les moyens financiers sans commune mesure avec la période actuelle où les deniers publics sont comptés. Mais au-delà de la question des moyens, qui sert trop souvent d'alibi à l'absence de volonté politique, n'assistons-nous pas à une crise plus profonde ? Les États ne sont-ils pas en train de prendre leurs distances avec une organisation qui peine à se réformer ? La question phare du maintien de la paix en fournit un indice.
Instance suprême du maintien de la paix, le Conseil de sécurité se trouve lui aussi dans une situation délicate. Les États se montrent de plus en plus réticents à fournir soldats et moyens aux opérations qu'il décide. D'une manière générale, austérité oblige, les gouvernements rechignent à verser leur contribution financière à l'ONU et à ses agences. Une crise politique, déclenchée par l'admission de la Palestine à l'Organisation des Nations unies pour les sciences et la culture (Unesco), a même vu les États-Unis retirer purement et simplement leur soutien financier à celle-ci en 2011. On se souvient également qu'en 2012 les contributions financières de l'Allemagne (deuxième contributeur après les États-Unis), de la France (troisième contributeur) et du Royaume-Uni avaient été revues à la baisse en raison de la crise économique. Les salaires de 10 000 employés de l'ONU à New York avaient alors été gelés.
En outre, l'inexistence opérationnelle de l'état-major international prévu par la charte de San Francisco rend le Conseil de sécurité dépendant de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Créée au début de la guerre froide, en 1949, cette alliance militaire est devenue hégémonique après la disparition de l'Union soviétique en 1991 et la dissolution du pacte de Varsovie. Seule l'OTAN dispose des structures, des moyens, des procédures et du savoir-faire pour mener en un temps record les opérations militaires internationales décidées dans le cadre du chapitre VII de la Charte. Ce fut le cas par exemple de l'intervention en Libye en 2011. Cependant l'efficacité ne fait pas la légitimité et le rôle pivot de l'OTAN suscite des tensions entre les membres permanents du Conseil de sécurité, notamment parce que la Chine et la Russie estiment avoir été bernées par leurs partenaires occidentaux dans l'affaire libyenne. L'opération s'était en effet soldée par le renversement de Mouammar Kadhafi, objectif non avoué, non prévu par la résolution adoptée par le Conseil, et de toute façon illégal en droit international. En 2014, l'OTAN paraît de moins en moins « atlantique » et de moins en moins « défensive », contrairement à ce que stipule la convention de Washington du 4 avril 1949 qui la fonde. Elle intervient désormais en Europe centrale et en Afrique ; elle remplit des missions (renversement de Kadhafi) clairement offensives.
Plus grave encore, certains propos de diplomates français vis-à-vis de la Syrie ont laissé entendre que Paris pourrait se passer de l'aval de l'ONU pour procéder à des bombardements en Syrie. Fin 2011, alors que les massacres de civils se multipliaient et que l'usage d'armes chimiques était de plus en plus plausible, le Conseil de sécurité se trouvait confronté aux objections de la Russie concernant toute intervention militaire directe dans le pays de Bachar al-Assad. L'ambassadeur de France à l'ONU s'en prit alors vertement au Conseil, soulignant sa « responsabilité morale ». En 2013, les États-Unis – qui avaient d'abord suivi Paris – se montrèrent finalement réticents à tout bombardement de la Syrie, Barack Obama déclarant à François Hollande : « Je ne suis pas George Bush. » Sur le fond, les Américains et les Russes avaient probablement raison dans la mesure où une action militaire aurait pu ouvrir la boîte de Pandore du fractionnement politique régional.
Si la charte de San Francisco souhaite faire de l'ONU un « centre » où « s'harmonisent les efforts », ce n'est pas pour des raisons bureaucratiques ou administratives ; c'est parce que le maintien de la paix, valeur suprême, nécessite un espace commun où l'on peut échanger sur la base de règles du jeu claires et fixées d'avance. C'est le prix de la confiance entre les acteurs et le moyen de diminuer les tensions internationales. C'est aussi l'unique moyen de construire un ordre mondial accepté par tous parce que fondé sur des valeurs choisies en commun. Mais ce système n'est crédible que si les États les plus puissants, et notamment les pays membres du Conseil de sécurité, montrent l'exemple à la communauté internationale. Or ce n'est pas toujours le cas, comme le montrent les « G ». Mais cette propension à écorner le contrat de 1945 est également visible en ce qui concerne l'usage des outils militaires.
La Russie recourt aisément à la force dans son étranger proche, comme l'illustrent ses interventions en Tchétchénie ou en Géorgie. Et que dire de celles de la Chine au Tibet, sans compter que la région se transforme en poudrière à laquelle contribuent tous les États concernés, du Japon à l'Inde en passant par la Corée. Mais les Occidentaux cèdent eux aussi à la tentation : les États-Unis et le Royaume-Uni décidèrent ainsi d'agresser l'Irak en 2003 sans l'aval du Conseil de sécurité. C'est la menace du veto de la France qui épargna à l'ONU le discrédit de soutenir cette opération aventureuse bâtie sur le mensonge des « armes de destruction massive » que Saddam Hussein aurait eues en sa possession. En 2011, l'Union africaine avait élaboré un plan de paix pour résoudre la crise libyenne : selon le président de la Commission de cette organisation, Jean Ping, les Occidentaux l'écartèrent autoritairement pour privilégier l'option militaire sous la bannière de l'OTAN.
N'assistons-nous pas à une sorte de banalisation du recours à la force comme solution aux différends, en violation, là aussi, de la charte de San Francisco ? Celle-ci se montre pourtant très claire dès son préambule (abolition du « fléau de la guerre ») et ses premiers articles : « Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger » (article 2 alinéa 3) ; « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies » (article 2 alinéa 4). Qu'en est-il aujourd'hui des valeurs de paix quand certains intellectuels à la mode se muent aisément en foudres de guerre ?
Dans les domaines scientifiques, juridiques, sanitaires, etc., la coopération internationale est réelle et permanente. Des dizaines de traités, des milliers de résolutions et de rapports techniques sont négociés chaque année dans les locaux des agences de l'ONU sur les sujets les plus divers. Les diplomates et les juristes s'y livrent parfois des conflits de basse intensité sur d'obscurs amendements ou formulations. Mais sur des questions essentielles, la coopération internationale – au sens de la volonté de construire une vision commune des enjeux et les outils pour y répondre – semble marquer le pas. La géopolitique des années 2000, en plein bouleversement, valorise à nouveau les rapports de forces, chacun cherchant à mesurer, maintenir ou faire acter son rôle sur la scène internationale : les puissances déclinantes cherchent à prolonger leur existence (l'Europe et la France en Afrique ; les États-Unis au Proche-Orient et dans le Pacifique), les puissances montantes ou renaissantes (Chine, Russie) tentent de faire reconnaître leur nouveau statut. De telles périodes d'ajustement se révèlent particulièrement dangereuses pour la paix et la stabilité mondiales car chacun est tenté de s'affranchir de la règle du jeu ou de la renégocier plus ou moins brutalement. C'est pourquoi l'ONU constitue un enjeu primordial. Elle est la seule instance véritablement universelle disposant de la légitimité et des outils pour construire l'ordre international. Elle repose sur des valeurs humanistes dont la mise à l'écart par un monde obnubilé par l'argent constitue l'un des drames de la société internationale de ce début de millénaire. Bâtie sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU est la mémoire de l'abîme où la civilisation a failli irrémédiablement sombrer et du sursaut de la conscience universelle pour éviter qu'elle n'affronte de tels périls à l'avenir. Il serait utile que les États, notamment ceux qui ont fondé les Nations unies en 1945, se souviennent qu'ils ont pris l'engagement de se soumettre à ses arbitrages et d'en faire l'instance privilégiée du multilatéralisme.
![]()
La paix : le pilier clé de l'efficacité des Nations unies
Par Steve Killelea AM, entrepreneur et philanthrope australien, président exécutif du Institute for Economics and Peace{1}
En 1945, sur les cendres des destructions de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations unies est fondée sur les trois piliers institutionnels suivants : la paix et la sécurité, les droits humains et le développement. Il est alors nécessaire de créer un système de gouvernance mondiale afin de limiter les potentiels conflits futurs et les pays signataires se mettent d'accord sur le fait que la résolution des problèmes internationaux réside dans le respect des droits économiques, sociaux et humanitaires. Ainsi, la recherche de paix est présente dans tous les aspects de la construction de l'Organisation. Soixante-dix ans plus tard, les Nations unies ont connu de nombreuses victoires dans ces trois domaines grâce à des missions de maintien de la paix couronnées de succès, une réduction incroyable du taux de pauvreté, l'établissement de normes mondiales et de structures capables d'endiguer les atteintes aux droits humains.
Néanmoins, alors que nous assistons à un changement des structures internationales, à l'émergence de menaces nouvelles et donc de demandes nouvelles, la construction de fondations pour une paix durable doit être le fil conducteur et l'action principale des Nations unies.
Les nouveaux défis mondiaux
L'humanité est aujourd'hui confrontée aux plus grands défis de son histoire, qu'ils soient économiques, sociaux ou financiers. Mais ces changements tumultueux constituent aussi une opportunité unique car, sans paix, nous ne serons jamais en mesure d'obtenir la confiance, la coopération et l'inclusion nécessaires à la résolution des problèmes. La paix est donc un but crucial et l'ONU est la mieux placée pour atteindre cet objectif.
Les ressources environnementales épuisables sont en train d'atteindre leurs limites, sur des fronts multiples. La population mondiale a dépassé les 7 milliards d'habitants et dans de nombreux endroits sur la planète, la capacité critique est déjà atteinte. La technologie alimente le changement à un rythme effréné, renforçant la croissance de la mondialisation. Le monde est connecté par des moyens que l'on ne pouvait imaginer au moment où l'ONU fut créée. Les guerres ne sont plus viables économiquement et les changements sont si rapides que les États luttent pour s'adapter à leurs conséquences légales et sociales. Même notre langage évolue : chaque jour des mots nouveaux sont inventés pour mieux décrire notre réalité changeante.
Les défis mondiaux obligent à des solutions mondiales e...