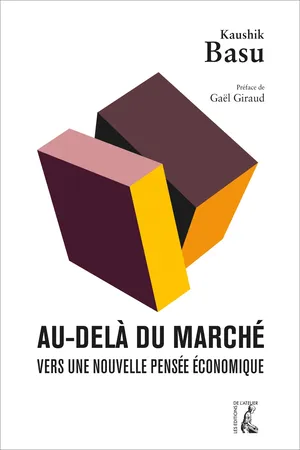![]()
Chapitre 1
Éloge de la dissidence
Mécontentement et discours
À bien des égards, le monde est plus agréable à vivre aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois. Avant tout, nous jouissons des avantages liés à l'augmentation considérable de notre richesse collective. Et même en mettant cet aspect de côté, nous ne vivons plus dans la crainte perpétuelle que des soldats pillards d'un autre pays viennent nous dépouiller de nos terres et de nos biens. Quand nous rentrons chez nous après avoir dîné à l'extérieur, nous ne craignons pas de trouver notre appartement occupé par des inconnus entrés par effraction. Les personnes faibles physiquement ne doivent plus se résigner à être économiquement démunies. De nombreux droits des individus et des nations sont aujourd'hui considérés comme fondamentaux et inviolables. Nous n'avons plus besoin d'être constamment sur nos gardes pour défendre ces droits par la force ou la ruse. Les autres reconnaissent ces droits et les respectent généralement, et, lorsqu'ils ne le font pas, les autorités locales ou l'État veillent habituellement à ce qu'ils soient respectés.
Il serait malhonnête de prétendre que nous avons, en moyenne, moins de possibilités que nos ancêtres de vivre décemment. Ce livre vise à démontrer, cependant, que notre situation n'est pas aussi favorable que nous pouvons le croire à première vue. Le fait que l'exploitation des êtres humains au XXIe siècle se produise dans le cadre des lois et des normes actuelles ne doit pas nous faire oublier son existence. Même dans les temps anciens, des comportements qui nous semblent aujourd'hui violents, brutaux, et des conquêtes moralement indéfendables ont été le plus souvent justifiés en invoquant les mœurs, les normes et les pratiques de l'époque. Lorsque Platon ou, plus près de nous, Thomas More évoquèrent une société utopique dans laquelle tous les hommes seraient traités correctement et respectés, il ne leur vint même pas à l'esprit que le fait d'exclure les femmes et les esclaves de ce modèle idéal puisse poser un problème. Lorsque, aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, les Amérindiens ont été systématiquement dépossédés de leurs terres, parfois par la force, mais souvent dans le cadre de transactions apparemment volontaires – des contrats sophistiqués que les Amérindiens en général ne comprenaient pas, puisque, avant l'arrivée des Européens, ils n'avaient l'expérience ni des échanges de terres ni des contrats écrits{14} –, ils ont été impitoyablement exploités, comme en témoigne leur appauvrissement ultérieur. Mais, à l'époque, la plupart des individus croyaient que ces procédés étaient légaux et moralement justifiés (Banner, 2005, en particulier pages 52-53 ; cf. aussi Robertson, 2005).
Certains récits sur la signature « volontaire » de ces traités et ces contrats sont tragiques, comme lorsque, en 1755, en Caroline du Sud, plus de cinq cents Cherokees rencontrèrent un nombre similaire de colons. James Glen, le gouverneur de la Caroline du Sud, présida la réunion. Des cadeaux furent échangés, et des repas servis dans des bols et des tasses d'argent. Satisfaits, les Cherokees déclarèrent que la tribu voulait donner « toutes leurs terres au roi de Grande-Bretagne [...] parce qu'ils le reconnaissaient comme le propriétaire de toutes leurs terres et de toutes leurs eaux » (Banner, 2005, p. 59). Les colons comprirent que ces paroles avaient un sens métaphorique, et étaient surtout une façon d'honorer des étrangers{15}. Cela devint particulièrement évident lorsque les Cherokees refusèrent d'accepter le moindre paiement. Mais l'offre était trop belle : quels que fussent leurs scrupules, les colons n'allaient pas rejeter ce discours métaphorique. Au moment de signer le contrat, les colons persuadèrent les Cherokees de prendre une petite somme, que les Indiens acceptèrent par politesse en ne se rendant pas compte qu'ils étaient sur le point de perdre toutes leurs terres.
À un certain niveau, des transactions comme celles-ci étaient volontaires, mais nous devons nous interroger sur la signification et le sens de contrats volontaires entre deux parties, lorsque l'une d'elles ne comprend pas ce que signifie une vente de terres, puisqu'elle n'en a jamais eu l'expérience durant son histoire. De nombreux colons considéraient ces transactions comme équitables, mais aussi beaucoup d'indigènes : bien entendu, certains colons profitèrent impitoyablement de la naïveté des autochtones. Lorsque Christophe Colomb et son équipage débarquèrent sur la côte de ce que sont maintenant les États-Unis (Bahamas), les Arawaks coururent à leur rencontre en leur apportant de la nourriture et des cadeaux pour les saluer. Ils ignoraient que, pour Colomb, cette situation n'était qu'une opportunité à saisir. Il écrivit : « Ils nous ont apporté des perroquets, des pelotes de coton [...] et bien d'autres choses [...]. Ils ne portent pas d'armes et ne semblent pas les connaître car, comme je leur montrais une épée, ils la saisirent en toute innocence par la lame et se coupèrent. » Après avoir constaté la simplicité de ces autochtones, il remarque ensuite qu'« ils feraient d'excellents domestiques. Avec seulement cinquante hommes nous pourrions les soumettre tous et leur faire faire tout ce que nous voulons » (Zinn, 2002, p. 5).
De même, aujourd'hui, alors que l'État de droit prévaut, que les droits de propriété définis par nos tribunaux sont respectés, et que le nombre de conquêtes militaires flagrantes diminue, nous avons l'impression que l'équité règne sur les marchés et dans les salles de conférence où sont signés traités et accords. Nous savons que certaines personnes sont flouées et d'autres exploitées, mais, dans l'ensemble, lorsque nous respectons les règles du marché sans voler ni escroquer personne, nous croyons être sur la bonne voie. Certains deviennent pauvres et d'autres riches. Eh bien, nous disons-nous, ainsi va le monde, n'est-ce pas ? N'entraverions-nous pas le progrès et la croissance économique si nous essayions de nous y opposer ? L'Union soviétique a, par exemple, montré ce qui arrive lorsque l'on tente d'imposer d'autres systèmes. Néanmoins l'histoire, y compris dans les cas que je viens de citer, devrait nous alerter sur le fait que, même aujourd'hui, il existe sans doute d'autres types de contrats et de traités déloyaux. Après tout, les échanges réels ne se réduisent pas à de simples achats de pommes, de soins capillaires, de fusils ou de mottes de beurre, comme nos manuels le suggèrent ; ils impliquent des négociations complexes reposant sur des droits compliqués et impliquant des conséquences à long terme. Il est probable que certains groupes sont aujourd'hui floués grâce à de nouveaux moyens dont nous ne prendrons conscience que rétrospectivement.
Si nous envisageons seulement l'écart de revenus entre les secteurs les plus riches et les plus pauvres de la société pour mesurer les inégalités, celles-ci ont atteint aujourd'hui un niveau sans précédent dans l'histoire humaine{16}. En réalité, la situation des plus pauvres n'a guère changé depuis l'Antiquité. Leurs conditions de vie sont « désagréables, brutales et courtes », pour reprendre ce que disait Thomas Hobbes quand il décrivait la « vie de l'homme » dans l'« état de nature » ; les plus pauvres ont à peine de quoi survivre. Leur bien-être est généralement déterminé par leurs besoins élémentaires de subsistance qui ne sont pas vraiment pris en compte dans ces calculs. La richesse quant à elle, ne connaît pas de plafond naturel. Aujourd'hui, les personnes les plus riches sont en mesure de faire des choses dont ni Gengis Khan ni Néron n'auraient pu même rêver.
Des calculs très simples peuvent démontrer que les dix personnes les plus riches aujourd'hui gagnent ensemble autant que 40 millions d'individus, soit la population actuelle de la Tanzanie (Basu, 2006b). Étant donné que ce pays compte un certain nombre de millionnaires et de personnes extrêmement riches, nous constaterons évidemment un fossé ahurissant si nous écartons les revenus de cette catégorie-là dans tous les pays et comparons les dix personnes les plus riches avec les individus les plus pauvres dans le monde. Le plus choquant, c'est que cela ne nous bouleverse pas. Habituellement, nous ne réfléchissons pas à ces questions, et, quand nous le faisons, pour la plupart, nous traitons les inégalités et la pauvreté comme des phénomènes concomitants et inévitables de l'économie de marché – cette grandiose machine invisible, qui coordonne des millions de participants au sein d'un immense système mondial, crée de l'efficacité et aide le monde à devenir plus prospère.
Les inégalités de salaires dans les grandes entreprises ont augmenté de façon exponentielle. Aux États-Unis, en 1980, le salaire moyen des PDG des grandes sociétés était quarante fois supérieur au revenu moyen des ouvriers. Dix ans plus tard, il était quatre-vingt-cinq fois supérieur et, au début du XXIe siècle, quatre cents fois{17}. On nous a fait croire qu'un PDG qui gagne 10 millions de dollars par an (chiffre vraisemblable si l'on ajoute les stock options à son salaire de base) a besoin d'une incitation pour récompenser son travail hautement qualifié. Cela présuppose que, si la rémunération de tous les dirigeants était diminuée de moitié, afin que les PDG en question touchent 5 millions de dollars par an, ils diraient : « Avec une compensation aussi basse, je ne continuerai pas à travailler aussi dur. » Seules notre crédulité et notre complaisance remarquables peuvent expliquer que nous acceptions de tels arguments{18}. J'ai essayé de le démontrer en concevant un modèle formel (Basu, 2010a) qui révèle qu'un régime de salaires et d'avantages sociaux habilement conçu peut conduire à ce que la rémunération dépasse largement la productivité réelle. Ce système n'est pas seulement inique, il crée un monde enclin aux krachs financiers, comme nous l'avons constaté durant les années 2007-2009.
Néanmoins, la complaisance qui prévaut dans nos sociétés face à de telles inégalités n'a rien de spontané. Elle est entretenue par un grand nombre d'individus qui bénéficient de ce système et représentent une minorité de la population mondiale, mais une minorité qui compte : ceux qui ont les moyens et la possibilité de se faire entendre, en payant pour que leur opinion influence nos lois et nos systèmes de réglementation, ou en se servant de leurs réseaux très performants et de leur présence décisive au sein des citadelles du pouvoir.
Cette situation est connue de tous, à part des plus crédules. Pourtant, cette complaisance s'appuie aussi sur un autre facteur. Elle est rendue possible par des légions d'économistes qui accomplissent avec diligence leurs tâches quotidiennes : ils publient leurs tribunes chaque mois dans les journaux ; leurs articles de recherche chaque année dans les revues scientifiques ; et un livre tous les dix ans.
Cela a créé une « opinion médiane » : un corpus de matériaux intellectuels qui décrit le fonctionnement supposé d'une économie moderne, et nous assure que, en tant que système fondé sur l'égoïsme individuel et la « main invisible » du marché, l'ordre mondial actuel est juste ou, en tout cas, le meilleur possible. Il ne fonctionne pas toujours comme il devrait, mais c'est l'idéal que nous devons tenter d'atteindre et de défendre.
En prenant mes distances avec la théorie économique dominante, je suis conscient que certains de mes collègues partagent mes préoccupations et approuvent mes critiques. Le contenu de cet ouvrage ne sera pas très nouveau pour eux. Néanmoins, confortée dans cette idée par la majorité des économistes et des journalistes économiques, notre profession considère généralement que l'ordre mondial actuel fondé sur l'économie de marché des pays industrialisés est le seul viable, pas seulement aujourd'hui mais aussi à l'avenir, et ce, quelle que soit la façon dont on l'envisage. Selon ce courant dominant, nous devrions nous contenter de concevoir et d'appliquer des réformes pour que le moteur du système existant, bien huilé, puisse ronronner.
De temps en temps, cette complaisance est ébranlée. Déconcertées par l'ampleur incommensurable et inédite du fossé entre les pauvres et les riches, certaines personnes sont troublées – y compris des privilégiés qui ont le courage de se remettre en question. Elles se demandent : « Nous a-t-on dupés en nous faisant croire que nous avions atteint le système idéal et que notre seule tâche était de veiller à ce qu'il continue à bien fonctionner ? »
La colère monte parmi ces personnes, et elle se traduit parfois par des explosions de violence ou des protestations incontrôlables, à Saigon, Santiago du Chili, Seattle, ou dans les rues de Washington.
Lorsque ceux qui ont été longtemps opprimés, et ceux qui éprouvent de l'empathie à leur égard, finissent par décider de protester, leurs actions sont souvent considérées comme le fait de « casseurs » ou de « pillards ». Mais les soupçons rudimentaires qu'éprouvent ces éléments protestataires envers l'ordre économique mondial actuel ne sont pas totalement injustifiés. Sans doute leur point de vue est-il peu sophistiqué, et leurs soupçons apparaissent-ils pathologiques à des observateurs extérieurs, mais leurs sentiments cachent une vérité importante susceptible d'être étayée par des fondements intellectuels solides.
Telle est la raison d'être de ce livre. L'exploitation, les conquêtes et les expropriations sont bel et bien un phénomène actuel. L'apparence de ces pratiques a changé. Tout comme le monde moderne tente de colmater les brèches des formes d'exploitation les plus éhontées, et cherche à stopper le pillage et les violations flagrantes des droits fondamentaux, les êtres humains et les gouvernements découvrent des façons nouvelles et moins évidentes d'exploiter les personnes simples, innocentes ou peu matérialistes. Des nations entières, des groupes et des masses de gens sont continuellement trompés et ruinés. C'est rarement le résultat de guerres et de confrontations directes, mais plutôt de manœuvres financières complexes. Certains individus utilisent les failles dans les lois et les nouvelles opportunités offertes par la mondialisation économique, sociale et politique qui rendent certains pays plus vulnérables au pillage, comme en témoignent les économies décimées de l'Afrique subsaharienne, certaines parties de l'Amérique du Sud et de l'Asie, voire certaines régions d'Europe centrale.
Nul besoin de prendre toujours l'exemple de lointains pays pauvres pour observer l'exploitation ou la tromperie. Même dans les pays riches, de nombreux individus sans ressources et démunis dorment dans les rues (Jencks, 1994 ; O'Flaherty, 1996). Alors que j'écris ces lignes, plus de 40 millions de personnes aux États-Unis vivent sans assurance médicale, et près de 10 % de la population active du pays sont au chômage.
Une partie de ces citoyens pauvres sont certainement moins productifs que les riches. Mais cela ne légitime pas le fait qu'ils soient réduits à la misère et au dénuement le plus extrême. Un handicap ne justifie pas que quelqu'un se voie interdire l'accès aux salles de cinéma, aux restaurants et aux centres commerciaux. De même que les lieux publics sont contraints par la loi de s'équiper pour recevoir les personnes handicapées, de même il serait normal que les moins productifs ne soient pas privés de nourriture et de soins médicaux.
Même si nous rejetons cette position et soutenons l'affirmation néoclassique selon laquelle il est normal que les individus soient rémunérés selon leur productivité (parce que cela permet à une économie de fonctionner de façon efficace), les habitants pauvres des pays riches ne sont pas toujours, et même rarement, les moins productifs. On sait parfaitement, par exemple, que le fait d'être né riche aide à le rester.
Le capital culturel et humain acquis en étudiant dans des écoles d'élite et le capital transmis par un héritage légalement protégé d'une génération à l'autre permettent aux personnes nées dans une position privilégiée (et imposent à celles nées défavorisées) de rester dans la même situation, exactement comme cela se passe dans les sociétés de castes. En outre, les individus n'arrivent souvent pas à obtenir une rémunération conforme à leur productivité parce que des contrats et des échanges financiers toujours plus sophistiqués{19} les dépouillent des richesses qu'ils créent. Cela peut aboutir à la création d'un « sous-prolétariat dévalorisé » dans les pays riches.
Tous ces phénomènes ne débouchent pas sur une ébullition sociale, notamment parce que la presse écrite et les autres médias conduisent un tir de barrage idéologique continu ...