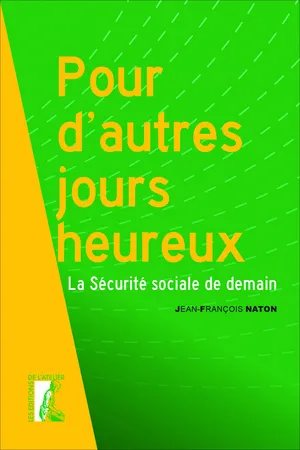![]()
Chapitre 1.
Sortir de la spirale du déclin
Le système de soins et de santé français a longtemps fait figure de modèle. Ce n’est plus le cas. Les inégalités, nous l’avons vu en introduction, ne cessent de se creuser jusqu’à menacer la démocratie. Les fractures territoriales entre villes et campagne, personnifiées par les « déserts médicaux », et les pratiques indignes de dépassements d’honoraires compromettent l’égal accès de tous aux soins et à la santé. On ne pourra briser cette spirale du déclin sans remettre en question les bases organisationnelles du système. Si celles et ceux qui vivent et travaillent en France, quelle que soit leur nationalité – ce que nous appelons « le peuple de France » –, bénéficient bien d’une Sécurité sociale, la cohésion de cette dernière est chaque jour remise en cause sous l’effet, entre autres, de l’augmentation des dépenses de soins et de santé. Afin d’équilibrer les comptes de la Sécurité sociale, les pouvoirs successifs ont, ces trente dernières années, multiplié les plans, en moyenne un tous les dix-huit mois, au nom de la maîtrise des dépenses et de la responsabilisation des malades, familles, retraités. Des plans dont l’efficacité reste douteuse et dont l’iniquité est avérée. Ce discours purement comptable et financier a perverti les consciences et occulté toute considération éthique dans les prises de décision, laissant croire que la maîtrise des dépenses de santé et son corollaire, la baisse des niveaux de remboursement des soins, allaient en soi résoudre les problèmes du système de santé. Dans ce parcours de soumission aux logiques comptables de court terme, les gouvernements successifs et une part majoritaire de la haute fonction publique ont oublié un élément essentiel : la nécessité d’agir pour accroître l’efficacité de l’offre de santé et de soins, et l’urgence d’y travailler non par une succession d’injonctions mais par des méthodes qui valoriseraient des élaborations communes impliquant les organisations de la société civile, les professionnels de la santé et du social, les usagers et les élus. À l’inverse de cette aspiration, la mise en place de logiques technocratiques a conduit à une telle mise en tension du système de soins qu’il ne tient qu’au prix du dévouement des professionnels des champs du social, du soin et de la santé. Aussi l’heure est-elle venue de se remettre à penser « une nouvelle mise en sécurité sociale du peuple de France ». Dans l’instant, cette expression peut apparaître comme un slogan. Nous allons dans les pages qui suivent nous attacher à donner consistance et crédibilité à la démarche qui sous-tend cette perspective.
Mais revenons d’abord à l’ambition de ce projet, qui est de donner les moyens à chaque individu de vivre en sécurité au fil des aléas de la vie, et ce tout au long de son existence. Il ne s’agit pas de lui offrir le bonheur sur un plateau à la façon des régimes totalitaires où le collectif déterminait par avance ce qui serait bon à la place des personnes. Nous en connaissons trop bien les résultats. Il s’agit au contraire de permettre à chacun de construire sa vie sans qu’elle soit menacée par la précarité, la maladie, le déterminisme social, cette inéluctabilité de la mal-vie. Cela exige un renforcement sans précédent de l’accompagnement humain de chacune et de chacun à chaque étape de son parcours de vie.
Focalisons-nous sur trois moments essentiels de l’existence pour vérifier si cette utopie d’une nouvelle mise en sécurité sociale de chacune et chacun est une perspective crédible : le moment de l’école, celui du travail et celui de la fin de vie.
Pour une Sécurité sociale de la scolarité
Le temps de l’école devrait être le lieu privilégié de construction de soi, un temps d’apprentissage des savoirs et de la vie en société, un temps de mise en confiance et d’attention à l’autre. Or, comme nous l’apprend un récent avis du Cese{10}, l’école apparaît trop souvent comme un lieu de mal-être. Un exemple suffit à comprendre ce malaise, celui du stress engendré par l’état trop souvent déplorable des toilettes. L’absence de papier toilette, des portes qui ne ferment pas sont source d’insécurité et sont propices aux harcèlements et violences. Cela peut paraître anodin (de « simples problèmes de verrous ») mais quand beaucoup d’enfants témoignent qu’ils ne vont pas aux toilettes à l’école à cause de leur état de délabrement chronique, on est en droit de se demander quel est le degré d’attention, ou plutôt d’inattention à l’autre de l’institution scolaire et des pouvoirs publics. Ce fait est le révélateur d’un constat plus large : l’état alarmant du système de santé scolaire, de la maternelle à l’université. L’ensemble des professionnels sont en sous-effectifs – moins d’un médecin pour en moyenne 12 000 élèves à titre d’exemple, sans même avoir la possibilité de solliciter d’autres professionnels qui viendraient « limiter la casse ». Dans cette situation de dénuement, le travail de prévention, d’éducation en santé qui était au cœur de cette présence notamment médicale a été peu à peu abandonné. Comment, dans ces conditions, l’école peut-elle être ce lieu qui donne confiance, ce lieu d’attention qui n’oublie personne, ce lieu d’apprentissage de l’égalité ? Au lieu de repérer les troubles, les difficultés d’apprentissage et d’aider l’enfant à les dépasser grâce à un soutien éducatif adéquat, on préfère désormais mesurer le niveau des élèves en procédant à des évaluations chiffrées et massives au moyen d’une batterie de tests auxquels on les soumet. De ces résultats chiffrés découlent des directives pédagogiques données aux enseignants censés les appliquer comme des recettes qui font fi des savoir-faire de leur métier.
Que signifierait une mise en sécurité sociale des enfants et des adolescents dans le cadre scolaire ? Celle-ci ne se focaliserait pas uniquement sur l’état de santé des élèves mais sur leur bien-être global à l’école. L’enjeu principal est de donner du temps aux membres des équipes éducatives pour être davantage en capacité d’attention aux élèves. Quand on constate que, dans un lycée d’une ville populaire de la banlieue parisienne, le nombre d’enseignants est passé de 200 à 130 en dix ans pour un nombre d’élèves constant, on comprend que cette question du temps est décisive. Elle est au cœur de la valorisation des métiers d’enseignant, de conseiller d’éducation, d’infirmier, de médecin scolaire. Au lieu de travailler côte à côte sans temps de relation et de concertation suffisant, les personnes exerçant ces différents métiers pourraient mieux se coordonner et faire évoluer leur configuration. Pourquoi par exemple, dans cette dynamique, ne pas faire progresser les compétences des infirmières scolaires de telle sorte qu’elles puissent assumer certains des actes accomplis aujourd’hui par les médecins ? Pourquoi également ne pas imaginer au sein des équipes des établissements scolaires la mise en place d’un nouveau métier comme celui d’éducateur en santé ? Les besoins en la matière sont criants : de l’apprentissage des gestes quotidiens (se laver les mains régulièrement, etc.) au décryptage des habitudes alimentaires, en passant par des ateliers de sensibilisation à l’importance du sommeil ou des cours d’éducation sexuelle. Ces nouveaux éducateurs travailleraient au cœur de l’équipe éducative avec la communauté médicale renforcée de telle sorte que leurs interventions soient les plus adaptées possibles à la réalité de l’établissement scolaire et aux besoins des élèves.
On objectera que l’octroi de moyens supplémentaires coûterait cher. C’est sans doute vrai, mais c’est faire preuve d’une courte vue que de laisser croire qu’ils se résumeraient à des dépenses. Nous sommes bien là dans ce renversement tant espéré : penser, parler, agir en termes de dynamiques d’investissement et non plus seulement en termes de coûts. Car il s’agit bien de dépenses d’avenir, où se conjuguent prévention, éducation, promotion de la santé. Cette stratégie de bienveillance renforcerait la qualité des liens qu’une société entretient avec l’ensemble de sa jeunesse pour empêcher sa précarisation et la reproduction du malheur. Par exemple, combien de soins ne sont pas effectués à temps faute d’argent quand on sait qu’un enfant sur cinq vit dans la pauvreté{11} ? Les conséquences de l’exposition des enfants aux pollutions dans le milieu scolaire comme en dehors sont de plus en plus documentées. L’alimentation des élèves est elle aussi un point central. Manger bien, manger sain, reste une première nécessité comme le souligne à nouveau l’avis du Cese évoqué plus haut{12} : c’est un déterminant fort de santé. Et ce d’autant plus que, pour nombre d’enfants, le seul repas équilibré est celui pris à l’école. Aussi devons-nous valoriser les collectivités locales qui s’inscrivent dans l’utilisation en restauration collective de produits de qualité, bios et locaux. De même, se laver les dents aussi après le déjeuner afin de prévenir une carie coûte moins cher que de remplacer une dent par une prothèse... L’absence de prise en compte de ces questions de santé, l’intervention éducative insuffisante dès le plus jeune âge sur ces sujets mènent à des impasses en termes de coût et, à longue échéance, de vie en bonne santé. On sait par exemple que les maladies cardio-vasculaires dont le nombre s’accroît fortement peuvent être la conséquence d’habitudes de vie et d’alimentation prises dès l’enfance. Qu’on pense également au surpoids pouvant aller jusqu’à l’obésité, une pathologie qui constitue un marqueur social cause de surmortalité, à l’image de certains cancers{13}.
Ces interventions nouvelles centrées sur la prévention et la connaissance du système de santé et de la Sécurité sociale supposeraient également que du temps soit dégagé pour établir un lien de confiance avec les parents. L’école ne peut plus être, ne doit plus être, une zone interdite à la vraie vie mais un lieu privilégié de partage. Une école de la vie qui met en relation les différentes parties prenantes de l’éducation, du monde du dedans et du dehors. On voit ici comment l’école pourrait devenir un des lieux décisifs de la construction en santé des futurs citoyens, un des lieux premiers où se matérialise une mise en sécurité sociale de la jeunesse avec toutes les conséquences positives qu’on imagine sur les parents et l’ensemble de la société.
Investir le monde du travail
Déplaçons-nous maintenant sur les lieux du travail. Il est incontestable que, dans les années 1960, la mise en place des règles de sécurité impulsées par la Sécurité sociale, avec son institution de recherche et de sécurité, l’INRS, tout comme sa stratégie visant à faire travailler les militants syndicaux et patronaux en connaissance du réel du travail via les comités techniques nationaux (CTN) et régionaux (CTR) ont permis de réduire considérablement les accidents du travail. Néanmoins le fléau des maladies professionnelles demeure, avec les phénomènes massifs de sous-déclaration et de non-reconnaissance par la Sécurité sociale, à des niveaux insupportables. C’est cette situation extrêmement dégradée que nous résumons par l’expression « mal-travail ». Dans ce contexte, une nouvelle approche de connaissance et reconnaissance des situations de travail basée sur ce qu’on appelle la qualité de vie au travail (QVT) s’est fait jour, qui a donné lieu à un accord interprofessionnel le 19 juin 2013. Pour la première fois, un accord conclu entre syndicats et patronat faisait explicitement référence à l’organisation du travail comme possible cause de dégradation de l’état de santé. Au cours de cette négociation de 2013, les confédérations syndicales ont ainsi réussi, en rassemblant leurs points de vue, à prolonger, en s’en inspirant, l’accord-cadre du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail. Cet accord, conclu dans la foulée des conquêtes sociale de 1968, a été trop vite oublié mais, resté à l’état de texte fondateur, il donne la possibilité d’inventer d’autres formes d’organisation du travail que la seule soumission à l’ordre patronal.
De nombreux enjeux se concentrent dans la QVT, et nous y reviendrons : celui de la qualité du travail, de l’efficacité pour la performance, et du bien-être pour celles et ceux qui concourent à cette œuvre singulière et collective qu’est le travail. Le risque rôde toujours que, derrière les beaux mots, les belles définitions, cette QVT soit envahie par la norme et son cortège d’évaluations, loin, très loin du réel du travail et de la perception qu’ont les salariés de la façon dont ils travaillent. Une entreprise peut, par exemple, satisfaire à toutes les obligations en termes de procédures favorisant la QVT et, dans le même temps, laisser perdurer des conditions de travail perçues comme très insatisfaisantes par ses équipes. L’imposition de normes définies de manière abstraite sans prise en compte de l’expérience des salariés et de la perception de leur travail revient à déterminer à leur place ce qui est bon pour eux. Cela rappelle, dans un tout autre contexte, les plans soviétiques où une avant-garde déterminait, à la place des travailleurs mais « pour leur bien », des objectifs qu’ils devaient ensuite réaliser. Comme le constate le juriste spécialiste du droit du travail, de la Sécurité sociale et philosophe du droit Alain Supiot, cette volonté découle d’une logique qui veut « remplacer le gouvernement des hommes par l’administration des choses{14} ». Cette imposition de normes par des experts qui prétendent vouloir le bonheur des entreprises et de leurs salariés sans leur donner la parole sur ce qu’ils font est à mille lieues d’une réelle mise en sécurité sociale dans le travail. Le travail ne se réduit jamais en effet à une fiche de poste ; il est toujours, pour celui qui l’accomplit, un acte de désobéissance à des prescriptions. Chaque travailleur invente sa manière de faire et la met en relation avec celles de ses collègues pour qu’un travail de qualité s’accomplisse.
La prédominance de cette culture verticale où les objectifs fixés par les directions descendent en piqué sur les collectifs de travail a un effet extrêmement négatif sur la motivation et l’engagement nécessaire à toute qualité du travail. À quoi bon s’impliquer dans un travail que l’on aime s’il est réduit à des objectifs impossibles à atteindre, à des tableaux de reporting qui le restreignent à une série de chiffres où la seule motivation des lignes hiérarchiques est la chasse aux « temps morts » pour toujours plus de rentabilité ? Cette chosification de l’individu travailleur au nom de l’efficacité et de la rentabilité produit son contraire, à savoir un désengagement massif des salariés de leur travail. Elle conduit à « une activité empêchée », comme s’accorde aujourd’hui à le démontrer toute la communauté des experts du travail, quelle que soit leur école de pensée. Au lieu de prendre ce constat au sérieux en mesurant ses conséquences négatives sur l’entreprise, l’économie et la santé, on décrète, selon la philosophie qui sous-tend les deux lois travail votées sous les présidences successives de François Hollande et d’Emmanuel Macron, que le travail est un coût qu’il faut réduire, avec pour seule boussole une accélération des temps, un accroissement de la flexibilité, ainsi qu’une intensification et une densification des tâches.
Au regard de cette réalité, que signifie une mise en sécurité sociale du monde du travail ? Elle pourrait avant tout reposer sur l’écoute de l’expérience des travailleurs eux-mêmes, la reconnaissance de leurs qualifications et savoir-faire pour définir l’organisation adéquate du travail et faire progresser les métiers et tâches de chacune et chacun. Cette mise en sécurité sociale combinerait temps de travail et temps de formation et inclurait des possibilités de mutations professionnelles sans que ces choix se paient par le chômage, les renoncements et la précarité.
Comment amorcer cette construction ? Cela supposerait d’abord que se noue un lien inédit entre les différentes parties prenantes de l’entreprise, d’une part celles ou ceux qui la dirigent, celles et ceux qui détiennent son capital, les organisations syndicales, et d’autre part les salariés, qui œuvrent par leur travail à créer cette richesse nécessaire à tout développement durable. On pourrait également associer à cette démarche les fournisseurs et les clients de l’entreprise ainsi que les représentants du territoire dans lequel elle intervient. Trop souvent un raccourci est fait entre entreprise et patronat. L’entreprise reste une organisation où le patron, tout dirigeant brillant qu’il soit, n’est pas grand-chose sans les femmes et les hommes qui la font « tourner », sans ses éventuels sous-traitants et sans les territoires et les collectivités dans lesquels elle évolue.
L’industrie est un déterminant de cette création de valeurs pour conditionner une redistribution solidaire. Sans la force de ces liens de coopération – ce qui n’empêche pas l’expression d’intérêts divergents –, le défi d’une réindustrialisation de la France, condition de la solidarité, n’est pas tenable. Nous verrons plus loin (au chapitre huit) comment cette réindustrialisation peut bénéficier à la mise en sécurité sociale de chacun.
Évidemment, ce type de construction ne se décrète pas. L’État doit retrouver une dimension « stratège » et l’ambition de combattre réellement le chômage de masse en impulsant d’autres pratiques et en garantissant des droits... C’est par exemple ce qu’amorce la mise en pratique de la loi d’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » votée en 2016 et menée à l’initiative d’ATD Quart Monde. L’expérience est certes microscopique à l’échelle des enjeux de réparation des désastres accumulés ces...