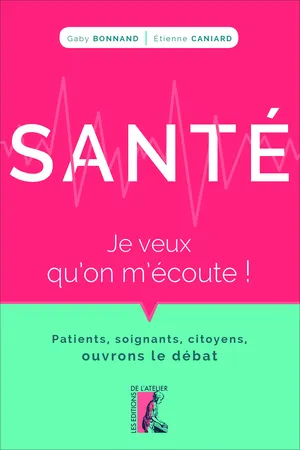![]()
Chapitre 1
« Allô, docteur ? »
« Where is the Doctor ? » C’est bien la question qu’Anna, 35 ans, s’est posée ce jour de décembre 2016 vers 20 heures, dans une grande ville de l’ouest de la France, Rennes.
Camille, son fils de 3 ans, est pris de vomissements. Anna s’inquiète. Son compagnon est au travail. Le cabinet de son médecin traitant est fermé. Aller aux urgences ? « Non, j’y suis déjà allée et je vais attendre une partie de la nuit. » Elle téléphone à SOS Médecins qui lui annonce qu’elle devra attendre trois ou quatre heures avant d’être prise en charge. En revanche, si elle vient avec son fils au cabinet de SOS Médecins-Rennes, elle peut être reçue rapidement. « J’habille Camille et je pars au cabinet. Dans la voiture, Camille n’arrête pas de vomir. Au cabinet, le médecin femme qui me reçoit est très sympathique et m’écoute. Elle examine Camille. Probablement une forte gastro. Elle prescrit un médicament à lui donner dans les deux heures, pour éviter une déshydratation. Je ne connais pas la pharmacie de garde et il faut passer par le commissariat pour y avoir accès. Je dois donc m’y rendre, il est déjà plus de 22 heures. Au commissariat, on me donne l’adresse de la pharmacie qui se trouve assez loin de mon domicile. Après avoir récupéré le médicament, je rentre chez moi. Il est plus de 23 heures, je suis épuisée. »
Anna se remémore ses souvenirs d’enfance, dans une petite ville du centre Bretagne d’où elle est originaire. Peut-être n’était-ce pas aussi systématique qu’Anna le dit, mais elle se rappelle avoir vu le médecin de famille se déplacer à domicile. « Il soignait toute la famille et connaissait les antécédents de santé de chacun de nous. »
Anna n’est pas la seule à raconter ses difficultés pour trouver un médecin. C’est aussi le cas de Sylvie, qui habite une petite ville de cette même agglomération rennaise. Sylvie est atteinte depuis onze ans d’une maladie pulmonaire pour laquelle elle est suivie par un spécialiste en ville qui exerce également en clinique. Après une nuit au cours de laquelle elle s’est sentie très mal, Sylvie appelle son médecin traitant. « Je m’entends répondre, ou plutôt mon mari, Pierrick, s’entend répondre par le remplaçant de mon médecin traitant qu’il ne se déplacera pas. Il nous dit d’appeler le 15, ce que fait Pierrick, et je suis peu de temps après dirigée aux urgences du centre hospitalier. » De nombreuses complications suivront, révélant des failles importantes dans le système de suivi dont bénéficiait Sylvie que nous retrouverons au chapitre 6.
Autre lieu, autre situation, au Chambon-Feugerolles, petite ville de la vallée de l’Ondaine dans l’agglomération stéphanoise. « Le secteur n’est pas attrayant », nous dit Jean, ancien kinésithérapeute à la retraite et aujourd’hui investi bénévolement dans un centre de santé associatif sur la ville. « Le problème principal pour nous, c’est le manque de médecins généralistes. Les départs à la retraite ne sont pas compensés et il est difficile pour les médecins en place de trouver des remplaçants. Ici, je ne suis pas sûr que tout le monde arrive à trouver un médecin traitant{2}. » Au-delà du manque de médecin, Jean pointe aussi une organisation qui ne permet pas d’assurer la permanence des soins. « La pratique courante aujourd’hui, c’est d’aller aux urgences. » C’est le cas de Charles, habitant la même ville, qui s’est heurté à la difficulté de trouver un médecin pour son fils anormalement fiévreux. « Notre médecin traitant était en vacances. Aucun médecin n’a pu nous prendre alors nous sommes allés aux urgences de Firminy. »
Sans vouloir faire un cas général de ces situations, il faut néanmoins y prêter attention. Ces témoignages sont tous révélateurs de l’organisation défaillante de ce que l’on appelle fréquemment la « médecine de ville ». Entendons-nous bien, si nous voulons améliorer l’organisation de notre système de santé de façon à ce qu’il réponde le mieux possible aux besoins des populations – des besoins souvent divers et des attentes parfois contradictoires –, nous devons dépasser les analyses simplistes ou les clichés faciles.
Parler par exemple de « déserts médicaux », ou opposer ville et campagne, c’est faire la part belle aux raccourcis, voire aux représentations qui ne reflètent pas la réalité et qui, pourtant, servent de support aux décisions publiques bien souvent ponctuées d’échecs. Combien de municipalités se sont par exemple engagées, sans concertation avec les professionnels de santé, dans des constructions de maisons médicales qui, une fois mises en place, demeurent vides ou donnent lieu à des recrutements de médecins étrangers qui ne restent pas ?
L’expérience d’Anna évoquée plus haut, habitant une grande ville dynamique sur le plan économique qui ne saurait être identifiée à un « désert médical », vient confirmer l’idée que cette difficulté d’accès aux soins relève presque davantage de problèmes d’organisation, de coordination entre différents professionnels, de lisibilité du système pour les usagers, ou de capacités d’accueil et d’écoute de la part des hommes et femmes qui le composent, que d’une simple question de démographie médicale.
Autant de questions qui sont occultées lorsqu’on en reste au vocable malheureux de « désert médical ». Cette approche crée de faux clivages entre ville et campagne, ou plus exactement entre zones urbaines et zones rurales. En focalisant l’attention sur les questions quantitatives (le nombre de médecins généralistes sur une zone précise, par exemple), le terme de « désert médical » minimise la question de l’organisation du premier recours{3} et de son articulation avec l’ensemble du système de santé. Il produit également une stigmatisation de certaines zones, peu propice à engendrer une dynamique pour construire des réponses. La question essentielle est celle de l’accès aux soins de tous, et ce le plus facilement possible.
« Ce qui compte, pour faire progresser l’accès aux soins, nous dit la docteur Béatrice Allard-Coualan{4} lorsque nous la rencontrons, c’est de réhumaniser le système de santé. Dans cette perspective, la coopération entre professionnels est importante mais attention de ne pas faire de cette coordination un objectif. C’est un moyen. Alors, pour avancer et répondre aux besoins des usagers et des citoyens dans l’organisation du système, il faut être capable de dépasser les conflits institutionnels où chacun est dans son rôle. Nous devons faire un pas de côté, en vue de rendre le système plus lisible. Ce qui manque aujourd’hui, c’est une porte d’entrée dans le système pour, à partir de là, l’organiser. C’est le rôle que devrait jouer le premier recours. »
Des clés pour comprendre
Au-delà des idées reçues et du ressenti de la population, l’examen objectif de la démographie médicale nous révèle qu’en 2018, 10 000 médecins de plus étaient en activité par rapport à 2012, soit une progression de 7,8 % des spécialistes mais aussi de 0,7 % des généralistes{5}. Et si nous posons notre loupe sur l’ensemble du territoire national, nous nous apercevons que 98 % de la population réside à moins de 10 minutes en moyenne du généraliste le plus proche. Qui pourrait penser que ces chiffres concernent la France alors que chacun est persuadé que les « déserts médicaux » progressent et que l’accès aux soins est de plus en plus difficile ?
Début 2018, nous avions 226 000 médecins en activité : 45 % d’entre eux étaient des généralistes, 44 % exerçaient à l’hôpital au moins une partie de leur temps, la moitié avait plus de 55 ans. Cette moyenne d’âge élevée explique que le nombre de médecins va stagner jusqu’en 2020, en attendant les effets des augmentations du numerus clausus{6} puis de sa suppression décidée à l’automne 2018, avant une nouvelle tendance à la hausse dès 2021.
Le simple rappel de ces chiffres suffit à démontrer que le ressenti d’Anne ou de Charles n’est pas lié à un problème quantitatif. Nous avons d’ailleurs la mémoire courte. Qui se souvient qu’il existait encore en 2003 un dispositif baptisé Mica (Mécanisme d’incitation à la cessation d’activité), destiné à diminuer le nombre de médecins, considéré alors comme trop élevé et responsable d’une surconsommation médicale ? Or, nous avons aujourd’hui, proportionnellement à la population, plus de médecins que lors de la mise en place de ce dispositif. Et tout le monde parle de pénurie !
Pour dépasser ces apparentes contradictions, il faut avant tout comprendre que le nombre de médecins n’est pas le seul indicateur à prendre en compte pour parler d’accès aux soins. Beaucoup d’autres professionnels sont nécessaires pour assurer la prise en charge des personnes âgées ou des patients atteints de pathologies chroniques. Les soins proprement dits sont indispensables mais l’accompagnement l’est tout autant. Et, parmi les soins, la priorité est souvent donnée aux soins les plus spécialisés, à l’hôpital au détriment de la médecine de ville par exemple. Il faudrait davantage de stages auprès des généralistes plutôt qu’à l’hôpital. Mais l’hôpital ne peut se passer de l’apport des internes qui sont devenus indispensables à son fonctionnement. C’est ainsi que l’on continue à former des étudiants dans des spécialités qui ne sont pas prioritaires au regard des besoins. Le système se mord la queue, des postes de professeurs justifient le maintien de services qui eux-mêmes ne peuvent fonctionner qu’avec les internes, peu coûteux et facilement disponibles ! C’est ainsi que la formation est souvent déconnectée des besoins et peu adaptée aux conditions réelles que rencontreront les futurs praticiens dans l’exercice de leur métier. Il en est de même pour certains secteurs qui, comme la santé mentale, sont aujourd’hui totalement sinistrés. L’enjeu est simple à énoncer : les besoins de la population doivent être anticipés pour former les personnels plutôt que de prolonger un existant inadapté et obsolète.
Au-delà de la formation c’est aussi la répartition des médecins, géographique et par spécialité, qui est en jeu. Ce qu’il est convenu d’appeler l’héliotropisme, l’attirance pour le sud, est particulièrement marqué chez les médecins. Non parce qu’ils seraient plus enclins à céder aux attraits du soleil et des températures clémentes que d’autres professions, mais simplement parce que le financement des dépenses par l’assurance maladie n’est assorti d’aucune contrainte liée aux besoins de la population. Ainsi, même s’il s’installe dans une zone où il y a déjà suffisamment de médecins, voire trop, un médecin peut facilement développer son activité. Le nombre d’actes réalisés dans les différentes régions dépend beaucoup plus de la densité médicale que des données épidémiologiques{7}.
La question de la liberté d’installation – remise partiellement en cause pour les infirmières, inexistante pour les pharmaciens – fait partie des dogmes de la médecine libérale. Elle est la principale raison des inégalités d’accès géographique aux soins. Rappelons que cet attachement à la liberté d’installation fait partie des fondamentaux sur lesquels la médecine de ville est organisée depuis presque un siècle.
C’est en 1927, période de débat parlementaire avant la mise en place des assurances sociales qui interviendra en 1930, que les médecins se sont fortement mobilisés pour défendre leurs « libertés ». Ces lois, bien avant la création de la Sécurité sociale, mais qui furent promulguées plus tardivement en France que dans d’autres pays, avaient pour objectif de couvrir les salariés contre un certain nombre de risques sociaux (maladie, décès, maternité). Les frais de médecine et d’hospitalisation en faisaient partie. Les médecins libéraux, craignant de se voir imposer des règles par les assurances sociales qui devenaient ainsi les financeurs des frais engagés par les individus, se sont organisés. Ils ont créé leur syndicat, la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), et ont adopté, lors de leur premier congrès, ce qu’ils ont appelé la « charte de la médecine libérale », qui sert encore de référence aujourd’hui. Les médecins ne voulaient se voir imposer ni leur lieu d’installation ni leur tarif de consultation, et ils voulaient rester libres dans leur choix de prescription.
Heureusement, les choses ne sont pas restées totalement figées : des dispositifs incitatifs à l’installation dans les zones « sous-dotées » existent ; les tarifs opposables{8} sont la règle générale pour la médecine générale, de moins en moins pour les spécialités ; des recommandations de bonnes pratiques{9} sont élaborées par la Haute autorité de santé… Mais le dogme de cette triple liberté demeure vivace : en témoignent, entre autres, les combats des syndicats de médecins libéraux contre les Références médicales opposables (RMO){10} en 1993 ou encore la défense des dépassements d’honoraires ou l’opposition aux contrôles des pratiques, pourtant garants d’une meilleure prise en charge pour les patients.
Mais on ne doit pas oublier que la collectivité nationale, et cela est bien normal, assume le coût de formation des médecins… sans le moindre droit de regard sur leur lieu d’exercice ! Dans ces conditions, il ne sert à rien d’augmenter le nombre de médecins s’ils continuent à s’installer dans les zones surdotées et à délaisser les territoires dont ils sont absents. Ce n’est donc pas le nombre de médecins qui est en cause, mais bien leur lieu d’installation.
Autre besoin, celui de l’organisation des soins. Parler de « déserts médicaux », c’est se focaliser à l’excès sur le nombre de médecins en occultant cette question. Bien souvent, ce n’est pas d’un médecin, généraliste ou spécialiste, dont nous avons besoin, mais d’autres professionnels de santé beaucoup plus rares et dont on parle pourtant peu. En effet, nous n’avons pas tiré les conséquences de ce que les spécialistes de la santé publique appellent « la transition épidémiologique », c’est-à-dire le passage progressif de la prise en charge d’épisodes pathologiques aigus, souvent infectieux, au traitement de maladies chroniques. Ce n’est pas le résultat d’une dégradation de l’état de santé de la population mais celui des progrès de la médecine qui nous permettent de vivre longtemps, et souvent bien, avec des pathologies dont nous mourrions il y a encore quelques années. Mais cette nouvelle donne épidémiologique crée des besoins nouveaux qui ne sont pas toujours médicaux, des besoins d’« accompagnement » qui ne visent pas la guérison mais qui nous permettent de vivre le mieux possible avec nos incapacités, nos handicaps.
Un exemple. La DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) entraîne une perte progressive de la vision centrale, seule la vision périphérique étant sauvegardée. Elle touche aujourd’hui entre 25 et 30 % de la population des plus de 75 ans. Parallèlement aux traitements qui permettent d’en différer et limiter les conséquences, il est indispensable d’aider les personnes atteintes de cette pathologie à utiliser le mieux possible leur vision périphérique. Les orthoptistes, qui prennent en charge les troubles visuels moteurs, sensoriels et fonctionnels, sont indispensables à la qualité de vie quotidienne des patients. Et pourtant ils ne sont qu’à peine plus de 4 000 en France. Dans ces conditions, trouver un ou une professionnel-le accessible (la proximité est évidemment fondamentale pour une personne âgée déficiente visuelle) relève aujourd’hui de la gageure, et ce dans la quasi-totalité des territoires.
Nous sommes encore trop marqués par une médecine dont la guérison d’une pathologie serait le seul objectif. L’« accompagnement » évoqué plus haut est souvent vécu et perçu par les médecins comme synonyme d’échec. Pourtant, il est aujourd’hui un enjeu aussi important que la guérison… paradoxalement grâce aux progrès de la médecine. L’accompagnement peut éviter bien des recours inutiles au médecin.
C’est une autre conception du soin qu’il est nécessaire d’intégrer pour mieux organiser la réponse aux besoins de la population. Il faut savoir prendre de la distance avec la définition de la santé adoptée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1946 – « un état de complet bien-être physique, mental et social » –, sauf à accepter que l’immense majorité d’entre nous ne soit pas en bonne santé. Être en bonne santé, c’est vivre le mieux possible en fonction de notre âge, de nos pathologies, de nos incapacités. La déf...