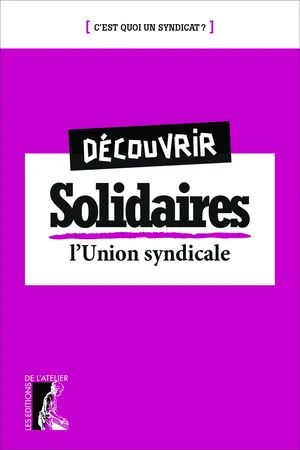![]()
1.
POURQUOI DONC Y A-T-IL AUTANT DE SYNDICATS ?
Appel à participer à une réunion par un syndicat le lundi matin ; à un rassemblement devant l’administration le lundi après-midi par un autre ; à la grève le même jour par un troisième ; à une grève une semaine après par le premier. Et ainsi de suite…
Cette situation est loin d’être rare. S’il est important de comprendre pourquoi il existe de nombreux syndicats, et ce qui fonde leurs différences, il faut aussi questionner ce que le mot « unité » signifie et en quoi il est important d’y tendre le plus souvent possible.
TROP DE SYNDICATS ?
Il existe, au niveau national, de nombreuses structures syndicales. Confédération générale du travail (CGT), Force ouvrière (FO), Confédération française et démocratique du travail (CFDT) sont parmi les plus connues. L’Union syndicale Solidaires, qui regroupe notamment les syndicats SUD (Solidaires, unitaires, démocratiques), en fait partie. Mais pourquoi autant de structures ? Pourquoi ne pas se regrouper dans un seul grand syndicat qui pèserait plus lourd dans le rapport de forces avec le patronat ou le gouvernement ?
Les syndicats ont une histoire longue{1} et ont parfois connu des divisions internes liées à des orientations politiques différentes. Car un syndicat a plusieurs objectifs : il cherche à la fois à regrouper le plus grand nombre de salarié-e-s pour peser dans le rapport de forces, mais aussi à développer ses pratiques et ses valeurs propres (d’où des structures différentes).
COMMENT S’Y RETROUVER ?
Le premier critère de définition d’un syndicat peut être la façon dont il se positionne dans le système économique capitaliste : est-ce qu’il l’accompagne ? Est-ce qu’il cherche à l’améliorer ? Est-ce qu’il considère que ce système est mauvais par nature et qu’il faut donc en changer ? En se penchant sur l’activité quotidienne d’un syndicat et son projet de long terme, les salarié-e-s peuvent généralement se faire une idée de l’organisation qui leur convient le mieux.
Autre évaluation possible : le syndicat appréhende-t-il les différentes dominations qui s’exercent au quotidien et que subissent aussi les salarié-e-s : sexisme, racisme, discriminations liées aux orientations sexuelles ou de genres ? S’intéresse-t-il strictement à ce qui se passe sur le lieu de travail et aux conditions de travail ou intervient-il aussi de façon plus globale dans la société ? Par exemple, lutte-t-il contre l’extrême droite et agit-il en faveur de l’environnement ? Reste-t-il enfermé dans les frontières étatiques ou conçoit-il la lutte des travailleuses et des travailleurs de façon internationaliste ?
À ces éléments centraux qui fondent l’identité d’un syndicat, il faut ajouter la question des modalités d’actions et des pratiques : le syndicat se pense-t-il comme un unique moyen de représentation des salarié-e-s ou se conçoit-il également comme un outil pour favoriser la démocratie directe et les luttes ? Et comment les décisions se prennent-elles : de façon pyramidale, avec une direction qui décide, ou bien de manière plus horizontale, en essayant de faire participer le plus grand nombre à l’élaboration des orientations ? Peut-on faire une « carrière syndicale » en continu sans retourner au travail ou existe-t-il des limites de temps pour être déchargé ou salarié par un syndicat ? Et est-ce que chaque représentant rend compte de son action, de ses mandats, à l’ensemble des adhérent-e-s, ou seulement aux autres représentants ?
LES PIÈGES DU SECTARISME
On le voit, les raisons sont multiples pour conduire au maintien d’un grand nombre de structures, parfois proches, parfois en désaccord complet sur des points fondamentaux.
Mais à ces divisions s’ajoute parfois ce qui s’apparente à du « sectarisme ». Certains, en effet, ont le sentiment d’être dans un syndicat forcément meilleur que les autres. Cela peut venir du fait que le syndicat en question est plus « gros », avec plus d’adhérent-e-s et de meilleurs résultats aux élections professionnelles, mais ces attitudes proviennent aussi d’une culture interne autocentrée. Cela peut mener à des conflits absurdes ou stériles, qui sont forcément néfastes au final pour les salarié-e-s. Pour autant, il ne faut pas nier les différences qui peuvent exister entre structures et qui parfois ne permettent pas de travailler ensemble. Mais il est contre-productif de les grossir exagérément ou de se montrer méprisant avec des structures plus petites.
L’UNITÉ C’EST QUOI ?
La division du mouvement syndical affaiblit bien souvent la capacité d’agir et d’obtenir gain de cause. Cette situation n’est pas satisfaisante. D’autant que si les attaques patronales et gouvernementales pleuvent, le nombre de syndiqué-e-s reste faible : moins de 10 % des salarié-e-s sont aujourd’hui adhérent-e-s d’une organisation syndicale.
Face à cette situation, une partie des syndicats cherche à construire des démarches unitaires, c’est-à-dire à se mettre d’accord sur des revendications et des objectifs communs. Cela peut être, de façon « classique », par un appel à la mobilisation et à la grève signé par plusieurs structures en « intersyndicale ».
Les constructions unitaires prennent du temps : il faut discuter, se mettre d’accord, être en confiance. Elles permettent néanmoins de mettre en lumière la gravité des enjeux d’une situation et de mettre potentiellement plus de salarié-e-s en mouvement. L’unité, si elle est suivie dans les faits par les équipes syndicales, crée une synergie susceptible d’augmenter le rapport de forces des salarié-e-s. Cette unité s’est faite par exemple en 2006 contre le Contrat première embauche (CPE) avec à la clé une importante victoire. Ainsi, le travail unitaire est une condition essentielle pour gagner les batailles les plus importantes à mener.
L’UNITÉ CRÉE
UNE SYNERGIE SUSCEPTIBLE
D’AUGMENTER
LE RAPPORT DE FORCES
DES SALARIÉ-E-S
![]()
2.
À QUOI VOUS SERVEZ ?
Samedi matin, 9 heures, rue de la République à Saint-Denis dans le 93. La supérette Franprix n’ouvrira pas. La quasi-totalité de ses salarié-e-s, principalement des femmes immigrées à temps partiel, s’est mise en grève avec le soutien de l’union locale (UL) Solidaires de Saint-Denis. Présence massive devant le magasin des grévistes et de membres de Solidaires, tract et mégaphone pour expliquer les raisons de la grève aux passants, caisse de solidarité pour soutenir les grévistes… Alors qu’en début d’après-midi les négociateurs du côté de la direction du magasin refusaient de céder quoi que ce soit, la détermination des grévistes leur permet en fin de journée d’obtenir une importante victoire. Un protocole d’accord est signé qui prévoit une hausse des rémunérations le dimanche, un remplacement des salarié-e-s absent-e-s et l’ouverture de négociations pour l’augmentation des salaires. Au-delà, un accord permet à l’ensemble des salarié-e-s de récupérer plusieurs milliers d’euros qui leur étaient dus.
Cette mobilisation s’est élaborée durant un an. Un an de discussion entre des salarié-e-s du magasin et des syndicalistes de Solidaires. Ces échanges ont permis de prendre la mesure de ce qu’ils et elles subissaient mais aussi de déterminer une stratégie collective pour obtenir gain de cause et qui soit à même de leur donner la confiance nécessaire pour agir.
Ce temps, qui peut paraître long, était nécessaire. Il s’agissait de faire en sorte qu’ils et elles aient toutes les informations pour pouvoir décider de façon autonome de la manière de mener leur lutte. Pour l’UL de Saint-Denis, l’enjeu était de permettre à ces travailleur-se-s de faire valoir leurs droits bafoués par la direction et de montrer que l’outil syndical a toute sa place dans les petites entreprises.
LE SYNDICAT : UN OUTIL D’AIDE AU QUOTIDIEN…
Solidaires part du constat que, dans la société dans laquelle nous vivons, quelques individus qui possèdent beaucoup cherchent par tous les moyens à posséder toujours plus. Ils sont organisés et pèsent directement sur le monde du travail comme sur les politiques publiques. Cela se fait aux dépens de la grande majorité de la population et se traduit très concrètement au quotidien : conditions de travail dégradées, faibles salaires, concurrence accrue entre salarié-e-s, baisse des moyens humains et financiers pour le fonctionnement des services publics… Cela passe souvent par le non-respect des réglementations et du droit, que ce soit dans les entreprises ou les administrations.
Dans ce cadre, il est très difficile quand on est seul-e de pouvoir faire valoir ses droits, de résister mais aussi de peser dans le débat public pour imposer d’autres choix. C’est pour cela qu’ont été mises en place des structures pour se regrouper : un syndicat, c’est avant tout le rassemblement de personnes sur un même lieu de travail ou au sein d’une même profession. Les membres du syndicat – les syndiqué-e-s – s’unissent pour s’entraider au quotidien et aider les collègues quand cela est nécessaire. Contre l’arbitraire ou l’injustice, c’est le collectif et la solidarité qui font la force sur le lieu de travail.
… ET DE TRANSFORMATION EN PROFONDEUR
Le rôle du syndicat, du moins pour Solidaires, va plus loin. En effet, Solidaires souhaite contribuer à changer les choses en profondeur, au profit du plus grand nombre. Ainsi, pour élaborer des revendications, l’union syndicale réfléchit à ce qui semble être le mieux pour toutes et tous.
Par exemple, dans un pays où il n’y a jamais eu autant de richesses produites, Solidaires pense qu’elles doivent être mieux réparties et revendique un salaire mensuel minimum à 1 700 euros net et une augmentation générale des salaires de 400 euros afin de permettre à chacun-e de vivre dignement{2}. Solidaires pense également que le travail doit être partagé pour éliminer le chômage et revendique une baisse du temps de travail à 32 heures par semaine. Autant de « revendications de transformation sociale » qui visent à améliorer en profondeur le fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons.
C’est l’un des objectifs du syndicat de réfléchir à ce qu’il souhaite, à la façon de parvenir à l’expliquer massivement et de réussir à ce que ...