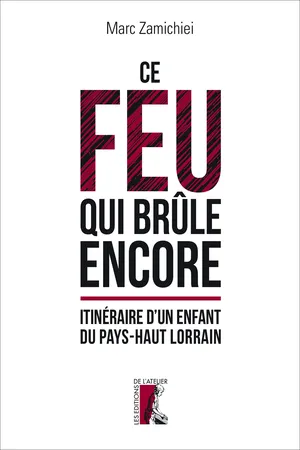![]() Partie III
Partie III
La promesse mutualiste![]()
Une autre forme d’économie
Une couverture complémentaire maladie, des vacances en famille sur la Côte d’Azur à Agay (Saint-Raphaël) ou en Corse à l’Île-Rousse, je ne connaissais la mutualité qu’à travers ces prestations et services lorsque je résidais à Piennes. Une ville et un homme symbolisaient les mutuelles de travailleurs dans le Pays-Haut : Villerupt, siège de la Mutuelle générale des travailleurs lorrains et de l’Union des mutuelles ouvrières de Meurthe-et-Moselle ; Elio Fiorani, leur fondateur, responsable CGT des mineurs de fer et premier adjoint au maire de cette municipalité communiste. Ma connaissance de l’histoire de la mutualité était alors très lacunaire, ce qui est probablement le cas, encore aujourd’hui, de la plupart des Français. On sait que l’aptitude à la coopération est à l’origine du développement des communautés humaines et il n’est pas étonnant que de premières formes de prévoyance solidaire soient apparues dès l’Antiquité. Les sociétés de secours mutuel se développèrent en France au xixe siècle selon un principe constant : en contrepartie d’une adhésion volontaire et de cotisations acquittées mensuellement, leurs membres recevaient des prestations en cas de maladie, d’invalidité voire de vieillesse. Ils géraient eux-mêmes leur société, cette démarche démocratique, autogestionnaire, étant un caractère essentiel du projet mutualiste. On était là en présence d’une forme d’économie relevant de principes autres que ceux du seul marché, une économie « encastrée dans les relations sociales », selon l’expression employée par Karl Polanyi dans son ouvrage La Grande transformation{16}. Ces sociétés de secours mutuel furent étroitement contrôlées par l’État et n’acquirent leur liberté qu’à la fin du siècle avec la loi du 1er avril 1898. Elles ont parfois été la matrice de la résistance populaire face au système d’exploitation, telle celle qui réunissait les tisseurs de soie à Lyon et qui prépara la révolte des canuts en 1831, mais dans la seconde moitié du xixe siècle, à quelques exceptions près, elles se séparèrent d’un mouvement ouvrier progressivement acquis à l’influence socialiste et marxiste. Elles refusèrent néanmoins d’être assimilées aux compagnies d’assurance dont la finalité lucrative était à l’opposé de leur vocation solidaire. Au début du xxe siècle un débat essentiel se développa, entre d’une part les partisans d’une protection sociale obligatoire et d’autre part ceux qui défendaient le principe d’une prévoyance libre et volontaire. S’opposant à la Sécurité sociale au moment de la création de celle-ci en 1945, la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) finit cependant par comprendre que l’existence d’un haut niveau de protection sociale obligatoire était en réalité la condition du développement de la mutualité, laissant libre cours à ses capacités d’innovation sanitaire et sociale. La mutualité ne peut se déployer en tant que forme supérieure de socialisation et garantir son avenir qu’en assumant pleinement l’ensemble des missions que la loi, dès 1945, lui confiait : prévenir les risques sociaux, réparer leurs conséquences, encourager la maternité, protéger l’enfance et la famille, contribuer au développement moral, intellectuel et physique de ses membres... Si la protection sociale complémentaire maladie occupe, pour des raisons historiques, une place prépondérante dans son activité, pour autant la mutualité ne se définit pas par ses métiers, mais par son mode d’intervention dans la société, par sa façon d’entreprendre.
Les deux dirigeants de la FNMT avec lesquels j’allais travailler partageaient cette conception. Louis Calisti, le président, tout en rondeur, à la pointe de l’innovation dans le domaine de la santé et ardent défenseur de l’unité du mouvement mutualiste qu’il avait réalisée dans les Bouches-du-Rhône, était imprégné par des valeurs humanistes. « Au service de l’homme », cette expression qu’il répétait, pouvait être considérée comme son credo mutualiste. C’était également un entrepreneur saisissant toutes les opportunités de développer l’économie sociale. Il le fit souvent avec succès, parfois avec imprudence lorsque la viabilité économique de ses projets n’était pas assurée, toujours avec cette obsession de faire de la mutualité un acteur social reconnu. Daniel Le Scornet, le secrétaire général, était habité par sa mission. Il semblait plus à l’aise avec les joies de la pensée mais sut également affronter les incertitudes de l’action et prendre, à plusieurs étapes de la vie du mouvement mutualiste, de courageuses décisions. Les idées qu’il lançait, mûrement réfléchies mais parfois absconses, ouvraient des perspectives neuves, et l’ensemble du mouvement mutualiste aurait gagné à prendre en considération certaines d’entre elles pour être véritablement en phase avec son temps.
![]()
Plongée dans la vie mutualiste
Je rejoignais le siège de la FNMT, avenue Parmentier dans le 11e arrondissement de Paris, à un moment clé de la vie du mouvement mutualiste. L’unification des différentes composantes de ce mouvement était un objectif stratégique pour les dirigeants de la FNMT, la mutualité ayant vocation à se rassembler dans la diversité, compte tenu de la nature même des mutuelles et de leurs objectifs. Un processus d’unification avait été engagé au début des années 1970. Or, en juin 1984, les dirigeants de la FNMF avaient décidé d’y mettre fin en excluant les groupements qui adhéraient également à la FNMT. Du 31 mai au 2 juin 1985, le congrès de la FNMF qui se tenait à Lyon entérina ce choix. Je participais au même moment et dans la même ville au « congrès unitaire » des quelque 300 mutuelles et unions qui refusaient le diktat de la FNMF. Celle-ci avait fait le pari que les mutuelles gagneraient à s’engager dans un marché concurrentiel de l’assurance maladie complémentaire et elle cessa donc de défendre le principe longtemps partagé par l’ensemble du mouvement syndical et mutualiste, celui de l’exclusivité de la gestion de cette activité par la mutualité. Il est probable qu’elle ne voulait pas s’embarrasser d’une FNMT restée fidèle à ce principe.
Après m’être ainsi plongé d’emblée dans les tourbillons de la vie mutualiste, on me confia une première mission au sein de la FNMT : réaliser une étude sur la politique de communication de cette fédération. Je remis mon rapport en août 1985. De nouveaux besoins apparaissaient pour la FNMT, dont ceux relevant de son intervention, en tant qu’acteur de l’économie sociale, dans le champ de la communication. La fédération et plusieurs de ses groupements avaient investi dans de nombreux canaux de communication, finançant des radios locales, développant une coopérative de production audiovisuelle, voulant s’affirmer comme des acteurs à part entière de la communication sociale. Je recommandais de mener cette politique « de manière pragmatique et prudente », compte tenu des incertitudes pesant sur le développement de ce secteur et des risques existants en matière de création cinématographique et télévisuelle. Il fallait donc s’assurer « de la viabilité économique de chaque intervention » et rechercher plus systématiquement des coopérations et des alliances avec d’autres acteurs. Je sous-estimais cependant les risques qui avaient déjà été pris concernant certains investissements dans des structures qui par la suite se révélèrent être de véritables gouffres financiers. Parmi les outils de communication de la FNMT, le magazine La Vie mutualiste occupait une place à part, pionnière, fédératrice, mais il convenait de le moderniser et de faire évoluer son contenu. Le projet qui allait donner naissance à Viva était déjà sur les rails. La Vie mutualiste avait un tirage mensuel moyen de 920 000 exemplaires, grâce aux abonnements souscrits par les mutuelles adhérentes. J’insistais sur les investissements matériels et humains que nécessitait le nouveau titre mais je n’avais pas suffisamment perçu que l’évolution de son contenu risquait de voir s’affronter deux logiques différentes : en effet l’intérêt du lecteur ne coïncidait pas automatiquement avec les attentes des mutuelles qui voyaient d’abord dans ce magazine un outil de communication avec leurs adhérents.
Chargé de mission, je fus rapidement sollicité pour assumer une autre fonction, celle de directeur d’une fédération qui elle aussi se métamorphosait pour devenir la Fédération des mutuelles de France (FMF). En effet, après l’échec de l’unification du mouvement mutualiste, la FNMT et les six unions départementales de la FNMF exclues par celle-ci (Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Corse du sud, Finistère et Var) organisèrent le 31 janvier 1986 le congrès constitutif de la FMF. En juin 1986 je présentai devant le comité exécutif un rapport sur la structuration de la nouvelle fédération. Il fallait que celle-ci soit pleinement représentative, se dote de tous les attributs d’une fédération mutualiste nationale et impulse et coordonne l’organisation de ses groupements adhérents sur tout le territoire national. Les difficultés à surmonter étaient nombreuses. La FNMF multipliait les tentatives de marginaliser voire de faire disparaître la FMF. En interne, l’enjeu de la constitution d’une vraie fédération devait être partagé par tous les groupements adhérents, sollicités pour y contribuer économiquement. Les propositions concrètes du rapport furent approuvées par les élus fédéraux et peu à peu la FMF prit corps.
![]()
Le marché de l’assurance maladie complémentaire
Je m’imprégnai progressivement de la démarche mutualiste. C’est dans les Bouches-du-Rhône que je perçus le mieux la vitalité de la mutualité. C’est le lieu où, sous l’impulsion de Louis Calisti et du docteur Jean-François Rey, fut développée, en centre de santé, une médecine d’équipe insérée dans un mouvement social, avec une population soucieuse de promouvoir sa santé, individuelle et collective. Cette expérience pertinente en termes d’efficacité sanitaire et sociale supposait cependant un important soutien économique des mutuelles, le paiement à l’acte des médecins par la Sécurité sociale étant profondément inadapté aux pratiques innovantes mises en œuvre.
J’apportai également au bout de quelque temps ma contribution personnelle à la réflexion sur la protection sociale et la mutualité. Dans le numéro de juillet 1986 de La Revue d’économie sociale, je publiai une analyse critique de la réforme visant à mettre en place un marché concurrentiel de l’assurance maladie complémentaire et à confier sa régulation à l’État. Cette réforme se concrétisa en deux temps. D’abord avec la loi de juillet 1985, pièce maîtresse du nouveau code de la mutualité que je commentai dans un autre article de La Revue d’économie sociale de mars 1987. Ensuite avec la loi Évin de décembre 1989 qui organisa la concurrence sur la base de règles communes aux mutuelles, aux institutions de prévoyance et aux compagnies d’assurance, tout en renforçant, pour les accords collectifs d’entreprise, les garanties visant à éviter la sélection des personnes et des risques.
L’un des objectifs de cette mise en concurrence était de faciliter les déremboursements de la Sécurité sociale, auxquels la mutualité aurait pu s’opposer si elle avait été la seule à intervenir dans le champ de la complémentarité maladie. Par contre, des acteurs placés en situation de concurrence n’hésiteraient pas à augmenter leurs parts de marché, même si cela devait se faire au détriment de l’intérêt général. En effet, les réformes de la Sécurité sociale, qui se succédaient depuis l’instauration de la Ve République, s’inscrivaient le plus souvent en rupture avec l’élan émancipateur de 1945, dans une perspective de régression plutôt que de progrès social. Au printemps de 1987, des États généraux de la Sécurité sociale avaient été organisés, Jacques Chirac étant Premier ministre et Philippe Seguin ministre des Affaires sociales et de l’Emploi, dans une situation inédite de cohabitation politique au sommet de l’État, François Mitterrand étant président de la République. Cette manifestation se fit sous l’emblème de la baleine. Le choix du cétacé donnait dans la symbolique : un animal énorme mais sympathique, en train de plonger vers les abysses et menacé de disparition... Cette image troublante avait pour objectif de préparer l’opinion à de sévères mesures : nouvelles ponctions sur les revenus des salariés, les entreprises étant épargnées, révision du dispositif de prise en charge à 100 % des maladies de longue durée, rétablissement du secteur privé à honoraires libres à l’hôpital public. Le mouvement social réagit vivement. La FMF, avec une quarantaine d’autres organisations, s’associa à la CGT, dont la manifestation du 22 mars réunit deux cent mille personnes. La FNMF, de son côté, rassembla le 23 mai cent mille personnes à Vincennes. La FMF lança dans cette période une campagne de communication, conçue par l’agence Anatome, dirigée par Henri Meynadier, qui connut un franc succès sur le thème : « Mon corps n’est pas une bagnole. » L’image d’un homme nu au sommet d’un monceau de véhicules automobiles promis à la casse illustrait le débat sur les dangers de l’utilisation des techniques assurancielles dans le domaine de la santé, avec l’ardente obligation de traiter la personne humaine en tant que sujet et non comme un objet. Le premier congrès de la FMF se déroula à Nice du 14 au 16 novembre 1987. Il témoigna de la reconnaissance acquise par la jeune fédération en présence de deux mille mutualistes, de nombreuses personnalités et délégations mutualistes étrangères.
À l’issue de ce congrès je quittai mon poste de directeur de la fédération, ne sachant pas encore si cela signifiait une rupture transitoire ou définitive avec la mutualité. La raison de ce départ était simple. Mon beau-père, Jean Lévêque, à partir d’une entreprise familiale de peinture, avait constitué un groupe d’entreprises de second œuvre du bâtiment, la Compagnie générale de coordination des entreprises, basée en Seine-et-Marne. Il souhaitait préparer sa retraite et assurer à l’intérieur du cercle familial la transmission de ce groupe. Il m’avait donc demandé, ainsi qu’à sa fille Sylviane, de venir travailler à ses côtés. Je fis l’erreur d’accepter. En effet, je compris rapidement que ce n’est pas parce que l’on a quelque qualité, quelque compétence dans un domaine, que l’on doit se croire apte à exercer toutes les responsabilités. Je ne parvins pas à me familiariser avec ce milieu très particulier, si éloigné de ceux que j’avais jusqu’alors connus. Après avoir fait avec mon beau-père le constat de mon échec, je sollicitai pendant l’été 1988 Louis Calisti et Daniel Le Scornet, d’autant plus naturellement que durant toute cette petite année j’étais resté en contact avec eux, continuant à participer à certaines initiatives de la FMF. Ils me proposèrent le poste de directeur du développement de la Coopérative d’édition de La Vie mutualiste (Viva). Impatient de retrouver le mouvement social, j’acceptai et pris mes nouvelles fonctions en octobre 1988.
![]()
Les Nouvelles de Moscou
Une des premières missions que me confia Louis Calisti concerna Les Nouvelles de Moscou. Cet hebdomadaire russe, dépendant de l’agence de presse internationale « Novotsi », était diffusé à l’étranger dans plus d’une centaine de pays et en cinq langues, dont la française. Jusqu’au milieu des années 1980, il s’agissait davantage d’un bulletin de propagande – ce qui est un pléonasme s’agissant de la presse soviétique de l’époque – que d’un journal d’information et de débats. Sous la conduite d’un nouveau rédacteur en chef, Egor Iakovlev, Les Nouvelles de Moscou devinrent rapidement le symbole en URSS et la vitrine à l’étranger du nouveau cours que prenait la politique du pays, voulue par Mikhaïl Gorbatchev, au pouvoir depuis 1985. C’était le temps de la « glasnot », la transparence et la liberté de parole dans les médias, et de la « perestroïka », les réformes économiques et sociales destinées à sauver un pays à bout de souffle, victime de la bureaucratie et de l’immobilisme, sur fond de pénurie et de corruption.
Après avoir fait de son hebdomadaire un exemple de journalisme d’investigation, Egor Iakovlev proposa à des éditeurs étrangers de mettre au point de nouvelles formules dans leurs pays respectifs. En France, Louis Calisti saisit cette opportunité et, fort d’une relation de confiance avec Egor Iakovlev, se fit confier par celui-ci, en octobre 1988, la conception de l’édition française. Je fis plusieurs fois le voyage à Moscou, avec Louis Calisti et Jean Bayle, designer graphique de presse, créateur de nouvelles formules (Libération, Le Figaro, etc.) à qui j’avais fait appel. Ce grand professionnel, par la taille comme par le talent, était alors associé à Jacques Bidou au sein de la société JBA.
Au cours du premier trimestre de 1989, la version française des Nouvelles de Moscou fut mise au point. La formule respectait le contenu de l’édition russe et devait paraître deux jours seulement après celle-ci, le temps de procéder à l’important travail de rewriting, de mise en forme et d’enrichissement iconographique qui allait nous permettre de séduire le lecteur français. Cependant, il fallait d’abord nous assurer de la faisabilité technique et économique du projet. Une petite mais fort compétente équipe de professionnels de la presse écrite fut constituée et une société d’édition créée. Le groupe Hachette apportait un soutien logistique mais nous recherchions un partenaire de l’économie sociale susceptible de s’engager financièrement. Jacques Vandier, le président de la Macif, donna son feu vert. Cet homme charmant, intelligent, avait contribué à démocratiser l’assurance automobile. Il n’hésitait pas à soutenir des projets qui avaient du sens.
Je confiai la campagne de lancement de l’édition française des Nouvelles de Moscou à l’agence Anatome. L’équipe pilotée par Henri Meynadier trouva un concept de campagne humoristique qui plut beaucoup : « Un journal passe à l’Ouest. » Une cigogne en papier illustrait ce mouvement. La soirée de lancement, le 1er juin 1989, salle Wagram à Paris, fut un événement politique et culturel. Les ambassadeurs de l’URSS en France et à l’Unesco étaient présents, les représentants du PCF étaient absents : le lien ombilical avait été coupé mais le conservatisme avait changé de camp. Parmi les centaines d’invités, on pouvait reconnaître les rénovateurs et reconstructeurs communistes, Pierre Juquin et Claude Poperen, l’ancien ministre Anicet Le Pors, le sociologue Edgar Morin, les historiennes Madeleine Rebérioux et Lilly Marcou... De nombreux journalistes, de tous horizons, avaient fait le déplacement.
Le premier numéro de la nouvelle formule, paru le 2 juin, s’arracha en kiosque. Mais peu à peu l’euphorie retomba et la diffusion chuta. Le titre devait être relancé, ce qui supposait des moyens financiers supplémentaires. Jean-François Fonlupt, banquier d’affaires et responsable de la filiale cinéma du groupe Bouygues, s’intéressa à l’affaire. Une réunion au sommet fut programmée au siège de ce groupe, l’impressionnant immeuble « Challenger », à Saint-Quentin-en-Yvelines. Martin Bouygues nous accueillit. Il était depuis peu P.-D.G. du groupe et souhaitait développer ses activités dans le domaine de la communication. J’accompagnai Louis Calisti, Egor Iakovlev et Andreï Gratchev, un historien et journaliste très proche de Mikhaïl Gorbatchev, dont il fut le porte-parole. Malheureusement cette rencontre n’eut pas toutes les suites que j’espérais et nous dûmes mettre fin à l’aventure de cette édition française. Elle m’avait beaucoup appris sur la dimension éditoriale et économique d’un journal. Elle m’avait aussi permis de connaître quelques-uns des acteurs d’une presse enfin libre en URSS, l’un des aspects les plus notoires de cette tentative quasi désespérée de reconstruire l’URSS.
![]()
1989, une année de ruptures
1989 fut une année de ruptures. Le 9 août, mon père décéda d’un cancer. Les années passées au fond de la mine, la déportation, les cigarettes avaient...