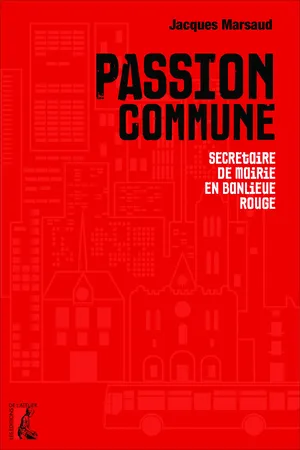![]()
Chapitre 1
1971-1975. Saint-Pierre-des-Corps
La Clarté Républicaine
C’était le nom qu’avaient donné les révolutionnaires à Saint-Pierre-des-Corps en 1794. Toutes les villes ou presque commençant par « Château » ou « Saint » avaient été rebaptisées. Saint-Denis était devenue Franciade ; Saint-Ouen, Bains-sur-Seine ; Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, Libreval ; Châteauroux, Indrelibre. Le petit village de Saint-Bohaire dans le Loir-et-Cher, où mon beau-frère était instituteur-secrétaire de mairie, s’était vu attribuer le nom, certes moins lyrique, de « Bien-Boère » (puis Bienboire), mais correspondant sans doute mieux à l’idéal révolutionnaire de ses habitants.
« La Clarté Républicaine » pour Saint-Pierre-des-Corps en disait déjà long sur la personnalité de cette ville. Ville cheminote de 17 000 habitants, Saint-Pierre-des-Corps revendiquait avec quelques villes de la ceinture rouge de Paris sa municipalité communiste depuis 1920, c’est-à-dire depuis la création du Parti communiste et, avec la seule ville de Bagnolet, son vote négatif au référendum gaulliste de 1958.
À la différence de la banlieue rouge de Paris, Saint-Pierre était le bastion assiégé et diabolisé par les quartiers bourgeois de Tours et de Saint-Cyr. Il fallait faire plus de cent kilomètres pour trouver les « villes sœurs » les plus proches : Vierzon et les Aubrais, autres grandes gares de triage, d’ailleurs. Je me souviens de la visite que nous rendit un jour, au service municipal de l’urbanisme et de l’information, une jeune Américaine, fille au pair dans une famille de Saint-Cyr-sur-Loire. Éclairée, ou bien en quête d’émotions fortes, elle était fière de nous dire qu’elle avait bravé l’interdit familial en venant visiter cette ville qu’on lui avait présentée comme une cité de sauvages et de détrousseurs où une jeune fille seule ne devait surtout pas s’aventurer.
Saint-Pierre entretenait quelques relations privilégiées avec les étudiants communistes de Tours. Elle leur prêtait main-forte, avec quelques détachements de ce qu’on appelait la faculté de plomberie, pour leur permettre de reprendre pied physiquement dans les facs ou les restaurants universitaires lorsque les gauchistes leur en interdisaient l’accès. Elle attribuait des logements à des étudiants en fin d’études et leur proposait parfois du travail. C’est ainsi que je devins en 1971, ma licence de droit public en poche, corpopétrussien{3} et employé municipal, par l’entremise de Jacques Gozard.
Jacques Gozard
Militant de l’Unef en 68, j’entretenais déjà quelques sympathies pour les communistes. Jacques Gozard était alors le secrétaire de ville de l’Union des étudiants communistes (UEC). Il nous apparaissait comme un dirigeant révolutionnaire mythique qui siégeait au bureau national de l’UEC à Paris.
La première fois que je le vis, c’était un soir de Mai 68, dans le grand amphi de la faculté de la Grandière à Tours, bouillonnant de gauchistes de tout poil ayant comme principale préoccupation de faire la peau aux staliniens pour les trotskistes, aux révisionnistes pour les prochinois, en tout cas aux communistes.
Mon camarade Jean-Michel Chapet avait tenté de prendre la parole. Il n’avait prononcé qu’une seule phrase avec un brin de suffisance, qui avait fait hurler de rire et de sarcasme la salle entière : « Pour moi, vous savez, la politique, ça n’a pas de secret. » S’ensuivit une « Marseillaise » railleuse que les « gauchos » aimaient associer au pseudo-nationalisme des « cocos ». La confusion était à son comble et la bousculade aussi. Alors une voix s’éleva du haut de l’amphi, calme, solennelle, pour dire qu’on ne pouvait pas plaisanter avec ce qui fut l’hymne des révolutionnaires français, pas plus qu’avec le drapeau tricolore, quand on se présentait soi-même comme révolutionnaire ; assénant une leçon d’histoire à une salle redevenue étonnamment silencieuse. Le discours émanait d’un jeune homme élégant venu soudain d’ailleurs. « Qui c’est, tu connais ? » demandai-je à mon voisin Michel Perrot. « C’est Jacques Gozard », me répondit-il. Jacques entretenait cette image de grand leader charismatique et secret qui n’était pas sans effets sur les jeunes militants que nous étions.
De l’Unef Renouveau, la tendance communiste du syndicat étudiant en 1968, à l’UEC, il n’y avait qu’un pas. Je le franchis assez vite, et fus amené à côtoyer le chef, qui me promut au bureau, puis au secrétariat de ville de l’UEC Tours. Ce fut la période des innombrables et interminables réunions au 35 de la rue Bretonneau où la fédération du PCF nous hébergeait. Nous nous réunissions dans la salle du comité fédéral sous les portraits géants réalisés par un camarade artiste peintre se réclamant de l’hyperréalisme socialiste : Marx, Engels, Lénine, Thorez. Un jour, stupeur, Marx avait disparu. Il fut retrouvé plusieurs mois plus tard, par hasard, par un dirigeant de la fédération, la barbe ripolinée de toutes les couleurs, dans les toilettes de l’appartement du numéro deux de l’UEC. Le sacrilège avait été commis avec la complicité évidente de Jacques Gozard. Le jeune militant idéaliste que j’étais eut du mal à percevoir le sens de ce geste. Je compris un peu plus tard qu’il ne s’agissait pas que d’une simple blague de potache, mais aussi d’un acte politique visant à dénoncer tout à la fois le dogme et le culte de la personnalité. C’était finalement la toute première et précoce manifestation de nos dissidences qui nous conduirait quinze ou vingt ans plus tard, et après bien d’autres et plus sérieuses contestations, à quitter à peu près tous le parti.
Jacques Gozard donc, et l’UEC Tours, mais quel rapport avec Saint-Pierre-des-Corps et mon parcours de secrétaire de mairie ? Eh bien tout simplement parce que, après ces trois années de complicité militante, il me proposa un jour de l’été 1971 de venir travailler avec lui au service municipal d’urbanisme, que le maire Jacques Vigier lui avait demandé de créer. Je travaillerai à mi-temps, parallèlement à un troisième cycle de droit administratif à Poitiers. Ce faisant, le « service urba » voyait ses effectifs croître de 50 % avec mon arrivée, puisque nous étions désormais un et demi.
Jacques Vigier
Créer un service d’urbanisme dans une ville de 17 000 habitants, en 1971, était quelque peu avant-gardiste. La planification urbaine tout comme l’instruction et la délivrance des permis de construire était l’apanage des services de l’État, pour le compte des communes. Cette volonté de maîtriser le développement de la ville en la dotant de ses propres experts, nous le devions à la clairvoyance de Jacques Vigier.
Jacques Vigier était le maire de Saint-Pierre-des-Corps depuis mars 1971. Ouvrier serrurier, il avait succédé au cheminot Jean Bonin, dont il avait été l’adjoint, notamment à l’urbanisme. Il avait forgé son autorité et sa notoriété dans l’action contre la guerre d’Algérie. En 1956, s’opposant au départ de jeunes soldats en gare de Tours, il avait attaché symboliquement un officier à un poteau. Cela lui valut neuf mois d’emprisonnement au fort du Hâ à Bordeaux.
C’était un homme aussi entier et déterminé que sensible, chaleureux et généreux. Une telle personnalité conjuguée avec ses responsabilités de maire l’avait conduit assez naturellement à être en indélicatesse avec l’appareil du parti. Les relations étaient plus que tendues avec le conseiller général du canton qui était aussi le secrétaire fédéral, membre du comité central du PCF. Aussi, lors de son départ à la retraite, c’est à Jacques Vigier que le parti demanda, dans ce qui était encore la bonne tradition stalinienne, de faire son éloge devant la conférence fédérale. Jacques Vigier estima ne pas pouvoir refuser. En réponse à mon étonnement, il me dit : « Tu écouteras bien, il n’y aura rien dans mon discours que je ne pense pas. » Effectivement, toutes les phrases étaient à double sens, et leur sens dépendait de la manière dont on les entendait. Ce fut un exercice de style étonnant qui illustrait tout à la fois le talent littéraire et l’esprit frondeur et malicieux de Jacques Vigier.
Homme de grande culture, il était passionné par l’urbanisme et l’architecture. Il aimait s’entourer d’intellectuels, ce qui n’était pas forcément bien vu dans ce bastion ouvrier. C’est dans cet esprit qu’à peine élu maire en 1971, il avait décidé de créer un service municipal d’études et d’urbanisme ; et qu’il avait fait appel à Jacques Gozard qui, pour ce faire, présentait au moins deux qualités, celles de géographe et de responsable des étudiants communistes. Et comme pour faire un service, il fallait être au moins deux, Jacques m’avait proposé de le rejoindre.
Jacques Vigier se chargea de notre formation. Il nous associait à de nombreuses réunions, partageait avec nous bon nombre de ses rêves, de ses projets et de ses interrogations. Il aimait échanger avec nous, notamment le matin à huit heures, au Café de la Mairie, devant un verre de Bourgueil, ou le soir, à la Maison de la Jeunesse où se retrouvaient les vieux militants, avec cette fois un verre de Montlouis.
Montlouis, c’est là qu’était la cave municipale. Comme Saint-Pierre était dans la Varenne, entre Cher et Loire, il ne pouvait y avoir de cave sur son territoire. La ville en avait donc acheté une située dans les coteaux de tuffeau les plus proches, à Montlouis, vignoble populaire face à l’aristocratique Vouvray. Deux conseillers municipaux, Pierrot et Jeannot, étaient officiellement délégués pour gérer la cave, choisir les vins, en cuve, de Chinon, Bourgueil et Montlouis, les élever, les mettre en bouteille, les conserver, les goûter. Ils étaient aussi sérieux que consciencieux. La cave était exceptionnelle. Je crois que l’un et l’autre sont morts en service. La cave était réservée aux grandes occasions : une affaire délicate à conclure ou un événement exceptionnel. Insigne honneur, un dîner pour mon départ en 1975 y fut organisé.
Jacques Vigier aimait aussi la nature, les choses simples. Il avait acheté avec sa femme Nénette, militante de toutes les bonnes causes, notamment féministes, une vieille masure dans la campagne tourangelle. L’intérieur évoquait un tableau des frères Le Nain, peinture qu’il affectionnait particulièrement. Il la décorait de fleurs qu’il allait cueillir dans les champs. Nous y avons tenu quelques commissions d’urbanisme, l’été sous le hangar, qu’il animait en faisant griller les andouillettes.
C’était un homme de conviction et de valeurs. Il m’a transmis ce qui était nécessaire pour aborder et aimer le métier.
Le service municipal d’urbanisme, des études générales et de l’information
C’est le nom officiel que prit le service lorsqu’il fallut argumenter la création d’un emploi spécifique{4} pour me permettre de devenir titulaire de mon poste le 1er janvier 1973 lorsque je fus amené à remplacer Jacques Gozard{5} comme directeur du service.
Ce nom compliqué traduisait une évolution qui avait été réelle et rapide.
L’activité centrale et fondatrice du service fut sans conteste, pendant cette période, l’élaboration du plan d’occupation des sols (POS). La loi d’orientation foncière et urbaine du 30 décembre 1967 avait institué de nouveaux documents de planification urbaine. Les anciens plans d’urbanisme, élaborés par l’État, étaient remplacés par les POS. L’évolution la plus marquante, préfigurant le timide mouvement de décentralisation en gestation, résidait dans le fait que ceux-ci, désormais, faisaient l’objet d’une élaboration conjointe entre l’État et la commune{6}. C’est pour prendre la main dans cette élaboration conjointe que Jacques Vigier avait décidé de doter la ville d’un service d’urbanisme.
Et la main, nous l’avons bien prise. Le travail de l’équipe composée d’un géographe, d’un juriste et d’une sociologue, Françoise Bourdarias{7}, aidée par un architecte parisien communiste, Raymond Sénevat, fit que Saint-Pierre-des-Corps apparut vite comme pionnière en élaborant seule son plan d’occupation des sols. Tout commença par un état précis des lieux, parcelle par parcelle, construction par construction, qui nous amena à parcourir toutes les rues de la ville. Cela fut complété par des études démographiques découlant du recensement général de la population placé sous la responsabilité du service. La fonction « études générales » était clairement établie. Le schéma stratégique d’aménagement de la ville en découla, puis en application des textes, les différentes composantes du POS : document de présentation générale, zonage, règlement, coefficients d’occupation des sols, emplacements réservés pour les équipements publics. C’est ainsi qu’un jour, nous proposâmes une réserve foncière pour la réalisation future d’un nouvel axe routier reliant le centre-ville à Tours. Nous le baptisâmes avec malice du nom du maire honoraire, Jean Bonin, toujours bien vivant et membre de la commission d’urbanisme. Si Jacques Vigier approuva le projet de voirie, il ne goûta guère notre humour iconoclaste et nous enjoignit de ne pas le renouveler. Le boulevard fut bien réalisé dix ans plus tard, et il porte le nom de Jean Bonin.
Si chaque orientation, chaque étape étaient validées par la commission municipale d’urbanisme, nous n’avons jamais ressenti la nécessité de travailler avec les services de l’État. L’objectif de Jacques Vigier était atteint : nous avions sauté la case élaboration conjointe pour directement passer à celle de l’élaboration décentralisée.
La fonction information vint se greffer sur nos activités de base par opportunité, même si nous avons bien essayé d’expliquer que c’est l’aménagement de la ville qui nécessitait le plus d’informations. C’est en réalité la proximité de l’équipe avec le maire qui fut à l’origine de cette nouvelle attribution. L’essentiel du travail consistait à assurer la publication du bulletin municipal, La Clarté républicaine. Entreprise artisanale s’il en fut, puisque nous faisions tout à l’exception de l’impression : sommaire, rédaction des articles, photos avec un vieux Rolleyflex, maquette. On attendait avant de mettre sous presse l’édito du maire rédigé minutieusement par ses soins.
C’est ce savoir-faire artisanal qui nous conduisit à concevoir et réaliser nous-mêmes l’exposition d’urbanisme pour la présentation du plan d’occupation des sols avant son approbation. Une trentaine de panneaux disposés dans le hall, l’escalier et la salle des mariages de la mairie présentaient « Saint-Pierre hier, aujourd’hui, demain ». Un montage audiovisuel bricolé dans un tunnel en contreplaqué de quatre mètres de long, avec un projecteur diapos à un bout, et du papier-calque faisant office d’écran, tendu à l’autre bout, constituait le clou de l’expo. Ce n’est que tard dans la nuit qui précédait le jour de l’inauguration que nous avons trouvé, mon ami Michel Cibot{8} et moi, le procédé technique pour « toper » la bande-son afin de synchroniser les images avec des commentaires et la musique du film de Charlie Chaplin Les Lumières de la ville. Le maire Jacques Vigier veillait et attendait anxieux dans son bureau. Dès que lui parvint la nouvelle de la prouesse technique, il accourut avec une bouteille de Chinon.
Il me fut offert de vivre un autre grand moment de journaliste localier : l’arrivée de la vieille locomotive à vapeur... offerte par la SNCF à la commune et qui devait prendre place dans un square de la ville. Le procédé le plus efficace pour la transporter du réseau ferré à sa dernière demeure fut d’installer plusieurs centaines de mètres de rails sur la route et dans le square. L’opération n’avait pas été médiatisée, mais je décidai, mon Rolley sur le ventre, d’aller faire quelques photos pour le bulletin municipal. Lorsque j’arrivai sur place, quelle ne fut pas ma surprise de constater que plusieurs centaines de personnes étaient là pour assister à l’événement. Le téléphone cheminot avait marché. Je réussis à retarder quelque peu la manœuvre, juste le temps de prévenir Jacques Vigier, qui put faire une entrée triomphale dans sa ville aux commandes de la locomotive. Je fis de belles photos.
La commission municipa...