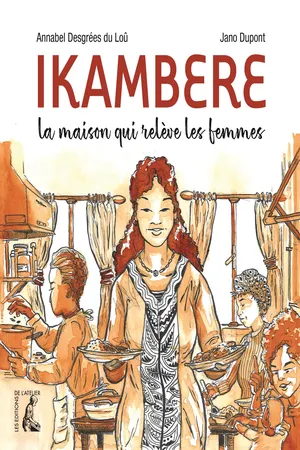![]()
Chapitre 1
Au départ : une rencontre entre femmes battantes
Ikambere est née de la rencontre entre Bernadette et un groupe de femmes touchées par le virus du sida, en 1995, en France, au plus fort de l’épidémie. L’énergie de l’une a pu faire émerger le courage et la volonté d’avancer des autres, à un moment où peu de moyens étaient disponibles pour aider les personnes frappées par cette maladie.
Bernadette : de l’anthropologie à l’engagement associatif
Bernadette Rwegera arrive en France en 1989. Elle vient, avec ses enfants, rejoindre son mari qui fait sa thèse de doctorat à Paris. Au Rwanda, elle a été professeure en lycée, formatrice en nutrition, mais elle voudrait reprendre des études et rêve de faire de la haute couture à Paris, capitale de la mode. Elle coud déjà beaucoup, fait ses robes, celles de ses enfants. Elle cherche un atelier, mais finit par renoncer devant le coût de la formation. Elle se tourne alors vers l’anthropologie et s’inscrit en maîtrise à l’École des hautes études en sciences sociales. Au moment de choisir un sujet de mémoire, son mari, qui travaille à l’Organisation panafricaine de lutte pour la santé, l’Opals, lui propose de s’intéresser aux femmes africaines touchées par le sida. On est en 1995, l’épidémie de VIH/sida s’installe sur le devant de la scène et, en France, on commence à réaliser qu’elle ne concerne pas seulement le monde gay mais touche aussi beaucoup un groupe bien mal connu : les femmes venues d’Afrique. Dans certains pays du continent africain, l’épidémie est en train de devenir une catastrophe sanitaire, économique, sociale. On ne sait pas encore la soigner, mais on a compris ses modes de transmission : par le sang, les rapports sexuels, le lait maternel. Le virus du VIH avance silencieux, on peut le porter des années sans le savoir, mais quand il a suffisamment décimé le système immunitaire, un cortège de maladies apparaît. En 1995, avant la mise au point des premiers traitements qui n’arriveront qu’un à deux ans plus tard, c’est encore la mort assurée. Les médecins hésitent à proposer un test de dépistage car, en cas de résultat positif, ils sont démunis. Chez les hommes, il faut en général attendre le stade sida, quand la maladie est très installée, pour que le diagnostic soit fait. Chez les femmes, la situation est très différente.
Les femmes enceintes sont les premières chez qui on peut organiser des dépistages à grande échelle, en utilisant la prise de sang qui est faite systématiquement dans le cadre de la surveillance de la grossesse pour déceler une éventuelle syphilis et la traiter avant la naissance. C’est donc à partir de cette surveillance que l’on va suivre l’évolution de cette nouvelle épidémie, le VIH/sida. On découvre ainsi que dans de nombreux pays africains, l’épidémie touche « Madame tout le monde » et n’est pas du tout circonscrite à des groupes à risque. En Côte d’Ivoire, dans les consultations prénatales des grandes villes, une femme enceinte sur sept est séropositive. De nombreuses femmes africaines apprennent ainsi, à l’occasion d’une grossesse, qu’elles sont atteintes par ce virus, bien avant d’éprouver les symptômes de la maladie, et à un moment où personne dans la famille n’est malade.
Sans espoir de traitement, ce diagnostic est perçu comme un arrêt de mort, tant pour les patients que pour les médecins et les autres professionnels de santé, très démunis. Mais il entraîne aussi le vide autour de soi : les amis s’éloignent, les conjoints font chambre à part, quand ils ne s’en vont pas. Cette maladie, parce qu’elle terrifie tout le monde, met au ban de la société. On a compris qu’elle se transmettait par les fluides corporels, les malades sont donc mis à l’écart : au sein des familles, ils sont souvent contraints à prendre leurs repas à part, à avoir leur propre vaisselle, leur propre linge.
Les histoires de femmes répudiées par leur mari après avoir découvert qu’elles étaient séropositives pour le VIH se multiplient. Ultime renoncement : on leur conseille de ne plus avoir d’enfant car, sans traitement, une femme qui a le virus du VIH a un risque de 25 % de le transmettre à l’enfant qu’elle porte.
En 1995, ce contexte est mondial : au nord comme au sud, en Afrique comme en Europe ou aux États-Unis, se découvrir séropositif pour le VIH c’est rencontrer l’impuissance des médecins et causer de la peur. En France, face à ce cataclysme, la communauté homosexuelle se mobilise, serre les rangs, déploie des trésors d’accompagnement pour les malades. Puisqu’on ne peut pas soigner, il faut prendre soin. Mais les femmes africaines qui vivent en France et qui sont touchées par le VIH ne rencontrent pas cette mobilisation de l’entourage. Terrifiées à l’idée que leur famille apprenne la nouvelle, elles se taisent. Cet isolement est renforcé par l’exil : bien souvent, elles sont arrivées en France avec peu d’amis, peu de famille. Elles doivent faire face seules et, quand leur enfant est malade, c’est à la maladie de l’enfant qu’elles consacrent toutes leurs forces.
La seule association qui existe alors et qui rassemble quelques femmes touchées par cette maladie est Sol En Si{2}, créée autour des enfants atteints par le sida. Au sein de cette association où les femmes ne viennent qu’en tant que mères, Bernadette Rwegera est chargée d’accueil et propose un « club solidarité » un après-midi par semaine, où les femmes peuvent parler entre elles, dans une salle à côté de l’hôpital Robert-Debré (Paris 19e). Bernadette apporte des gâteaux qu’elle a préparés elle-même. Les participantes se mettent aussi à apporter des pâtisseries, des boissons. Ces femmes, jusque-là très isolées, ont enfin un espace et un temps où elles sont accueillies, où elles partagent leurs recettes et leurs inquiétudes, leurs joies et leurs difficultés.
À la fin de la mission de Bernadette, le groupe continue à se réunir chez l’une ou chez l’autre, à prendre des repas ensemble. Au Noël qui suit, Bernadette organise une fête avec un partage de cadeaux : toutes apportent des petites choses emballées, on tire au sort les paquets pour en offrir à chacune. Une semaine après, le 31 décembre 1995, Bernadette est chez elle et reçoit un appel : les femmes de ce petit groupe se sont réunies chez l’une d’entre elles, Odile, pour fêter le réveillon. Bernadette jubile : elles sont capables de se réunir sans elle ; elles forment un groupe solidaire, une famille ; elles ont quitté ce soir-là leurs maris pour se retrouver entre elles.
Dans les mois qui suivent, les femmes continuent à se retrouver et à prendre des repas ensemble chez Odile. Bernadette, elle, a trouvé un autre travail dans une « maison des femmes » dans une ville de la banlieue parisienne, une structure qui s’occupe de femmes victimes de violences. Bernadette y est vite mal à l’aise. Elle trouve que les solutions proposées aux femmes ne tiennent pas toujours compte de leurs réalités : aux femmes victimes de violence conjugale, on propose parfois des hébergements très loin de là où elles ont leur réseau. Comment ces femmes feront-elles garder leurs enfants pour aller travailler si elles n’ont pas autour d’elles des voisines ou amies de confiance ? Au sein de la structure, on ne l’écoute pas assez quand elle soulève ces questions. Elle qui a déjà une trentaine d’années, trois enfants, qui a travaillé au Rwanda puis repris un cycle d’études supérieures en France, elle est traitée en exécutante, et ne se sent pas à l’aise dans cette ambiance de relations autoritaires, pouvant aller jusqu’au manque de respect et à l’agressivité verbale.
Elle est restée en contact avec le groupe de femmes qu’elle avait suivi à Sol En Si : pourquoi ne pas monter une association pour ces femmes, porter elle-même un projet ? Forte de ces expériences, elle veut monter elle-même une structure plus accueillante, à la fois pour les personnes qui sont reçues et pour celles qui y travaillent, une structure qui prenne en compte les femmes dans l’entièreté de leurs besoins.Elle n’a aucune formation au montage de projet, ne sait pas faire un budget. Elle dira plus tard que c’est cette naïveté qui l’a sauvée car elle s’est engagée dans cette aventure avec la force de l’inconscience. Elle rencontre une collègue de son mari à l’Opals, et lui demande : « Comment monte-t-on un dossier de projet ? » Elle discute avec les uns et les autres, prend conseil. Un médecin lui suggère de se tourner vers Saint-Denis car il y a déjà beaucoup d’associations d’aide aux personnes vivant avec le VIH à Paris. Elle rencontre le médecin de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales, la Ddass, qui lui propose de venir leur exposer son projet à Saint-Denis. À la fin de cette présentation, la Ddass donne son accord pour un premier financement, correspondant à la moitié de ce que Bernadette demandait, et propose un point au bout de trois mois. Le projet est lancé.
Il reste à trouver un local. Ceux que la mairie de Saint-Denis lui propose ne lui conviennent pas, elle les trouve laids, tristes, vétustes. Elle fait le siège de la mairie, obtient un entretien avec le maire sans rendez-vous, en restant piquée devant sa porte : « Monsieur le Maire, les personnes chargées de me trouver un local ne me proposent que des lieux pourris. On ne peut pas recevoir des femmes séropositives dans ces conditions. » Une semaine après, il lui est mis à disposition un appartement de 74 m2, correct, dans la cité des Cosmonautes à Saint-Denis. Trois mois après, lorsque l’inspectrice de la Ddass vient comme convenu juger sur place de ce qui s’y passe, toutes les femmes séropositives accueillies sont là. Elles ont préparé elles-mêmes un repas à l’africaine, dans l’abondance : samoussas, pastels... L’inspectrice voit ces femmes qui s’activent, qui ont pris en main leur association. Elle est convaincue.
Trente femmes sont alors accueillies. L’association tourne grâce à trois personnes : Bernadette, Samia, une éducatrice de la maison des femmes où elle travaillait auparavant qui l’a rejointe, et Odile, celle qui avait organisé le réveillon du 31 décembre chez elle. Pendant deux ans, Ikambere sera un projet au sein de l’Opals. Bernadette apprend au fur et à mesure à faire des demandes de financement, à construire des budgets. En 1999, Ikambere se constitue en association indépendante.
Vingt ans plus tard, Ikambere est devenue une association phare dans la lutte contre le VIH et l’accompagnement des femmes touchées par cette maladie. Chaque année, près de cinq cents femmes sont accompagnées, et cent cinquante nouvelles sont accueillies. Depuis sa création, l’association a aidé plus de 3 500 femmes à reprendre pied.
Au fil des années, les activités se sont diversifiées : en plus de l’accompagnement des femmes qui en poussent la porte, Ikambere assure des permanences dans douze hôpitaux d’Île-de-France et dans douze foyers de travailleurs, pour parler prévention du VIH, convaincre les hommes et les femmes venus d’Afrique de faire le dépistage, les rassurer et les accompagner lorsque le résultat est positif. Vingt-trois personnes y travaillent : assistantes sociales, médiatrices de santé, cuisinière, mais aussi coach sportif, esthéticienne, couturier, gestionnaire, etc.
Ikambere fait désormais partie du « paysage institutionnel » en matière de santé et d’action sociale en Île-de-France. Ses financements viennent pour moitié des pouvoirs publics (Direction générale de la santé, Agence régionale de santé d’Île-de-France, agence Santé publique France, département de Seine-Saint-Denis, région Île-de-France) et pour moitié de fondations privées et de mécènes.
Ainsi, ce qui n’était au départ qu’une petite association d’accueil des femmes africaines vivant avec le VIH est devenu un acteur à part entière de la lutte contre le VIH en Île-de-France, un lieu d’expertise reconnue sur la sensibilisation au VIH/sida. De la rencontre entre l’énergie de Bernadette à son arrivée en France et le courage d’Odile et de quelques femmes frappées par le VIH dans les années noires de l’épidémie est né Ikambere, aujourd’hui partenaire des services de maladies infectieuses dans les hôpitaux, des centres de dépistage des infections sexuellement transmissibles, des foyers de travailleurs, et plus généralement de tous les acteurs qui cherchent à parler à la communauté africaine du VIH/sida.
Derrière Ikambere, une histoire toute personnelle
Les chapitres qui suivent vont revenir sur la façon dont les différentes activités sont orchestrées à Ikambere. Mais, comme dans un orchestre, la couleur est donnée par le chef d’orchestre. Il est difficile de comprendre l’esprit d’Ikambere sans s’arrêter un moment sur l’histoire de Bernadette Rwegera. Histoire qu’elle raconte peu, sur laquelle elle reste très pudique, mais qu’elle a accepté de me confier lorsque j’ai demandé naïvement des éléments pour mieux comprendre la philosophie de cette association. Je n’avais alors pas idée qu’Ikambere plongeait à ce point ses racines dans sa propre histoire et je remercie Bernadette d’avoir accepté que je cite ici son témoignage, car il dit mieux que tous mes mots le cœur d’Ikambere.
« Si j’ai créé Ikambere, c’est sans doute aussi – mais pas seulement ! – parce que j’ai perdu une de mes sœurs à cause du sida. Nous étions très proches. Elle était plus belle que moi. Quand elle est tombée malade, j’étais mariée, j’avais deux jeunes enfants, Damien [mon mari] était en France pour ses études. Je me suis occupée d’elle pendant toute sa maladie. Je la lavais, je lui apportais tout ce qu’elle voulait. J’étais là tous les jours, sauf la nuit car je devais m’occuper de mes enfants. Je lui préparais tous les plats dont elle avait envie. Je faisais de la mayonnaise sur place à l’hôpital car elle aimait ça. Je voulais lui changer les idées. Je lui parlais de l’avenir : “Tu verras, je vais partir en France, rejoindre Damien. Je t’enverrai des belles robes, nous serons heureuses.”
Mais malgré tout ce que j’ai fait pour elle, je réalise que ma sœur se sentait seule. Je l’accompagnais pour qu’elle guérisse mais je ne l’ai pas accompagnée vers la mort, et elle se sentait seule sur ce chemin-là. Elle a fait une allergie à un des traitements qu’on lui avait donné, du coup le médecin a tout arrêté et a remis les traitements un par un pour voir celui auquel elle était allergique ; mais ça l’a tuée car, à partir de ce moment-là, sa santé s’est dégradée.
Cela m’a rendue perméable à la solitude intérieure de ces femmes qui vivent avec le VIH. Cela m’a rendue humble par rapport à ces femmes. On doit les accompagner dans le respect de la souffrance de chacune. Chacune a un parcours unique ; je fais l’effort de connaître le prénom de chacune.
L’expérience de la maladie et de l...