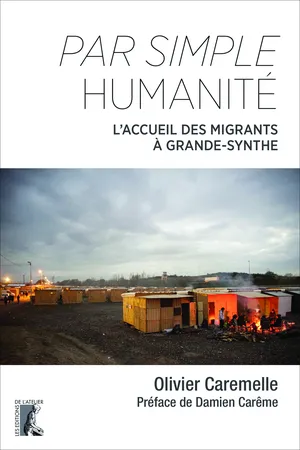![]()
Chapitre 1
L’incendie du camp de la Linière
Il est un peu plus de 23 heures ce lundi 10 avril 2017. Cette date, évidemment, est inscrite dans ma mémoire et le restera jusqu’au bout de ma vie. Damien Carême, maire de Grande-Synthe, m’appelle. Comme nous avons l’habitude d’échanger régulièrement, même tardivement, je ne m’en inquiète pas outre mesure.
« Le camp est en feu ! » me dit-il. Sur le moment, je ne comprends pas tout à fait ce que Damien me dit. « Oui, il y a un feu au camp, ce n’est pas la première fois que ça arrive. – Non, non, le camp est en feu, il est en train de brûler », me coupe-t-il.
Il est 23 h 02, je me mets en route pour Grande-Synthe et prends l’autoroute pour rejoindre le littoral, très inquiet de la situation que je pressens dramatique. J’ai un souvenir précis du trajet qui m’a paru à la fois long et court. Long car, pendant les quarante-cinq minutes de route, m’est revenue en tête toute l’histoire de la construction du camp, nos difficultés à répondre à ce défi humanitaire, à éviter la mort d’hommes, de femmes et d’enfants venus de loin et bloqués sur le littoral, à soupeser les risques et à prendre les bonnes décisions, à négocier avec l’État jusqu’à la rupture...
Court, car le stress et l’anxiété montaient au fil des kilomètres. Je devinais l’ampleur des dégâts, très vite confirmée au téléphone par Laurent Pidoux, le directeur général des services (DGS) de la ville, arrivé déjà sur la Linière, le camp humanitaire. « Mon ami, comme Laurent m’appelait affectueusement, le camp est en feu, il brûle, c’est un brasier... »
Inquiet, j’abrège rapidement la conversation. En m’approchant du littoral, je devine au loin les lueurs de l’incendie. C’est impressionnant. Le ciel rouge orangé évoque la planète Mars. Le camp, assurément, sera totalement détruit d’ici quelques heures.
La Linière, pour le coup, est éclairée. Le rouge de l’incendie, le gris des fumées épaisses, le bleu de la myriade de gyrophares s’entremêlent alors que le bruit et la fureur résonnent dans tout le camp.
Construit en un temps record par Médecins sans frontières (MSF) et nos équipes, le camp humanitaire se situe en périphérie de la ville, près de l’hypermarché Auchan et d’une réserve naturelle nommée le Puythouck. Il est surtout assis sur une ancienne ferme, dite Lefebvre, coincée entre le faisceau ferroviaire et l’autoroute A16 menant à Calais ou à Lille, en fonction de la direction prise par les usagers de la route ou... les migrants. Pour ces derniers, arrivés massivement sur le littoral à Calais et à Grande-Synthe au cœur de l’été 2015, au plus fort de la crise migratoire, c’est rarement la direction de la métropole lilloise ! Pour tout dire, les regards et nos conversations prenaient souvent, pour ne pas dire exclusivement, le chemin de Calais... et de la perfide Albion.
Le préfet de région, Michel Lalande, m’attend à l’intérieur du camp alors que le commissaire de police de Dunkerque, Damien Keunebroeck, m’accueille rapidement, préoccupé d’asseoir la sécurité avec les nombreuses forces de l’ordre présentes. Le bruit des bottes fait écho aux cris, ceux de deux groupes de réfugiés qui se battent et règlent leurs comptes.
Depuis son ouverture en mars 2016, le camp n’a jamais été un havre de paix. Pendant ses quelques mois d’existence, nous avons connu des conflits, des bagarres, des règlements de comptes plus ou moins importants, sans connaître toujours précisément leur objet ni leur finalité.
C’était notre lot quotidien. Celui de faire coexister des milliers de personnes dans des conditions plus acceptables qu’une jungle mais qui restaient pourtant du ressort d’un camp. L’incendie mettra fin à cette expérience originale, la création, pour la première fois dans notre pays, d’un camp humanitaire.
Pour le moment, je devine en m’approchant du préfet Lalande sa profonde exaspération. Il m’accueille, comme il le peut, dans des circonstances terribles, autant pour lui que pour moi et nos équipes sur place. « Ça ne pouvait finir que comme cela, je vous l’avais bien dit. Nous vous avions alerté des risques d’incendie maintes fois et aujourd’hui on doit gérer cette catastrophe. »
Je me garde de répondre au préfet sur le fond. Ce n’est ni le lieu ni le moment de polémiquer et de chercher les responsabilités des uns et des autres alors que la bagarre entre les Kurdes et les Afghans fait rage et que chacun redoute le pire...
Je l’aimais bien, ce préfet. Très politique, il avait été le directeur de cabinet de Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur. Il avait donc vécu de près, lui aussi, avec d’autres responsabilités et certainement une autre vision, cette histoire, à l’échelle internationale et nationale.
Nommé préfet de région pour les Hauts-de-France, il lui revint de gérer le dossier politiquement explosif de l’accueil des migrants, et en particulier la question des deux places fortes de la migration, Calais et Grande-Synthe. Il avait succédé à un autre préfet, Cordet, au profil singulièrement différent.
Je fis alors la part entre la position du préfet et l’inertie de l’État qui avait conduit MSF et Damien Carême à construire dans l’urgence une solution humanitaire pour les migrants vivant au Basroch, cette morne plaine, proche du centre-ville, dans laquelle les exilés s’agglutinaient et tentaient de survivre. De fait, le courroux du préfet, « compréhensible » sur le moment et au vu des circonstances, était nul et non avenu pour toutes celles et tous ceux qui maîtrisaient le fil de l’histoire qui s’était jouée.
L’État était entièrement responsable de cette catastrophe sanitaire en cours, il faut le rappeler. Par ses prises de décisions trop lentes, trop partielles, par son inertie dans un contexte, il est vrai, douloureux, celui des attentats, par son évitement, signe certain d’un malaise politique.
Ce constat s’appuie sur la réalité d’un État soi-disant tout-puissant, capable de déclencher une guerre pour asseoir la paix au Mali mais incapable d’assumer politiquement le premier accueil d’urgence de populations perdues.
Un nouvel appel de Damien Carême me tira de ces quelques réflexions. Il m’interrogea sur l’état du camp et surtout des réfugiés, notamment les familles vivant sur le camp. Je lui répondis : « C’est l’enfer ici. Tout est en train de brûler. Le camp va être détruit entièrement, c’est certain. Ils ont tout cassé, on a fait tout ça pour rien... C’est fini... »
Comme le maire ou Laurent Pidoux, et certainement les milliers de personnes, les bénévoles qui ont œuvré pour le bon fonctionnement du camp, nous mettrons de longues semaines à nous remettre de cette perte. Pourtant, dès le lendemain, il a fallu prendre des décisions urgentes pour la sécurité et la tranquillité de tous, migrants et habitants de la ville.
Sur le moment, c’est plutôt un grand découragement qui me gagne. J’entends sans l’écouter la voix de Damien au téléphone en avançant dans le camp. Ce que je vois, entends et respire n’a rien de commun, ni d’habituel, avec le camp humanitaire. Le silence s’installe entre Damien et moi alors que je marche à l’intérieur du camp ravagé par les flammes.
Le feu mord toutes les structures en bois que nous avions consciencieusement ignifugées, shelters{8}, « women center », lieu éducatif, cuisines communautaires qui avaient été transformés en dortoirs par les Afghans. Il ne restera, quelques heures après le départ de feu, que quelques shelters debout, les bâtiments de l’Afeji (association des Flandres pour l’éducation, la formation des jeunes et l’insertion, à qui nous avions avec l’État confié la gestion du camp) et le lieu d’information de Cyrille Hannappe, architecte de Belleville, et de ses étudiants, réalisé quelques mois auparavant. Un an et demi plus tôt, le camp sentait le bois. Cette nuit-là, la fumée omniprésente annonce des jours plus sombres.
Tout autour de moi, dans le camp et surtout dans ses alentours, je devine les visages de celles et ceux que nous hébergions. Beaucoup sont en pleurs, catastrophés par la perte de leur shelter, de leurs effets personnels, du peu que chacun d’entre eux avait réuni si difficilement.
Nous eûmes à déplorer, finalement, peu de blessés, six à l’arme blanche, dont tout de même un gravement atteint. Pas de mort, pas d’enfant retrouvé dans les décombres. Un petit miracle... Je ne fus totalement rassuré que le lendemain matin quand les diverses inspections permirent d’être totalement certain qu’aucune personne n’avait perdu, ce soir-là, la vie.
Emmanuelle Cosse, la ministre du Logement de l’époque, me fit elle-même part de son soulagement :
Quand nous arrivons le lendemain sur place avec Matthias Fekl, ministre de l’Intérieur, nous sommes soulagés qu’il n’y ait pas eu de morts. C’est incroyable d’ailleurs pour tous ceux qui ont vu l’état du site après l’incendie. À quinze jours de la présidentielle, personne n’a voulu en rajouter mais bon...{9}
Comment en étions-nous arrivés à cette catastrophe ?
Les faits sont têtus. L’afflux d’exilés, la promiscuité et les rivalités entre populations hébergées, Kurdes contre Afghans, se sont mêlés pour créer, ce jour-là, cette catastrophe. Cela aurait pu être la veille, ou une semaine plus tard. C’était peut-être inéluctable. Nous avions pourtant la situation en main jusqu’à ce que l’État décide de démanteler la « jungle » de Calais. Je détestais ce terme impropre. Je détestais ce mot qui renvoyait des êtres humains aux conditions indignes dans lesquelles ils vivaient. Je détestais ce mot qui nous salissait.
Ainsi, entre mars et octobre 2016, grâce aux mises à l’abri organisées par l’État et très certainement aux départs et passages vers l’Angleterre, on observa dans le camp un resserrement démographique organisé conjointement par la municipalité, l’Afeji et l’État. La population du camp fut pendant cette période, grâce à nos efforts collectifs, divisée par deux, passant de 1 300 à 750 personnes.
Dès le début de l’aventure, les conditions avaient été posées : si la ville et MSF se substituaient à l’État, celui-ci devait rapidement reprendre toutes ses responsabilités et organiser l’accueil d’urgence. Ce fut le sens des discussions que nous avions menées avec l’État jusqu’à la signature de la convention tripartite avec celui-ci et l’Afeji.
L’idée était relativement simple. Au fur et à mesure des départs, il s’agissait de retirer des capacités d’hébergement devenues inutiles puisque les populations étaient mises à l’abri ou passaient en Angleterre.
Cela avait beau être contesté ou minoré par le sous-préfet de Dunkerque, un grand nombre des départs des migrants du camp était dû à leur détermination à franchir, par tous les moyens déjà, la frontière, en passant par Calais mais aussi par les ports belges, peu sécurisés à l’époque... La pression sur les aires d’autoroute était à ce titre un exemple flagrant du problème. La décision du gouvernement français de procéder au démantèlement de la jungle de Calais sans se questionner sur le sort du camp humanitaire de Grande-Synthe joua donc un rôle décisif dans la suite des événements.
Bernard Cazeneuve s’en expliqua auprès de moi, avec franchise :
Toutes les personnes, lors du démantèlement de Calais, sont parties en CAO [centres d’accueil et d’orientation] et dans le dispositif national de mise à l’abri. J’aurais souhaité faire la même chose à Grande-Synthe, mais la population était différente. Il y avait, vous le savez, énormément de Kurdes. La présence des passeurs y était très importante et il y avait des violences sans doute plus nombreuses qu’à Calais. Je ne pouvais régler Calais et Grande-Synthe en même temps. Pour procéder à la mise à l’abri de Calais, il m’a fallu ouvrir 675 centres d’accueil et d’orientation. Ça a été des mois de préparation par de multiples vidéoconférences, des semaines de préparation par les fonctionnaires{10}.
Emmanuelle Cosse aura, de son côté, d’autres arguments à faire valoir :
Les CAO ont été imaginés par Bernard Cazeneuve avant mon arrivée. Avec son réseau, il les a mis en place à petit bruit, assez discrètement, pour des raisons que l’on devine : ne pas agiter le chiffon rouge alors que l’extrême droite était déjà très haute. Puis on est monté en puissance en implantant d’autres structures, puis ce fut le plan migrant, mais aussi l’attentat de Nice... En août, nous avons lancé l’opération « hébergement citoyen » avec la Dihal [Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement]. À la rentrée, il y a eu une grosse échauffourée à Calais.
Je me souviens de tout cela parfaitement. J’ai reçu un appel de Bernard qui me disait : « J’ai pris une décision, il faut fermer Calais. Ce n’est pas possible, on va avoir des morts, c’est intenable. » J’ai accepté, mais en demandant que l’on reloge tout le monde. Il fallait 10 000 places ! Nous sommes allés, dès le lendemain, fin août, voir le président.
Pour Grande-Synthe, c’était autre chose. Le camp de la Linière était « institutionnalisé » et le maire aurait été contre sa fermeture, non ? Je pense surtout que l’on ne pouvait pas faire les deux en même temps. La priorité, c’était Calais. On s’est rendu compte qu’il fallait aussi arrêter de concentrer tous les problèmes au même endroit, en l’occurrence à Calais. Enfin, disons les choses : nous ne voulions pas non plus nous créer un autre problème avec Damien Carême{11}.
Malgré les arguments du ministre de l’Intérieur et ceux de la ministre du Logement de l’époque, je reste convaincu que cette stratégie était une erreur politique du gouvernement, considérant les risques encourus et évidemment le fil de l’histoire maintenant connue. Mais évidemment, je comprends fort bien que le problème politique était essentiellement à Calais.
Le démantèlement de la jungle de Calais, décidé en octobre 2016 par le gouvernement, n’est pas resté sans conséquence pour Grande-Synthe et le camp humanitaire. Dès les premières heures de la mise à l’abri des populations de Calais, décidée par Bernard Cazeneuve, le site de Grande-Synthe a été considéré comme un refuge potentiel, notamment pour les Afghans. Près de 300 d’entre eux, la plupart mineurs non accompagnés, se sont mis en route pour la Linière, espérant trouver une place et un shelter. Ils refusaient, bien entendu, de quitter le littoral : après avoir tout tenté et risqué, ils se retrouvaient bloqués à quelques dizaines de kilomètres de l’Angleterre, voyant par beau temps ses côtes se dessiner au loin.
Sylvie Desjonquères, responsable de la communauté Emmaüs de Grande-Synthe et très impliquée dans l’accueil des exilés, me confirma tout cela :