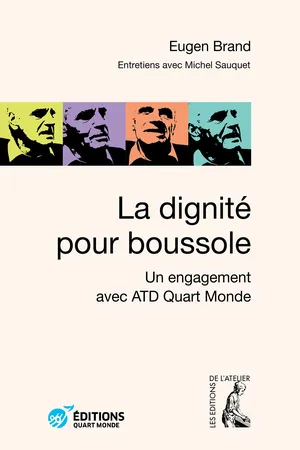![]()
Chapitre 1
Oberland
Michel Sauquet : Au cours des quelques entretiens que nous avons eus avant de nous engager dans ce livre, vous avez insisté – et je suis pleinement d’accord avec cela – sur le fait que nos engagements ont une forme de traçabilité, que notre histoire personnelle peut en expliquer le développement (ou l’absence). Ma première question sera donc toute simple : quelle est votre origine, d’où venez-vous ?
Eugen Brand : Je suis né dans une ferme d’une vallée montagnarde de l’Oberland bernois, du nom de Turbach. Ma langue maternelle est le suisse allemand. C’est une langue très particulière, différente de l’allemand{1}, que j’ai dû apprendre à l’école. Le français, ce fut beaucoup plus tard, et je dois dire que j’ai eu tellement de mal à l’assimiler que j’enviais les autres élèves de pouvoir apprendre, quant à eux, l’anglais !
Mon père était un petit éleveur, il avait cinq vaches. Nous vivions de leur lait et de la vente de la crème dont je transportais toujours un petit bidon en allant à l’école. De temps en temps, nous vendions un veau. Et parfois, il n’y avait plus d’argent. Mais ce n’était jamais un drame. Nous avions une vie simple, et nous vivions dans un environnement où l’esprit d’entraide dominait : réparer les chemins, dompter un ruisseau, c’était l’affaire de tous. Les voisins s’aidaient mutuellement dans les travaux de construction et dans les travaux agricoles. Toute la vallée se rassemblait lors des jours de deuil, et se retrouvait en hiver pour faire du théâtre et du chant. Une ambiance de solidarité et de créativité à la fois remarquable, mais terrible pour ceux qui étaient trop pauvres pour contribuer à tout cela.
M. S. : Pourquoi ? Pourquoi les plus pauvres n’entraient-ils pas dans ce système d’entraide ?
E. B. : Je pense qu’il y a une sorte de limite de flottaison, au-dessous de laquelle tout devient plus difficile sinon impossible. Je l’ai souvent observé par la suite. Dans son rapport « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » présenté au Conseil économique et social{2} il y a déjà une trentaine d’années, le Père Joseph Wresinski donnait, à travers la définition de la précarité, une image très précise de la grande pauvreté :
La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer des responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible{3}.
Je ne connaissais pas, à l’époque, cette définition qui a été ensuite reprise par les Nations unies, mais c’est exactement cela que j’ai pu observer dans la vallée de Turbach de mon enfance : la grande pauvreté compromet les chances de réassumer (ou même simplement d’assumer) des responsabilités, et donc de contribuer à la vie collective. Et lorsque ces précarités se cumulent et durent, les gens basculent dans une situation de non-droit.
M. S. : Votre père était loin de rouler sur l’or, apparemment, mais il n’était pas dans cette situation-là ?
E. B. : Non. Mon père était paysan, mais sa véritable passion était celle de la construction. Il aurait beaucoup aimé pouvoir bâtir des maisons. Mais dans la vallée, quand on avait un bout de terre à soi, il n’était pas convenable de ne pas le cultiver. Pour autant, il n’a pas renoncé complètement à sa passion, car à la fin de sa vie, il faisait de très beaux meubles, avec de la marqueterie, que les gens de la vallée, et au-delà, lui commandaient. Lorsqu’on lui demandait le prix, il ne savait que dire, car il ne se sentait pas la légitimité de fixer un prix en professionnel. La seule chose qu’il pouvait dire, c’est le nombre d’heures que cela lui occasionnait. « Mettez ce que vous pouvez », répondait-il. Je crois que c’était très caractéristique d’un certain rapport à l’argent, qu’il m’a communiqué : « Quand tu fais quelque chose, me disait-il, c’est pas l’objectif pécuniaire qui domine. L’argent n’est pas secondaire, mais il est second. »
Notre maison familiale était chargée d’une longue histoire, teintée aussi de misère. C’est ma grand-mère paternelle, Louise, qui a été amenée à élire domicile dans cette petite ferme complètement délabrée qui n’avait plus de plancher. Elle venait d’une famille très aisée de la vallée, pourtant. D’une de ces familles dont on disait chez nous qu’« elles avaient le dernier mot ». Mais, probablement séduite par son humour, elle a épousé un homme – Alfred, mon grand-père paternel – qui avait eu une enfance très dure. « Il faut bien de l’humour face à la vie, disait-il, quand on a connu ce que j’ai connu... » Il avait fait partie des Verdingkinder (enfants « chosifiés »), ces milliers d’enfants utilisés comme force de travail dans les fermes avant la mécanisation de l’agriculture. Cela n’a pas été le cas pour lui, mais beaucoup d’entre eux avaient été arrachés par les autorités à leur famille au motif qu’elles étaient trop pauvres. Ils étaient amenés sur les places publiques et « cédés » par la commune à ceux qui demandaient le moins et qui leur infligeaient ensuite souvent, dans les fermes, un traitement sous-humain. On ne les appelait pas par leur nom, on les appelait « Bub » ou « Meitli » (garçon ou fille), et il y avait ces trois « rien » pour justifier les traitements qu’on leur infligeait : « Tes parents ne sont rien, tu n’es rien et de toute façon de toi n’adviendra jamais rien. » C’étaient des enchères à l’envers, qui permettaient aux communes de faire des économies sur leurs obligations. C’était terrible. Les fratries étaient séparées, déchirées, leurs parents ne pouvaient rien faire pour l’éviter. Cette vente au rabais d’enfants à des paysans a duré jusqu’aux années 1920. La Suisse est un pays de démocratie participative où l’on peut mourir de silence ! Ce n’est qu’en 2013 que le gouvernement helvétique a demandé pardon pour ces violences...
M. S. : Pour autant, la violence de la misère qui sépare les enfants de leurs parents est loin d’avoir disparu dans nos sociétés...
E. B. : Bien sûr que non ! Le fait que cette violence perdure dans le monde entier et qu’on continue à la tolérer est essentiel dans l’histoire et la lutte du Mouvement ATD Quart Monde. Le Mouvement a toujours voulu porter cette question dans la vie publique et internationale, et en particulier l’ancrer dans les préoccupations des Nations unies, notamment par un travail de recherche intitulé « Quand l’extrême pauvreté sépare parents et enfants : un défi pour les droits de l’homme{4} ». « Tes parents ne sont rien, tu n’es rien, tu ne seras jamais rien... » Comment peut-on asséner ça à un être humain ?
M. S. : La misère tient donc une grande place dans votre ascendance.
E. B. : Oui, mais j’ai mis du temps à découvrir ce fil dans l’histoire de ma famille. Le père de ma mère était un immigré de l’intérieur poussé par une forte volonté de bâtir une vie meilleure pour sa famille. Il a trouvé une ferme à acheter dans le Saanenland. Il a travaillé dur pour que ses enfants puissent apprendre un métier, faire des études. Ma maman est devenue enseignante, et formatrice de futurs enseignants. Son père, qui l’avait fortement encouragée dans cette voie et l’avait poussée à faire des études, n’a pas été ravi qu’elle veuille épouser le petit paysan montagnard qu’était mon père. Il ne pouvait pas accepter un tel retour en arrière. Le jour précédant son mariage, elle a été le voir pour lui demander, en vain, sa bénédiction. Et, par la suite, il a toujours refusé de mettre les pieds à la maison. Mes parents ont beaucoup pleuré à cause de cela. Pourtant, peu rancunier, mon père a aidé par la suite son beau-père à refaire sa grange : la réconciliation non par les mots, mais par la générosité du geste. C’est ce « faire ensemble » qui leur a permis de se retrouver et de se reconnaître.
M. S. : Étonnants, ces dénouements inattendus dans les chemins de vie !
E. B. : Oui, et c’est quelque chose que j’ai observé au sein du Mouvement à de multiples reprises : le sacré de chaque chemin de vie. Rien ne vous permet de vous y immiscer, quelles que soient les responsabilités que vous pouvez avoir dans le Mouvement, parce que, au cœur de ces chemins de vie, il y a toujours une recherche inattendue et unique. Les pauvres n’ont certes pas attendu ATD pour l’engager, cette recherche, mais le Mouvement peut aider à la mutualisation des expériences individuelles, tout en se rendant disponible à chaque chemin de vie dans ce qu’il a de sacré. D’ailleurs, le Mouvement connaît toujours une tension forte entre le « je » et le « nous », entre l’individuel – le « tréfonds » personnel – et le collectif. Ce qui soulève aussi la question de l’identité et de la liberté. Nelly Schenker, militante suisse d’ATD, disait : « Il ne peut pas y avoir la paix, ni en moi ni avec les autres, si ce n’est pas dans une quête de liberté. » C’est cela que nous devons inscrire au cœur de notre projet collectif, ce triptyque identité-dignité-liberté, et ce n’est pas toujours facile.
M. S. : Cela me rappelle les propos d’une femme aborigène australienne rapportés lors d’un des séminaires du Mouvement en 2014. Cette femme avait dit à un volontaire d’une ONG européenne : « Si tu es venu pour m’aider, alors retourne chez toi ; si tu es venu parce que tu penses que ta libération passe par la mienne, alors reste avec moi et travaillons ensemble. » J’avoue que je répète souvent cette phrase magnifique lorsqu’il m’arrive d’intervenir auprès d’ONG sur les questions interculturelles. Mais revenons au « faire ensemble » qui a permis à votre père et votre grand-père de se réconcilier.
E. B. : Ce « faire ensemble », il a été aussi le cœur de ma relation à mon père. Très tôt, il m’a associé aux travaux des champs, mais de manière très humaine : « Allez, nous disait-il, il faut attendre que les foins sèchent. Vous pouvez aller jouer ! » Mon père conjuguait un tempérament très pudique (il n’empiétait pas sur les affaires des autres, mais il se réalisait dans la danse et le théâtre) et une très forte personnalité, colérique parfois, y compris avec lui-même. Jamais il ne nous aurait frappés, mes sœurs et moi.
Une de mes sœurs, Annemarie, est devenue infirmière de soins intensifs. Ce métier, qu’elle a vécu comme une vocation, l’a amenée plus tard à devenir infirmière à domicile où elle a su créer de forts liens de confiance avec des personnes se trouvant parfois dans des situations de grande pauvreté. Ma deuxième sœur, Véronique, est devenue institutrice, puis elle s’est formée en ortho-bionomy{5} qu’elle pratique aujourd’hui encore, et qui consiste à accompagner des personnes dans la recherche de leur équilibre originel. Et j’ai une troisième sœur, Ruth, que nous avons accueillie à l’âge de 6 ans en raison de la grave maladie de sa mère, qui était une amie de la mienne.
M. S. : Pudique et colérique ! D’après ce que j’observe de vous, vous avez peut-être hérité de votre père le premier trait de caractère, mais nullement le second !
E. B. : Mais mon père ne se résumait pas à cela ! Il était soucieux avant tout d’établir un contact avec les autres. Et cela passait par la marche. Avec lui, j’ai beaucoup marché dans la vallée. Marcher faisait partie de mon enfance, suivre les pas de mon père. Je revois ses pieds et ses arrêts fréquents : « C’est quand je m’arrête pour parler avec les autres que je peux apprendre, me disait-il. On ne doit pas lésiner sur le temps passé avec les autres. » Plus tard, dans le Mouvement, j’ai découvert une autre marche encore, celle de tant de femmes et d’hommes sous le soleil pour aller à la rencontre d’un voisin, pour se donner des nouvelles, prendre soin les uns des autres. Des efforts inlassables et invisibles que les experts de la Banque mondiale ne savent pas comptabiliser.
J’ai marché avec ma mère aussi. Comme je l’ai déjà dit, elle était institutrice, et lorsque j’ai commencé à aller à l’école, nous y allions à pied ensemble, ou en ski en hiver. Parfois, au retour, elle marchait les yeux fermés. Je lui demandais pourquoi. « Je me prépare intérieurement à ce qui m’attend à la maison », me répondait-elle. C’était tout elle, cette réponse : elle était passionnée de mathématiques et de pédagogie, mais elle tenait aussi à assurer le mieux possible, à la maison, les tâches ménagères, qui étaient souvent très dures. Avant tout, c’était pour elle une façon de se préparer à rejoindre l’autre là où il est, dans ce qu’il cherche à réaliser.
C’était une enseignante soucieuse de la circulation du savoir. Chez elle, chacun avait quelque chose à partager ; elle mettait constamment en valeur le savoir des uns et des autres, et elle donnait beaucoup de valeur au libre arbitre de chacun. Pour travailler un thème, elle nous envoyait en petits groupes questionner les habitants de la vallée. J’ai cette image en moi de parents assis au milieu de nous et nous parlant de leur histoire, de leur métier, de leurs passions... Un détail : si l’on était gaucher (ce qui était mon cas), on décidait de quelle main on voudrait écrire plus tard. Une liberté très rare à l’époque. Et pas de sexisme ! Filles et garçons, on apprenait tous à tricoter, scier et raboter.
Maman est morte un jour devant mes yeux, dans la neige, d’une commotion cérébrale. J’étais seul avec elle, je l’ai vue tomber, j’ai dû la traîner. J’avais 21 ans, ça a été un choc terrible. Je ne sais pas si je lui en ai voulu de décéder de cette manière. Sa façon de mourir, qui mettait fin à toute relation avec elle, me faisait apparaître le moment de la mort comme quelque chose de violent qui interrompt toute relation. De son vivant, ma mère nous apportait un monde culturel, artistique, un monde de la ville. Mon parrain était un proviseur. Il y avait toujours du monde chez nous. Du jour où ma mère est décédée, ces gens ne sont plus revenus. Moi, ça m’a mis en colère, mais mon père n’a jamais pris cela pour lui, ni porté un jugement par rapport à cette désertion.
Mon père est mort beaucoup plus tard. Je me souviens de ses derniers instants. Curieusement, ce n’était pas douloureux pour moi. Nous échangions des mots de tendresse entrecoupés de silence. C’était très serein. Je le veillais avec Véronique et Annemarie. Il a dit à un moment donné : « maintenant, j’aimerais me reposer », puis il est parti. J’ai senti que quelque chose se détachait doucement de son cœur. Son âme peut-être. Avec ce message : « N’aie pas peur, la vie ne s’arrête pas, rien ne s’arrête ; les liens continuent. »
M. S. : Vous évoquez vos parents avec un très grand respect et beaucoup de tendresse. D’ailleurs, à l’oral, vous parlez plus volontiers de votre « papa » et de votre « maman » que de votre père et de votre mère. Et à travers eux et leurs propres origines, on lit quelque chose de ce qu’on pourrait appeler votre « traçabilité sociale », celle d’une identité fragmentée : vous êtes issu à la fois du monde de la grande pauvreté et de celui de la bourgeoisie, d’un monde de paysans aisés, de propriétaires. C’est-à-dire de deux univers que l’on retrouve aujourd’hui, unis par un même combat pour la dignité, dans la constellation sociale d’ATD Quart Monde. Est-ce que ces origines expliquent votre engagement dans le Mouvement ?
E. B. : Oui et non. Il y a ces origines, mais il y a surtout, je pense, les rencontres faites dans mon propre parcours de vie. Il y a ces personnes, ces manières de vivre qui m’ont interpellé. Lorsque j’ai rencontré le Père Joseph – j’y reviendrai plus loin –, il m’a beaucoup aidé à revisiter mes origines et mon parcours, et à les regarder sous un nou...