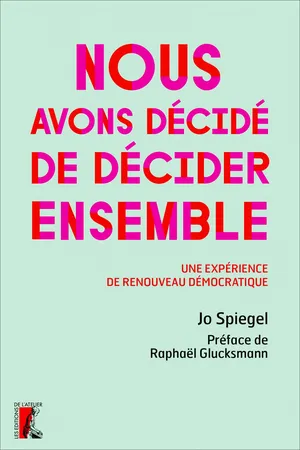![]()
Chapitre 1
Rencontres improbables
De Nancy à Kingersheim
Je viens d’être libéré des obligations du service militaire, effectué au bataillon de Joinville, à Fontainebleau, dans le cadre de la préparation olympique aux Jeux de Montréal. Je tourne le dos à l’année la plus intense de ma vie sur le plan sportif et la plus vide sur le plan humain. Marié depuis trois ans, j’étais éloigné de mon épouse, toute la semaine durant, pour me retrouver dans la promiscuité d’une chambrée à quatre.
Passionné par mes trois années d’études à l’Unité d’enseignement et de recherche (UER, ancêtre des UFR) en éducation physique et sportive (EPS) de Nancy puis par mon premier poste d’affectation professionnel au service du sport scolaire de Meurthe-et-Moselle, je me retrouvais à passer tout mon temps à avaler des kilomètres et à enchaîner des fractionnés !
Cette année-là fut l’année zéro de ma vie. Malgré une dose d’entraînement jamais égalée, je n’ai pas même réussi à battre mon record d’Alsace établi sur le 800 mètres l’année précédente !
Heureusement, mon temps du service militaire a été raccourci pour pouvoir effectuer la rentrée scolaire sur un poste de professeur d’EPS au collège d’enseignement technique (CET) de Pulversheim, dans le Bassin potassique. J’y effectuerai toute ma carrière professionnelle !
C’était fin août 1976. Avec mon épouse, nous quittons Nancy, la ville de nos études et de notre première affectation d’enseignants en EPS, pour rejoindre l’Alsace, ma région d’origine et de cœur. Dans la camionnette de déménagement, nous emportons avec nous un minimum de mobilier, le « meuble » du salon formé de dix-huit briques et d’autant de planches de sapin, nos bouquins, nos cours de psychopédagogie et les disques de Joan Baez, de Bob Dylan et de Léonard Cohen.
Dans nos bagages, aucun objet de valeur. Nous nous moquions éperdument des choses matérielles. Ce qui comptait pour nous et nous constituait, c’était notre réussite au certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (Capeps) et l’amour de notre métier d’enseignant. Ce que nous portions, c’était une culture de gauche inspirée, durant nos études et dans mon engagement au sein du syndicat étudiant de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), par les courants de pensée à la fois libertaire, structuraliste et marxisant. Il m’aura fallu un long cheminement pour me rapprocher progressivement du personnalisme d’Emmanuel Mounier. Une philosophie de la personne et de la relation. La personne, unique et singulière, unifiée en elle-même, en relation responsable avec les autres et en relation avec ce qui la transcende. Une philosophie plus que jamais inspirante et qui mérite d’être revisitée à l’aune des grands défis de ce siècle.
Ce en quoi nous croyions, c’était de changer l’école pour changer la société et changer la société pour changer l’école. C’est avec cela que nous traversons les Vosges pour rejoindre l’Alsace et nous rapprocher de ma famille.
Nous sommes accompagnés de notre « premier enfant ». Il est mon compagnon d’entraînement dénommé Huitcent, du nom de cette spécialité du 800 mètres qui m’a vu porter à trois reprises le maillot de l’équipe de France d’athlétisme. Notre chien était connu sur tous les stades de France et de Navarre. C’était un cocker magnifique, hargneux mais tellement attachant. Je me souviens d’avoir pleuré pendant huit jours lorsque la mort nous l’a pris.
C’est le président du club d’athlétisme du Bassin potassique, club auquel je suis resté fidèle malgré de nombreuses sollicitations en Lorraine, qui nous a trouvé un appartement dans une commune d’Alsace dont je venais d’apprendre l’existence : Kingersheim. Pour nous y rendre, il a fallu une carte routière !
C’est dire que rien, strictement rien, ne me prédestinait à y vivre, encore moins à m’y faire élire. Kingersheim et moi, ce fut la rencontre la plus improbable qui soit ! Ville de banlieue, alors qu’avec mon épouse nous aimions la grande ville. Ville de passage, alors que nous aimions les villes patrimoniales. Ville-dortoir, alors que nous aimions la vie culturelle. Ville de droite, alors que tout me poussait à la transformation.
En réalité, Kingersheim fut longtemps la ville où nous nous contentions de loger. Nos centres d’intérêt étaient ailleurs. Ils étaient tournés vers nous, notre petite famille et nos deux enfants, Matthieu et Jérémy, nés en 1977 et 1982. C’est cependant par eux et avec eux que nous avons tissé les premiers liens avec les Kingersheimois par le biais de l’école et des clubs sportifs. Mon épouse s’est mise à s’investir dans la fédération des parents d’élèves FCPE. Leurs revendications étaient inscrites en germe dans le contrat municipal qui nous a permis de gagner les élections locales en 1989.
C’est avec passion que nous investissons notre mission d’enseignant. Cathy exerçait son métier dans un premier poste à Mulhouse puis dans un collège du Bassin potassique parmi l’une des équipes pédagogiques les plus dynamiques d’Alsace.
Quant à moi, avant même que le CET de Pulversheim devienne un lycée d’enseignement professionnel et technologique alors que j’étais un élu du conseil régional d’Alsace en charge des lycées, je me suis passionné avec les enseignants de toutes les disciplines pour la pédagogie de projet, la démarche par objectifs, l’évaluation formative et le contrôle continu. Je me souviens d’avoir partagé cette démarche devant plus de deux cents de mes collègues inscrits en formation continue. Elle rentrera quelques années plus tard dans le référentiel d’enseignement et d’évaluation des enseignants d’EPS.
Ma vie extraprofessionnelle allait progressivement me demander une disponibilité sans doute équivalente à celle qui m’attendait plus tard dans l’exercice de mes mandats électifs. Après m’avoir connu comme athlète passionné, comme étudiant laborieux, mon épouse allait côtoyer un homme complètement investi en tant qu’entraîneur de demi-fond et militant du Parti socialiste (PS).
Des dizaines d’heures bénévoles, chaque semaine, au service des jeunes du Bassin potassique à qui j’ai pu donner le virus de la course à pied et singulièrement du demi-fond. Ce fut une tranche de vie passionnante. Déjà, j’aimais mêler la théorie et la pratique : la physiologie de l’effort venait en appui des plans d’entraînement personnalisés. Le temps passé dans mon bureau à les confectionner s’additionnait au temps consacré à manager les athlètes sur le stade des mines à Pulversheim. Je garde des souvenirs très forts de ces victoires obtenues individuellement ou en relais par des jeunes complètement embarqués dans l’aventure sportive.
Dans la même période, j’animais la commission Éducation de la fédération du PS du Haut-Rhin. J’y ai adhéré en 1976 ; c’était le Parti du « changer la vie ». C’était un débouché politique naturel à mon engagement pour l’école et l’égalité des chances. Mais pas un seul instant je ne rêvais de mandat électif.
Mon horizon de vie n’était à l’évidence pas celui de notre commune de résidence. J’hésitais alors entre deux voies. Celle d’entraîneur national de demi-fond ; j’avais déjà été sollicité à plusieurs reprises par la Fédération nationale d’athlétisme pour encadrer des stages nationaux ouverts aux meilleurs coureurs de demi-fond cadets et juniors, avec de beaux résultats à la clef. Et celle de professeur d’université à l’UER EPS de Strasbourg. Les enseignements que j’assurais dans le cadre de la formation continue des professeurs devaient m’y conduire naturellement.
De l’enseignant à l’élu
L’acceptation, après beaucoup d’hésitations, de figurer sur la liste municipale de gauche pour les élections de 1983, puis mon élection sur la liste socialiste aux élections régionales de 1986, allaient totalement changer le cours des choses.
Alors que je siégeais sur les bancs de l’opposition du conseil municipal, j’ai capitalisé mon statut d’élu régional et de jeune loup engagé en politique pour préparer la victoire aux élections municipales de 1989. J’ai habité cette ambition pleinement, goulûment, passionnément. C’est là que j’allais m’épanouir : goûter le pouvoir et relier la vision et l’action. Besoin égotique et satisfaction intellectuelle.
Le rôle de l’élu, je l’ai envisagé très vite comme un leader et comme un ensemblier de l’agir public. À la fois la pensée et l’action, le court et le long terme, les valeurs et le concret, la personne et l’universel. Un rôle gratifiant pour exister et pour agir !
Me voilà investi dans une ville que j’ai appris à connaître, à aimer, à promouvoir. Une ville, aux portes de Mulhouse et ancrée dans le Bassin potassique, marquée pendant longtemps par les industries de la potasse, du textile et de la mécanique. La reconversion s’est faite par l’installation dans l’agglomération de l’usine Peugeot, par les activités tertiaires et singulièrement dans notre commune par l’implantation d’une grande zone commerciale au lieu-dit le Kaligone (un « coin de la potasse »). Les trois zones d’activité qui étaient dédiées aux anciennes activités industrielles délimitaient les trois entrées de la ville.
Au milieu, les « dents creuses » ont été rapidement comblées à partir des années soixante par une addition de lotissements pavillonnaires. Tout cela a été construit sans grande vision urbaine, sans véritable maîtrise publique mais avec le souci de favoriser l’habitat individuel. À notre arrivée en responsabilité, le taux des logements dits sociaux était de 5 %. La ville a vu sa population doubler en quelques années et se régénérer tous les dix ans d’un millier de personnes. Une population qui comprend près de 20 % d’ouvriers et 8 % de cadres supérieurs ; le gros des habitants représente cette classe moyenne inquiète et révoltée des invisibles qui plus tard peupleront les ronds-points de France. Beaucoup de Kingersheimois sont également des travailleurs frontaliers qui, tous les matins, vont rejoindre la Suisse ou l’Allemagne. Ils s’en sortent socialement mieux mais au prix de déplacements et de boulots harassants.
Notre ville, comme la plupart des villes de la banlieue de Mulhouse, correspond assez bien au profil sociologique et électoral de la France périphérique décrit par Christophe Guilluy{2}.
Voilà le contexte sociologique dans lequel je m’engage, en équipe, dans la conquête de la mairie. La municipalité qui nous a précédés a fait le choix du minimum vital en termes d’équipements et de services publics locaux : des écoles qu’il a fallu rénover, une salle des fêtes à restructurer, un complexe omnisports évolutif couvert (Cosec) et une salle polyvalente. Deux stades de foot dont un légué par les mines de potasse. Un stade d’athlétisme qui s’affaisse deux ans après son inauguration. Pas de Maison des jeunes et de la culture (MJC), pas de médiathèque, pas de politique culturelle. Pas de vision. Un budget totalement inadapté pour une ville qui comptait alors 11 000 habitants, ne serait-ce que pour rénover les réseaux d’eau. Les impôts y sont parmi les plus bas de France. Et en vertu du « aide-toi et le ciel t’aidera », la dotation de l’État est réduite au minimum.
Notre opposition fut rude, déterminée mais toujours respectueuse : jamais dans la posture mais avec une autre vision, une autre ambition, une autre approche pour notre ville.
À mi-mandat municipal, mon élection au conseil régional d’Alsace me donnait au sein du conseil municipal un statut nouveau, représentait au sein de la population une voix de renouveau et me conduisait à me mettre en responsabilité de rassembleur.
Notre victoire au premier tour des élections municipales de 1989, nous la devons sans doute à la justesse de notre diagnostic et à la pertinence de notre contrat municipal « Ensemble, bougeons notre ville » ; sans doute aussi au crédit que nous avons gagné dans une opposition constructive et crédible ; peut-être à mon image de sportif « de haut niveau », à ma jeunesse, au témoignage d’une vie simple qui ressemblait à celle des gens, à l’authenticité de notre engagement et à une parole qui touche plutôt que des discours qui racolent.
Ce sont peut-être ces mêmes ingrédients qui m’ont vu gagner le canton six mois avant les municipales, en septembre 1988. Cela a vraisemblablement été la grande surprise de ces élections cantonales où un socialiste a battu, en terre d’Alsace, un poids lourd du Rassemblement pour la République (RPR) du paysage politique alsacien, élu un moment donné meilleur député de France.
Me voilà conseiller régional d’Alsace, conseiller général du Haut-Rhin, maire de Kingersheim et dans la foulée président de l’intercommunalité d’un Bassin potassique en reconversion. Me voilà embarqué dans l’euphorie du pouvoir et la spirale de sa conquête et de sa reconquête.
Le premier mandat de maire a été mené tambour battant avec une équipe enthousiaste et totalement investie. En quelques années, avec la construction d’un centre culturel pour tous, le Centre de rencontre, d’échange et d’animation (CREA), celle d’une nouvelle école, le Village des enfants, des investissements pertinents dans tous les domaines du cadre de vie, la naissance du festival international jeune public Momix, avec une écoute de tous les instants, une approche pragmatique de la tranquillité publique et la réactivité du service public local, les Kingersheimois ont développé un sentiment d’appartenance et de fierté.
Pour y parvenir, nous avons pu, et su, faire preuve d’inventivité et de courage, partagé une vision et une ambition, montré à toutes occasions notre attachement au sens de l’intérêt général, à des valeurs qui transcendent les clivages, à des principes qui rassemblent. Ce faisant, nous agissions pour les habitants, rarement avec eux, et le moteur qui m’animait au fond était celui de la « vieille politique » : gagner les élections puis décider dans l’entre-soi des élus.
Trente ans plus tard, la réflexion que je partage devant différentes assemblées prend tout son sens : « Les qualités sollicitées pour conquérir le pouvoir sont diamétralement opposées à celles qui sont requises pour le partager. » J’étais passé maître dans la conquête du pouvoir mais resté analphabète pour ce qu’il s’agissait de le partager. Cette prise de conscience s’est faite dans une nouvelle rencontre improbable : celle de l’élu installé et de l’homme qui se cherche.
De la conquête au partage du pouvoir
Que s’est-il passé entre le jeune élu aux dents longues et l’homme qui fait la rencontre de sa fragilité ? Entre celui qui rêvait conquête et celui qui commence à changer de regard ? Entre cette période où j’additionnais les victoires électorales et cumulais les mandats et ce moment où s’amorce la bascule vers un changement radical de posture ? Ce moment de ma vie où surgit un combat inédit, inconnu et bouleversant. Un combat intérieur. Entre l’ego et le service, entre la pesanteur et la grâce, entre Éros et Thanatos : les forces de vie qui élèvent et celles qui tirent vers le bas. Entre ce que Patrick Viveret appelle les « passions tristes de la lutte pour le pouvoir » et la mise en œuvre d’une faculté de création basée sur la coopération. Entre ce qu’Edgar Morin nomme l’alter-coopération et l’ego-compétition.
Ces questions ne sont ni singulières ni égotiques. Je pense avec le recul qu’aucun élu ni aucun responsable ne peut faire l’économie de cette introspection sur son rapport au pouvoir. Elle doit interroger le sens de notre engagement. Par des allers-retours entre l’intériorité et l’action, entre le silence et la parole, dans la recherche de lucidité et de discernement des révisions de vie.
Qu’est-ce qui a provoqué la métamorphose personnelle ? Qu’est-ce qui a fait émerger ce qui m’habitait et qu’est-ce qui a déclenché ce qui était à advenir ? Il y a en effet ce qui nous est donné par la naissance, par l’éducation, par l’identification au père ou à la mère et plus généralement par la dynamique de l’inconscient.
Je sais combien je sui...