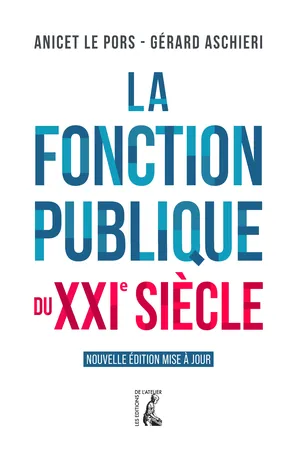![]()
Chapitre 1
À quoi sert la fonction publique ?
Le politologue Stéphane Rozès soulignait en 2009, dans le cadre d’un petit livre publié par la Fédération syndicale unitaire (FSU) : « Dans l’imaginaire national, [la fonction publique] est quelque chose qui porte l’intérêt général, qui pose la question du moyen et du long terme, qui porte l’investissement que fait une nation sur son avenir{3}. » Ces propos sont toujours d’actualité.
De fait, l’existence d’une fonction publique dont le statut est fixé par la loi est étroitement liée à une conception du service public qui, en France, s’est construite en étroite relation avec le pacte républicain et les valeurs de la citoyenneté forgées et enrichies au cours des siècles : une conception de l’intérêt général distincte de la somme des intérêts particuliers, une affirmation du principe d’égalité qui doit tendre à l’égalité sociale au-delà de l’égalité juridique, une exigence de responsabilité que fonde le principe de laïcité.
Certes, il n’y a pas d’adéquation totale entre service public et fonction publique : l’histoire de chacun des services publics dans notre pays et les choix politiques qui ont été faits à tel ou tel moment ont pour conséquence qu’une partie des services publics n’est pas assurée par des agents ayant le statut de fonctionnaires ni même d’agents publics. C’est le cas notamment d’un certain nombre de services à caractère industriel ou commercial, par exemple dans les domaines des transports, de l’énergie, des télécommunications. Cette situation ne résulte pas seulement de décisions politiques relativement récentes de privatisation ou de transformation du statut des entreprises et de leurs personnels{4}. Ainsi, la SNCF ou l’Assurance maladie assurent respectivement un service public des transports et de la santé sans pour autant employer de fonctionnaires.
Une construction originale
Il n’en reste pas moins que sur les quelque 6 millions de salariés exerçant dans les services publics, environ 5,5 millions relèvent de la fonction publique. Et dans les services qui n’emploient pas de fonctionnaires, il existe souvent des règles d’emploi et de carrière* ainsi que des garanties qui dérogent en partie au droit commun.
La fonction publique française se caractérise par une architecture originale{5} : des dispositions communes relatives aux droits et obligations des agents assurent son unité mais sont couplées à des dispositions particulières reconnaissant des spécificités en fonction de la nature de l’employeur : État, collectivités territoriales, hôpitaux publics. On a ainsi une sorte de « trinité » (laïque) de la fonction publique dont les trois versants sont : la fonction publique de l’État (FPE), la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique hospitalière (FPH).
Ainsi, parmi les fonctionnaires de la FPE, on trouve les personnels des administrations centrales, des services déconcentrés* et de leurs établissements publics (préfectures, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse, culture, emploi, etc.), les enseignants, les chercheurs, les policiers, etc.
Parmi les fonctionnaires de la FPT, on trouve les agents administratifs et techniques des communes, des départements et des régions ou ceux de leurs établissements publics. Ils exercent dans différentes filières : administrative, d’animation, culturelle, sociale, médico-sociale – tels les agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) –, sportive, technique – tels les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement –, ou appartiennent aux sapeurs-pompiers, à la police municipale, etc.
Parmi les fonctionnaires de la FPH, on recense les personnels des hôpitaux, ceux des établissements médico-sociaux et ceux des établissements publics s’occupant des personnes âgées.
D’autres agents publics ne relèvent pas du statut de la fonction publique, mais leur emploi est régi par des règles proches ; c’est par exemple le cas des militaires, des magistrats de l’ordre judiciaire, des praticiens hospitaliers ou des ouvriers d’État qui travaillent surtout au ministère de la Défense.
Enfin, pour des raisons historiques, il subsiste encore des fonctionnaires dans certaines entreprises qui sont devenues des sociétés anonymes, comme La Poste ou Orange{6}.
Ce sont la loi et des textes réglementaires (décrets) qui régissent cet ensemble.
En effet, notre pays a considéré que la prise en charge de l’intérêt général, dont sont responsables les agents des services publics, impliquait des règles spécifiques pour ces agents, alliant des droits et garanties à des devoirs et des contraintes. Si le choix a été fait de placer par la loi le fonctionnaire dans une situation statutaire et réglementaire – et non contractuelle – vis-à-vis de l’administration et s’il a été décidé que les emplois permanents des collectivités publiques doivent être occupés par des fonctionnaires, la raison en est simple : le fonctionnaire est au service de l’intérêt général, responsable devant la nation, à l’inverse du salarié de l’entreprise privée lié à son employeur par un contrat qui « fait la loi des parties » (article 1134 du Code civil), ce qui signifie qu’il régit les relations entre les contractants. Le statut le rattache à l’intérêt général au lieu de le renvoyer vers des intérêts particuliers, le sien ou celui de sa hiérarchie, de clients ou d’usagers. En ce sens, il lui permet de jouer le rôle d’une instance neutre au-dessus des parties, un recours en cas de conflits d’intérêts, une garantie pour chacun, quelle que soit sa situation, de se voir traité avec équité et conformément à la loi.
Une autre caractéristique de la fonction publique française est le choix qui a été fait d’une « fonction publique de carrière{7} ». C’est ce que définit l’article 12 du statut général* : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. » Cela signifie que si l’emploi d’un fonctionnaire est supprimé, il reste titulaire de son grade* et peut poursuivre la carrière liée à celui-ci. Sa carrière est censée lui assurer une progression de sa rémunération en fonction de son ancienneté et de sa « manière de servir », mais aussi des qualifications supplémentaires qu’il aura acquises.
Ce qui est souvent décrié comme étant des « privilèges » n’est rien d’autre qu’une réponse à des besoins spécifiques du service public : besoins de continuité, d’égalité, de neutralité mais aussi d’efficacité et de capacité d’adaptation. Ainsi, l’existence d’une carrière distincte de l’emploi est une des conditions de la neutralité, de la pérennité de l’action publique, mais aussi d’un travail collectif efficace au sein des services publics. Et la garantie de l’emploi des fonctionnaires a pour justification et contrepartie la continuité de l’action publique, en d’autres termes la nécessité d’assurer partout, à tous et sans interruption le service correspondant à leurs missions ainsi que l’adaptation de leur action aux besoins nouveaux des usagers. Elle a pour pendant l’obligation pour un fonctionnaire d’accepter tout poste correspondant à son grade, quelle que soit sa localisation.
De la même manière le recrutement par concours*, avec un jury indépendant de l’employeur, qui est une autre caractéristique de notre fonction publique, n’est pas seulement une garantie d’égalité de traitement des candidats sur la base de leurs seuls mérites* : il est aussi un gage d’indépendance et de neutralité par rapport aux intérêts particuliers.
Et pour les mêmes raisons – parce qu’ils sont au service de l’intérêt général – les fonctionnaires voient leur droit de grève encadré, voire interdit pour certains d’entre eux{8}. On oublie trop souvent que, sur un certain nombre de points, leurs garanties sont inférieures à celles des salariés du privé : que l’on songe par exemple aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) malgré un récent progrès{9}. Un certain nombre de données montrent d’ailleurs que les fonctionnaires sont nombreux à connaître des contraintes et des conditions de travail spécifiques : par exemple dans la fonction publique et, en particulier dans la fonction publique de l’État, le rythme de travail est moins « choisi » que dans d’autres secteurs, du fait d’une demande extérieure obligeant à une réponse immédiate. Plus d’un tiers des personnels de ces secteurs a des rythmes imposés par un contrôle ou un suivi informatisé. Selon l’édition 2020 du rapport annuel sur l’état de la fonction publique, 66,7 % des fonctionnaires ont un travail morcelé : ils doivent fréquemment interrompre une tâche pour en effectuer une autre non prévue (64 % dans le privé). Ils sont 44,7 % dans la FPE à ne pas pouvoir interrompre momentanément leur travail quand ils le souhaitent (c’est notamment le cas des enseignants) contre 30,4 % pour l’ensemble des salariés. Les agents de la FPH travaillent beaucoup plus souvent que l’ensemble des salariés selon des horaires atypiques{10} (62 %, contre 46 % dans le commerce et l’industrie). Ils sont plus nombreux à ne pas bénéficier d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives (23,8 %, contre 15 %). Ils travaillent fréquemment de nuit (27 %, contre 20 %). Ceux de la FPE sont plus exposés à des durées longues de travail (38 % effectuent plus de 40 heures, contre 29,09 % en moyenne pour l’ensemble des salariés{11}). Et les fonctionnaires sont plus nombreux que les autres salariés à travailler le dimanche, de façon permanente ou occasionnelle : 36,57 %, contre 27,9 %{12}. Il ne s’agit pas de déduire de ces constatations que les fonctionnaires sont dans une situation plus défavorable que les salariés du privé, d’autant que les situations varient d’un secteur à l’autre et peuvent être plus ou moins favorables. Elles illustrent simplement le fait qu’au regard de leurs garanties figurent des obligations et des contraintes qui ne sont pas que théoriques.
Une référence sociale
Si ces garanties apparaissent à beaucoup – fonctionnaires inclus – comme des privilèges par rapport aux salariés du privé, c’est que l’on en a souvent oublié le sens et surtout que le chômage a créé un rapport de force tellement défavorable aux salariés du privé que le CDI lui-même – qui est pourtant la norme largement majoritaire de l’emploi – a perdu sa valeur protectrice.
Or, l’idée-force qui sous-tend à la fois l’existence d’un statut et les garanties qu’il offre est que la précarité n’est en rien un gage d’efficacité, au contraire. Il est difficile de s’engager dans un projet, de travailler en équipe, de s’inscrire dans un collectif, de penser son action dans la durée si l’on n’a aucune garantie pour son avenir. Cela vaut pour les fonctionnaires, bien sûr, mais aussi pour tous les salariés.
Et, justement, l’avenir n’est-il pas de s’appuyer sur le statut des fonctionnaires pour conquérir ou reconquérir des droits pour l’ensemble des salariés ? Il ne s’agit évidemment pas de transformer les salariés du privé en fonctionnaires : ce serait oublier le lien étroit entre statut et service public. En revanche, se pose la question d’étendre des règles statutaires aux salariés des services publics qui ne sont pas fonctionnaires. Et surtout celle d’assurer à tous les salariés un ensemble de droits, notamment en matière de protection sociale et de formation professionnelle, qui ne soient pas liés à l’emploi occupé ou à l’employeur, mais qui suivent le salarié individuellement tout au long de sa vie professionnelle tout en restant dans le cadre de garanties collectives. C’est l’idée d’un « statut du travail salarié » ou d’une sécurité sociale professionnelle – termes portés par nombre d’organisations syndicales – ou plutôt de ce que l’on pourrait appeler un « statut du travailleur salarié privé ». Une telle construction pour les salariés du privé ne devrait pas passer par un texte ou un ensemble de textes analogue au statut des fonctionnaires, mais plutôt par un ensemble de dispositions dans le Code du travail complétées par la négociation de conventions collectives respectant la hiérarchie des normes. D’ailleurs l’embryon de portabilité des droits à la formation continue – à travers le compte personnel de formation (CPF){13} créé en 2015 suite à un accord national interprofessionnel – montre, en dépit de nombreuses insuffisances, un début de prise de conscience de ce besoin.
Ce type de revendication est parfois critiqué au motif que les employeurs pourraient s’en servir pour se défausser de leurs responsabilités en matière d’emploi et licencier ainsi plus facilement. S’il est exact que ceux qui théorisent la nécessité d’accroître la flexibilité de l’emploi proposent de faire des garanties ainsi concédées une contrepartie de cette flexibilité accrue, inversement, on peut considérer que donner aux salariés des garanties de ce type, c’est aussi leur donner les instruments d’un rapport de force plus favorable pour conduire des luttes. Et surtout, si l’on extrait la réflexion du court terme, on sait que de façon inéluctable les progrès de la science et de la technologie, l’incontournable transition écologique vont faire évoluer profondément tous les métiers, que ceux-ci vont se transformer à grande vitesse, certains disparaître, d’autres, que l’on n’imagine pas encore, émerger. Cela vaut autant pour le privé que pour le public. De telles garanties ne seraient-elles pas pour les salariés le moyen de ne pas subir douloureusement ces évolutions mais plutôt de s’en emparer et d’en maîtriser les conséquences ? Ne seraient-elles pas aussi un des instruments pour fonder autour d’un bien commun – le travail – de nouvelles solidarités ?
À l’inverse des libéraux qui considèrent que les garanties statutaires des fonctionnaires sont une anomalie et qu’il convient à la fois de les réduire – voire de les faire disparaître – et de limiter strictement le champ de leurs bénéficiaires à quelques fonctions, nous pensons que la mise en œuvre d’un tel démantèlement de la fonction publique tirerait l’ensemble des salariés vers moins de droits, moins de garanties et menacerait les valeurs mêmes ainsi que l’efficacité du service public. Une autre démarche est possible pour assurer les solidarités et les convergences d’intérêt entre salariés du public et salariés du privé, dans laquelle le statut ne serait ni un modèle ni un but mais servirait de point d’appui pour assurer à tous des garanties non seulement nouvelles mais également adaptées aux besoins de notre société.
Le xxie siècle, âge d’or du service public ?
Cependant la réflexion sur la fonction publique et son avenir ne peut se limiter à ces arguments. Elle implique à l’évidence de s’interroger sur ce que représentent les services publics.
La crise économique qui a éclaté aux yeux de tous en 2008 a, dans notre pays, mis en évidence le rôle d’« amortisseur social » qu’ont joué ces derniers conjointement avec notre système de protection sociale. Les services publics ont permis de soutenir l’emploi public, mais aussi de limiter l’explosion des inégalités, d’assurer, à travers les services rendus (éducation, santé, transports, justice...), des formes de redistribution et de limiter ainsi les conséquences de cette crise. Celle-ci est malheureusement loin d’être terminée.
Cette réalité est généralement reconnue et François Fillon lui-même, en 2008, dans son discours d’installation de la commission Silicani{14}, se voyait contraint de leur rendre hommage.
Et la crise sanitaire de 2020 que nous évoquons dans notre introduction aboutit au même constat en montrant à la fois le rôle indispensable qu’ont joué les services publics et leurs agents dans un contexte inédit et l’incapacité du néolibéralisme à y faire face et à y apporter des réponses efficaces.
Pourtant on ne peut se contenter de ces arguments de circonstance. Les services publics ne sont pas seulement un bouclier contre les crises. Ils sont une réalité structurelle et une composante essentielle de la vie dans une société moderne, au-delà même des frontières nationales ou européennes. Dans un entretien publié dans la revue Nouveaux Regards de l’Institut de recherches de la FSU, le sociologue Robert Castel résumait ainsi la réactivation de la notion de « société de semblables » :